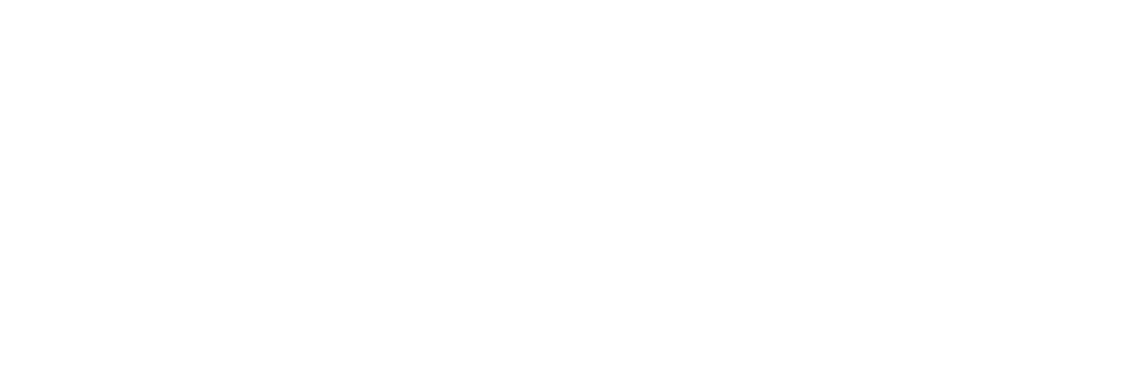Comme toute perspective minoritaire portée par des survivant·es, les mad studies sont polyphoniques et se tissent aux frontières des mondes. Ce texte a largement bénéficié du mouvement, des explorations douloureuses et des réflexions ouvertes par Mel Baggs, Tal Piterbraut-Merx, et Jennifer L. Reimer.
Qu’iels reposent en puissance ; et que la terre leur soit légère.
Introduction
Alors que dans les années 1970, la recherche en sciences humaines et sociales s’est attachée à mieux comprendre et évaluer les comportements humains, le tournant dit « émotionnel » des années 1980 a, pour sa part, consacré non seulement l’expression des émotions mais également l’analyse, la compréhension et le traitement de ces dernières. S’est alors dessiné « une double tendance […] : une revalorisation des théories sociologiques des émotions et une revalorisation sociale des émotions » (Fernandez et al., 2013, pp. 2-3). Ainsi, si les domaines de la médecine psychiatrique et de la psychologie ont permis aux thérapies dites « centrées sur les émotions2 » de connaître leur plein essor, les sciences sociales ont également admis que les émotions, en tant que fait social, se devaient d’être prises au sérieux. Depuis, de nombreux·ses chercheur·euses ont interrogé·es les émotions pour tenter d’en donner une définition, d’en préciser la nature et la fonction, les distinguant parfois en cela des sentiments, des passions ou des affects (Despret, 2001 ; Han, 2014, Hochschild, 2017 ; Illouz 2022 ; Illouz et Cabanas, 2018 ; Lepine, 2023 ; Quéré, 2021, 2023). Pour ma part et concernant le présent texte, j’utiliserai de façon indistincte les notions de sentiments, d’affects ou d’émotions. Non que je considère qu’il n’existe aucune différence entre elles, mais détailler par le menu leurs caractéristiques propres ne présente aucun intérêt méthodologique pour le développement qui suit. Mon attention porte ici davantage sur la façon dont les émotions, en tant qu’expressions façonnées par le social, permettent un maintien de l’ordre dominant lorsqu’elles sont prescrites dans un cadre thérapeutique.
Ainsi, conformément au projet des mad studies3 (Dormeau, 2025, 2026) mon postulat initial repose sur l’idée que les émotions n’appartiennent pas aux individus, que les ressentis qui nous traversent ne relèvent pas de sentiments purement subjectifs qui diraient quelque chose d’une forme de vie intrapsychique. Je crois en revanche qu’elles nous informent sur le monde social et les structures politiques au sein desquelles nous évoluons, comme une sorte de jugement moral des conduites et des relations. C’est pourquoi je cherche ici à analyser, à partir d’une expérience personnelle s’inscrivant dans une trajectoire dite « de rétablissement4 », les fondements normatifs ainsi que les implications émotionnelles de la reproduction, et donc de la possible subversion, d’un ordre social injuste. Plus précisément, il s’agit de se demander — au travers des notions de limites, frontières et frontiérisation — ce qu’il se passe lorsqu’on cherche à unifier et clôturer une entité perçue (selon les normes en vigueur) comme débordante. Quelles en sont les conditions, les effets, et finalement, quelles conclusions politiques est-il possible d’en tirer ?
Pensé comme une enquête auto-ethnographique exploratoire, cet article propose comme point de départ l’analyse des mutations nosographiques des troubles de la personnalité dit « du groupe B », dont le diagnostic concerne presque exclusivement le groupe des femmes et les minorités de genre. Je convoquerai ensuite différents exemples de cadrages émotionnels prescrits, issus d’enquêtes de terrain sociologiques (Hochschild, 2017 ; Linder, 2023 ; Garrec, 2024a), dans le but d’expliciter les dynamiques de pouvoir et les mécaniques de renormalisation qui se jouent dans le champ thérapeutique. Enfin, je mettrai en discussion ces différents apports afin d’interroger les enjeux d’une société faisant de la (re)normalisation émotionnelle un outil de conformation à l’ordre social dominant, sous couvert d’une plus grande émancipation.
Étouffer la menace
Courant août 2022, j’ai demandé l’accès aux dossiers médicaux relatant mon suivi psychiatrique5 (incluant hospitalisations — parfois sous contrainte —, cures, post-cures, consultations en addictologie6 et en Centre Médico-Psychologique), qui couvre la période de mes quatorze à mes trente-quatre ans. Vingt ans. À peu près trois cents pages. Huit diagnostics différents dont la plupart ne m’ayant jamais été communiqué, et d’autres tout droit venus du xixe siècle. J’ai reçu de lourds traitements médicamenteux pour quatre de ces diagnostics, puis finalement leurs disqualifications par d’autres praticien·nes, et la découverte d’une maladie auto-immune dont quelques manifestations (toutes en lien avec des dysrégulations émotionnelles) peuvent se confondre avec celles de certains troubles psychiatriques. Les autres, réunis sous la classification plus globale de « troubles de la personnalité », vont servir de terreau analytique au présent article.
Je ne rentrerai pas davantage dans le détail de ces centaines de pages, qui m’appartiennent et sont d’une violence inouïe. Elles m’abîment et m’humilient à chaque lecture, et je doute qu’elles cessent un jour de le faire. Ces feuillets contiennent plus de la moitié de ma vie et autant d’aveux de maltraitance institutionnelle, d’usage démesuré et illégitime de la force, de consentement bafoué et indissociable de l’exercice du pouvoir psychiatrique. Ils attestent de la profonde méconnaissance du corps soignant pour la souffrance hors-norme7 (Dormeau, 2023), ses mécanismes, ses causes, son émergence et ses multiples expressions. Ce qu’ils pointent surtout, c’est cette façon systématique de mépriser puis anéantir tout ce qui met en déroute, au premier plan de quoi se trouve l’ingouvernabilité émotionnelle de celles et ceux que l’on psychiatrise. Et toujours cette même toile de fond comme un sifflement lancinant entre les murs de chaque institution : mais comment diable gérer ces ingérables ? Plus que ma propre histoire, ce dossier contient une part non négligeable de l’Histoire de la psychiatrie, bâtie sur des fondations coloniales et des présupposés misogynes (Showalter, 1987 ; Dorlin, 2006). Pathologiser la souffrance subalterne pour étouffer la révolte (Metzl, 2020) est le geste inaugural sur lequel s’est construite la discipline. C’est également celui qui m’a en partie structurée, et dont je tente péniblement de m’extraire encore aujourd’hui.
De l’injonction à devoir me gérer (sans quoi on me gérait) j’ai conservé l’empreinte de la frontière, devenue frontiérisation qui, si elle m’était déjà constitutive, m’a obligée à établir mes propres contours et définir un mode de régulation de ce qui en moi — et de moi — déborde. J’emprunte au philosophe Achille Mbembe cette expression8, entendue initialement comme processus de transformation continue d’espaces délimités en lieux infranchissables pour certains individus, à l’initiative des grandes puissances mondiales (Mbembe, 2020). Ce que je souhaite signifier par cet emploi, c’est que la sur-médication contrainte et/ou l’auto-régulation demandée impose la redéfinition d’un périmètre de vie circonscrit, retranché, nécessitant l’infranchissabilité des limites du Soi9 par un cloisonnement radical entre soi et l’Autre. Pour se faire, il m’a été dispensé une (ré)éducation, que la désignation d’« alliance thérapeutique10 » a permis d’affadir et faire passer comme levier principal d’une agentivité11 à retrouver. Car, m’a-t-on dit, se positionner sur le chemin de l’autonomie, tracer la voie de son rétablissement, c’est en premier lieu comprendre — et surtout admettre — que la plus grande menace pour soi-même émane de soi-même. Que nous ne sommes pas toujours maître·sses de nos réactions mais qu’il est possible de le devenir, et que la peur de l’explosion émotionnelle incontrôlable qui ravage tout sur son passage peut être canalisée. Si dans mon cas (et dans celui de toute personne psychiatrisée), ce discours et cette assignation proviennent en premier lieu de l’institution psy*, elles n’en restent pas moins des représentations collectives dominantes largement (re)produites par, et relayées dans le corps social. La conduite à tenir est sans appel : il faut apprendre à endiguer cette menace-en-soi avec une stratégie efficace de gestion des débordements éventuels, le conditionnel latent se figurant toujours comme le meilleur répertoire d’action possible.
Décryptant le caractère menaçogène du cadre de vie imposé par la sécurité intérieure américaine après le onze septembre 2001, et l’état de tension permanente qui en émane, le philosophe canadien Brian Massumi indique que « […] la menace n’est pas objective. Elle est potentielle. La menace potentielle appelle une politique potentielle (potential politics) » (Massumi, 2021, p. 30). Et cette politique de la potentialité12 me semble intéressante à rapprocher ici des préceptes de ladite remédiation de soi par soi, puisqu’elles en partagent certains rouages. Ainsi, l’idée que la menace potentielle est inscrite en nous-même fait émerger une nouvelle forme dépolitisée de la figure de l’ennemi intérieur13, sous des traits exclusivement psychologiques et émotionnels. L’ennemi intérieur ce sont nos affects antérieurs incontenus, nos points de tension irrésolus et nos ambivalences constitutives. C’est l’être en nous qui hurle encore la domination subie et les injustices commises sur nos corps. C’est la menace subalterne à étouffer, au risque sinon de voir se fissurer l’ordre social dominant.
Alors j’ai en tête ces mots de Mel Baggs, blogeur·euse américain·e autiste et non-binaire :
Pour survivre [dans un tel endroit], il faut que quelque chose se brise à l’intérieur de vous. C’est impossible à expliquer entièrement à quelqu’un·e qui n’a pas été dans cette situation. Quelque chose en vous doit mourir. (...) Tant que l’on ne comprend pas ces dommages — ce qu’ils sont, ce qu’ils signifient, d’où ils viennent — on ne se débarrassera jamais des institutions. On doit le comprendre à un niveau très intime ou bien on le reproduira sans se rendre compte de ce que l’on fait14. (Baggs, 2012).
Troubles dans la personnalité
Dans la cinquième et actuelle version du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM), le trouble de la personnalité est défini comme
un mode durable des conduites et de l’expérience vécue qui dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l’individu ; est envahissant et rigide ; apparaît à l’adolescence ou au début de l’âge adulte ; est stable dans le temps et source de souffrance ou d’une altération du fonctionnement. (APA, 2015)
Répertoriés dans la section centrale du manuel, les troubles de la personnalité composent une des vingt catégories de troubles mentaux classifiés et sont découpés en trois sous-groupes A, B et C. Le groupe A désigne les personnalités dites « bizarres-excentriques », le C celles que l’on considèrent « anxieuses-évitantes » et le groupe B, qui va particulièrement retenir mon attention ici, les personnalités nommées « théâtrales-émotives », voire dans certains manuels « dramatiques » ou « capricieuses ».
Sans entrer dans une historiographie approfondie de l’histoire de la catégorie, il est important de préciser que le chapitre sur les troubles de la personnalité est un des plus modifié et débattu depuis la création du premier DSM, leurs diagnostic et classification n’ayant jamais réussi à faire consensus. Le philosophe des sciences Steeves Demazeux (2013) rappelle d’ailleurs dans un article édifiant que deux membres du groupe de travail sur la cinquième version du DSM ont quitté le collectif après des désaccords majeurs. Exposant les confrontations successives, il pointe les incompatibilités ontologiques entre deux visions des troubles mentaux, et lit les discussions houleuses comme représentatives de cette tension fondamentale entre perspectives catégorielle et dimensionnelle, renvoyant à l’incapacité même de définir avec exactitude la notion de trouble. Alors que la perspective catégorielle postule que les entités psychiatriques cliniques sont radicalement distinctes des états considérés comme « normaux », la perspective dimensionnelle n’établit qu’une simple différence de degrés entre ce qui relèverait du normal et du pathologique. Ces deux approches, de tradition psychiatrique pour l’une et psychologique pour l’autre, reposent sur des présupposés définitionnels très différents, et les débats nosologiques concernant le DSM-V semblent avoir éclairé et renforcé une opposition qui aurait plutôt dû faire l’objet d’une tentative de dépassement15. Également, plusieurs auteurs affirment que ces multiples divergences ont permis à différents lobbys (notamment le lobby des borderline qui serait fortement attaché à la conservation de cette étiquette) d’influencer le choix des types de diagnostics retenus finalement dans le manuel (Demazeux, 2013 ; Mulder et Tyrer, 2023).
D’un point de vue notionnel, si les distinctions entre névroses, psychoses et perversions héritées de la psychanalyse freudienne ne sont plus considérées comme opérantes dans le champ psychiatrique, elles irriguent pourtant toujours la nosologie. Concrètement, la distinction qu’effectuait la psychiatrie dite « classique » (avant le tournant comportementaliste des années 80) entre pathologies psychotiques et névrotiques, se retrouve aujourd’hui sous un habillage lexical différent mais qui utilise peu ou prou les mêmes critères. Pour exemple, les éléments cliniques rattachés aux névroses (terme qui n’est sensément plus employé) ont été réattribués à d’autres catégories de troubles psychiques, et principalement aux troubles de la personnalité. Ainsi, le critère de proximité avec la normalité dont étaient parés les troubles névrotiques (car considérés comme moins déstructurants, plus organisés et permettant à l’individu d’être fonctionnel), va se retrouver dans ces nouvelles catégories diagnostiques, envisagées comme des variations, des déviations de traits mal adaptés pouvant se confondre avec la normalité.
Fait notable, que ce soit dans les pages du DSM ou dans celles d’innombrables autres manuels, ouvrages, articles grand public ou contenus médiatiques, l’indication de la prévalence en fonction du genre y est systématique. Plus notable encore, cette indication n’est absolument jamais explicitée ni discutée. J’ai à ce jour consulté une cinquantaine d’ouvrages et au moins autant d’articles relatifs aux troubles de la personnalité et leur traitement, avec un intérêt particulier porté sur le groupe B, et plus spécifiquement les troubles de la personnalité borderline et histrionique16. Si la quasi-totalité de ces documents posent le sex-ratio comme simple élément factuel, les rares poussant l’interrogation un peu plus loin sont de deux natures. D’une part, on retrouve les manuels/ouvrages17 plus récents — ou rééditions — dont les quelques explications aussi floues que généralistes se résument souvent à établir que : « les facteurs psychosociaux peuvent rendre les femmes plus vulnérables au trouble » (Mehran, 2011, p. 4) et « les femmes consultent plus que les hommes » (Cottraux, 2011, 2015). Parfois exprimée, l’intuition étonnamment limpide selon laquelle « les cliniciens peuvent, de façon biaisée, diagnostiquer les femmes comme borderline et les hommes comme psychopathes » (Mehran, 2011, p. 4), ne semble produire aucune répercussion sur le contenu de l’ouvrage ou les pratiques.
D’autre part, les seules interrogations critiques formulées à l’égard des chiffres énoncés constituent un corpus précis, ou la question du genre dans les catégories diagnostiques est le sujet central18. En somme, hors intérêt spécifique (et souvent non médical), le fait que les critères d’évaluation diagnostique correspondent par ailleurs aux normes de socialisation féminine n’a l’air aucunement de justifier que l’on s’y attarde. Plus encore, les « vignettes cliniques » pensées comme des éléments supplémentaires de repérage potentiel, constituent bien souvent des stéréotypes caricaturaux au sexisme nauséabond. Ainsi, le livre des psychiatres Christophe André et François Lelord au titre éloquent (Comment gérer les personnalités difficiles) et considéré comme un best-seller du genre19, propose comme illustration de la personnalité histrionique cette description de Caroline :
On ne risque pas de ne pas la remarquer : le premier jour où je l’ai aperçu dans le couloir, elle portait un ensemble gris, très classique pour le haut, mais avec une minijupe impressionnante, qui ne laissait ignorer à personne qu’elle a des jambes superbes. En même temps, dès qu’on lui adressait la parole elle prenait un air très froid, très professionnel, business-like comme on dit, ce qui contrastait avec son aspect très sexy, comme si elle ne se rendait pas compte qu’elle était provocante. (André et Lelord, 2000, p. 89)
Quelques pages plus loin, les auteurs prennent de la hauteur et se questionnent plus largement : « besoin de plaire, humeur changeante, recherche d’aide … ne sont-ce pas des caractéristiques féminines traditionnelles ? » (André et Lelord, 2000, p. 92). La conclusion sous forme d’un auto-repérage parachève le tableau, en proposant par exemple comme items en réponse à l’interrogation « avez-vous des traits de personnalité histrionique ? » : « j’adore séduire même quand je n’ai pas envie d’aller plus loin » ou « on m’a parfois fait remarquer que je m’habillais de manière trop excentrique ou provocante » (p. 108). Si on imaginait (espérait) la figure névrotique de l’allumeuse-hystérique quelque peu dépassée, il apparaît pourtant que la culture du viol (Rey-Robert, 2019) a encore de beaux jours devant elle20.
Hystériques, histrioniques et borderlines : le bal des folles
La désignation de « névrose hystérique » disparaît de la classification des troubles psychologiques dans la troisième version du DSM, publiée en 1980. À la faveur de la dissolution des catégories d’influence psychanalytique et de leur éclatement/regroupement sous d’autres troubles, la névrose hystérique devient « trouble de la personnalité histrionique ». Pas peu fiers d’avoir conclu (en 1980 !) que les symptômes provoqués par l’hystérie ne provenaient pas de l’utérus, les rédacteurs soulignent par leur nouvelle appellation : « un mode généralisé de réponse émotionnelle excessive en quête d’attention » (APA, 2015). Représentée par la figure de l’histrion, ce comédien tragique jouant des farces grossières dans le théâtre antique, la personnalité dite histrionique rendrait compte d’une constante symptomale caractérisée par une expression dramatique, débordante et théâtralisée de ses émotions. Si un déplacement conceptuel semble s’être opéré entre ces deux terminologies, il apparaît en réalité que la perception du trouble et ses indications diagnostiques n’ont aucunement été modifiées. Dans un article sur « le genre de l’hystérie », la sociologue Julia Legrand indique ainsi que :
Les supposées transformations de la catégorie d’hystérie en troubles histrioniques sont la condition même du maintien d’une catégorie genrée en psychiatrie, que le changement de terminologie dépolitise. La littérature psychiatrique décrit ainsi les deux troubles avec une symptomatologie identique. Le principal symptôme qui caractérise l’histrionisme hystérique est le « théâtralisme », c’est-à-dire une « tendance aux expressions émotionnelles spectaculaires » (Dictionnaire médical de l’Académie de médecine, 2022). (Legrand, 2023, p. 10)
Plus encore, le trouble dit « de la personnalité borderline » apparaît lui aussi comme une extension ou un renouvellement de la catégorie d’hystérie, en ce qu’il partage notamment avec l’histrionisme un flou théorique et des critères d’assignation à des normes émotionnelles permettant de contrôler les femmes. Dans le sixième chapitre de son ouvrage Psychiatric Hegemony : A Marxist Theory of Mental Illness, le sociologue Bruce Cohen retrace avec précision cette pathologisation systématique des émotions et des expériences féminines par les professionnel·les de la santé mentale, montrant très bien, avec une perspective marxiste, « comment ces activités ont principalement contribué à renforcer la division du travail, les rôles traditionnels des sexes et le pouvoir patriarcal » (Cohen, 2016, p. 21 ; ma traduction).
D’un point de vue terminologique, l’appellation borderline, qui exprime avec force toutes les zones d’inconfort et les points aveugles que charrient les états indéfinissables, me parait rendre compte de façon exemplaire de cette frontiérisation soulignée en amorce. Lorsque tout déborde il faut être en capacité de tracer des lignes, redéfinir des frontières, poser des limites. Il faut pouvoir contenir et nommer. Pourtant, le flou entourant ce trouble (sa définition et ce qu’il désigne) s’insinue jusque dans sa dénomination même. C’est une catégorie historiquement instable qui cherche à décrire l’instabilité mais n’y arrive jamais. Au plan épistémo-ontologique, c’est presque un cas d’école : qui de la chose nommée ou de la catégorie servant à la nommer est la plus insaisissable — et donc incontrôlable ? Pour rappel, le trouble de la personnalité borderline est également nommé « état-limite » ou « organisation limite » dans la Classification Internationale des Maladies de l’OMS, et renvoie à un type de « personnalité émotionnellement labile » (CIM-11, 2019). Il a été pointé à plusieurs reprises que la non-correspondance des catégories entre le DSM et la CIM constitue une preuve supplémentaire de l’approximation de celles-ci.
D’origine psychanalytique, cette affection psychopathologique « aux frontières de la folie » était définie par une symptomatologie névrotique couplée à des traits prépsychotiques, sans toutefois jamais entrer pleinement dans la psychose. D’une pathologie-frontière inclassable, à la limite de la folie, elle a muté en pathologie des limites du soi, considérée désormais comme une entité clinique autonome et relativement stable dans son instabilité. Ce saut définitionnel m’interpelle à au moins deux titres ; d’une part car il permet un transfert d’imputabilité entre ce qui relève d’une problématique exogène (impasse méthodologique pour classifier ces troubles) et sa prise en charge à échelle individuelle (travailler à la consolidation de son identité et à sa régulation émotionnelle). D’autre part, car cette définition d’une organisation autonome et anarchique, dont les contours et le fonctionnement échappent complètement aux grilles de lecture traditionnelles, correspond précisément à ce que je nomme une « condition liminaire » (Dormeau, 2026), entendue comme un mode d’être au monde instable et ambivalent. Là où la clinique pathologise cet « aménagement » en ne produisant qu’une lecture en termes de déviance (ou de déviation) par rapport au normal et à la norme, je l’envisage au contraire comme une forme politique et métaphysique particulière, caractérisée en partie par une façon singulière d’habiter cette instabilité.
Bien qu’ayant une sensibilité personnelle pour tout ce qui touche aux limites et frontières, je considère en outre ces trois troubles (hystérique, histrionique et borderline) comme équivalents et les aborde de façon indistincte. L’important pour mon développement étant la façon dont sont forgées ces catégories (qui/ce qu’elles visent) bien plus que les catégories en elles-mêmes (leurs critères diagnostics ou les symptômes sensés y être rattachés), je les pense comme un ensemble constituant un spectre des pathologies (codées comme) féminines de l’expression de la résistance subalterne. Jessica Eaton, psychologue féministe spécialisée dans le trauma et les violences sexuelles, pose ainsi de façon claire :
En fait, je tiens toujours à souligner aux praticiens cliniques que les critères diagnostiques du DSM-II pour « hystérie » et ceux du DSM-V pour « trouble de la personnalité limite » sont très semblables. Et de la même manière que l’hystérie a été décrite comme la « poubelle de la santé mentale », le trouble borderline est décrit comme un « diagnostic fourre-tout ». (…) « Hystérie » et « trouble borderline » sont essentiellement le même diagnostic. Ils ciblent tous les deux des femmes et des filles. Ils sont tous les deux construits autour des stéréotypes de genre. Ils oppriment tous les deux les femmes traumatisées et maltraitées. (Eaton, 2019)
Ce constat est partagé par Jennifer L. Reimer, dont le travail de thèse amorcé avant son décès portait sur les troubles de la personnalité, et dont les premiers écrits, conséquents, pointaient également que :
C’est le privilège de l’institution psy que de déterminer lorsqu’un « trait de personnalité normal » a en quelque sorte franchi une ligne et est entré dans le domaine de la « pathologie ». Le DSM utilise le descriptif vague et hautement interprétatif de « inapproprié et intense » pour les critères des trois troubles de la personnalité connus pour être « féminins » (AAP 1980, 1994)21. (Reimer, 2009)
Interrogée dans la série documentaire de Pauline Chanu et Annabelle Brouard sur l’hystérie, Julia Legrand abonde elle aussi dans ce sens à l’issue de son enquête :
Ce que j’ai découvert sur le terrain de la psychiatrie ambulatoire et hospitalière (donc la psychiatrie publique française) c’est qu’en réalité le diagnostic est toujours utilisé dans les pratiques. L’hystérie quelque part change de nom et prend le nom de trouble histrionique, mais en plus d’autres travaux montrent que l’hystérie à en fait une symptomatologie qui recoupe tous les troubles de la personnalité, notamment les troubles de la personnalité borderline22.
Elle relève également comme constante paradoxale et probante le fait que les psychiatres, qui considèrent ces femmes comme des manipulatrices qui simuleraient leurs troubles, leurs prescrivent pourtant des traitements lourds tels que des neuroleptiques et des thymorégulateurs, associés à des anxiolytiques ou des anti-dépresseurs. Parce qu’elles suscitent bien souvent chez les soignant·es exaspération et mépris, ces patientes se retrouvent elles-mêmes dans une situation « limite » en ce qu’elles se voient assignées à une catégorie certes psychiatrique, mais déconsidérée en son sein. Ivan Garrec, qui a consacré sa thèse de sociologie au trouble borderline et son traitement, constate également sur son terrain aux urgences psychiatriques, que les professionnel·les de la psychiatrie (contrairement aux professionnel·les du champ psychothérapeutique) « n’accordent pas un véritable statut de malade aux personnes dites borderlines » (Garrec, 2024b). Cette stigmatisation entraîne alors simultanément une sur-médication et une moins bonne prise en charge, le temps clinique et les soins accordés étant quantitativement et qualitativement moindres que pour d’autres catégories de patient·es. La prise en charge ultérieure (post-hospitalisation ou hors secteur) pour les patientes souhaitant être suivies, se fait donc presque exclusivement au plan psychothérapeutique, l’attention psychiatrique restant une « gestion de crise » réservée aux cas non traités ou pour lesquels le travail émotionnel prescrit n’a pas encore fait son œuvre.
La fabrique des émotions
Au début des années 2000, les thérapies comportementales et cognitives (TCC) entrent dans leur « troisième vague23 » (Cottraux, 2011), envisagée comme un enrichissement des deux premières (la première est comportementaliste, la seconde cognitiviste) par des techniques centrées sur les émotions (Forner-Ordioni, 2019). Dite « intégrative », cette nouvelle génération s’appuie sur des méthodes plurielles empruntées à divers champs, et prend pour axe de travail central les pensées et la recherche d’un équilibre émotionnel. Envisagées comme des psychothérapies de l’ici et maintenant, — c’est-à-dire moins tournées vers le passé que vers les ressentis dans l’instant présent — elles font la part belle à l’identification, la compréhension et l’acceptation des émotions, dans la perspective d’un remodelage de la relation de l’individu à son milieu via la relation de soi à soi. Ainsi, il ne s’agirait pas de gérer ses émotions (bien qu’appréhender, repérer, nommer, classifier, adapter répond pourtant en tous points à un cahier des charges gestionnaire), mais de se contrôler soi au sein d’interactions sociales, à partir d’un travail de fond sur (et dans) son monde intérieur et les affects qui le constitue.
On trouve ici l’idée très répandue (et qui a largement infusée via les neurosciences cognitives ces vingt dernières années) de ressources intrinsèques auxquelles il convient de se reconnecter pour y puiser de quoi se réparer, s’apaiser, et permettre un rapport au monde extérieur moins brutal et plus aligné. Se dessine en creux de ces affirmations la forme irréductible du Sujet comme noyau interne authentique et objectif, naturellement séparé du monde social et constamment menacé d’envahissement par celui-ci. Nommé homo psychiatricus par Norbert Elias (2010), ce modèle présuppose une division radicale entre ce qu’il se passe à l’intérieur et à l’extérieur de l’individu. Plus philosophiquement, je perçois également cet enjeu de séparation dans une lecture platonicienne, où la fusion avec le monde désorganise, trompe les sens et falsifie la vérité. L’effondrement des frontières, sous l’assaut des passions, ne pouvant conduire qu’à l’illusion et au désordre. Sans jamais le nommer ainsi, le travail d’acceptation des émotions prôné par les TCC ressemble pourtant à s’y méprendre à une tentative de rationalisation de celles-ci. En produisant un cadrage émotionnel, corporel et psychique, qui réaffirme le clivage binaire entre la connaissance et le sensible (charriant avec lui des dichotomies standardisées et toujours opérantes : raison/émotion ; illusion/vérité ; interiorité/exteriorité ; nature/culture ; contrôle/débordement, etc.), le moment thérapeutique devient le lieu de la ratification de la délimitation du sujet, et de son périmètre de travail en tant qu’agent d’une rationalité à recouvrir.
Plus sûrement, il semble que cette naturalisation d’un état émotionnel premier, qui serait façonné et érodé ensuite par l’environnement, évacue complètement le fait que les émotions ont aussi un rôle clé dans l’apprentissage des normes émotionnelles. Lorsque, enfants, nous apprenons le dégoût ou la joie, nous apprenons en premier lieu une façon adéquate de ressentir, puis d’exprimer et nommer ces ressentis dans le cadre d’une interaction sociale codifiée et ritualisée. Pour le dire avec James Averill (1986), important représentant du constructivisme social, les émotions, en tant que pratiques comportementales complexes, correspondent à des « rôles sociaux transitoires » qui se manifestent comme des réponses socialement prescrites à des attentes socialement partagées. Cette éducation à l’émotion et son expression appropriée, Averill l’analyse comme une heuristique de l’émotion, où chaque apprentissage permet de qualifier un ressenti tout en incorporant les règles de savoir-vivre qui s’y rattachent.
Nous apprenons par exemple à performer le dégoût pour un aliment en faisant la moue, en tirant la langue ou, une fois le langage acquis, en disant « beurk », « je n’aime pas ». Néanmoins nous serons éduqué·es par la suite à contenir cette expression car il est inapproprié, passé un certain âge, de manifester ostensiblement le rejet (comme recracher dans son assiette, toléré pour un bébé). Il n’est d’ailleurs pas si rare de découvrir à l’âge adulte que notre aversion si marquée pour les épinards ou le poisson n’est plus présente, rassuré·es par le lieu commun selon lequel nos goûts évoluent et s’affinent avec le temps. De la même façon, l’apprentissage de la norme amoureuse hétérosexuelle se forge très tôt, dès que des moments de tendresse entre enfants (de genres opposés bien évidemment) sont scriptés par les adultes comme révélateurs des premiers émois — « c’est son petit amoureux/sa petite amoureuse » (Diter, 2023). Il y aurait donc l’amour sous sa forme la plus pure, et des individus vers qui on le dirige, l’environnement adulte ici ne servant qu’à nommer objectivement ces élans, leur qualification étant exempts de tout biais. Ainsi, se construit par causalité d’autres affects, comme la peur ou la honte, qui viendront dire par la négative ce que n’est pas l’amour, au motif que celui-ci n’est pas dirigé vers les personnes identifiées pour en être logiquement les destinataires, ou qu’il n’est pas convenablement éprouvé. Littéralement, le sentiment amoureux est dis-qualifié lorsqu’il ne répond plus à un attendu implicite. Peut alors lui succéder une requalification en termes d’embarras voire de honte, qui, comme le rappelle à juste titre le sociologue et philosophe Didier Éribon, « n’est pas un sentiment individuel et psychologique mais une structure sociale d’infériorisation24 ».
L’heuristique de la honte nous apprend à nous taire, à nous terrer, tout en désignant les circonstances précises dans lesquelles elle est appelée. Dans tel contexte, tu devrais avoir honte, et celle-ci devrait s’exprimer de telle façon. Pourtant, comme le souligne la philosophe Vinciane Despret, en faisant cela les adultes apprennent aux enfants une caractéristique essentielle de l’émotion : « la possibilité qu’elles (les émotions) peuvent être transformées, et qu’elles peuvent transformer le rapport au monde. Ce sont les rapports au monde qui [seront] alors négociés » (2001, p. 292).
Jouer en profondeur, négocier son rapport au monde
Il y a quelques années, lorsque j’ai cessé de boire, de consommer des drogues et que j’ai été sevrée de tous les traitements chimiques de soutien et de substitution pris pendant plus d’une décennie, je me suis retrouvée confrontée à un panel de nouvelles sensations indénombrables. Sur le moment, j’avais été rassurée par le caractère apparemment « normal » (une fois n’est pas coutume) de mon ressenti, puisque m’a-t-on dit, c’est ainsi que débute le chemin du rétablissement, jalonné en partie par la gestion de ce trop-plein envahissant. Pourtant, l’horizon de ce rétablissement, qui écume sans même s’en rendre compte les tropes les plus éculés, se formule à l’aune d’objectifs à atteindre, d’un projet de vie à construire associé à l’espoir débordant que celui-ci, en nous plaçant comme acteur·ice central·e, saura nous conduire vers le bien-être et la réalisation de soi (Linder, 2023). Or à cette époque, j’avais déjà bien trop travaillé les enjeux de l’expansion du néolibéralisme sur nos corps et nos affects, pour ne pas y voir clairement l’incitation au retour à une vie active et productive, rentable donc, et économiquement viable. J’ai alors souvenir que c’est à cet endroit précis que ce sont cristallisées toutes mes contradictions. Je venais d’achever mon premier article scientifique, qui analyse la façon dont la puissance néolibérale s’empare de nos vies, s’assurant que l’individu reproduise de lui-même et en lui-même les rapports de domination, tout en devenant simultanément la meilleure autogestionnaire de mon existence, l’auto patiente-experte de mon propre parcours.
Je sais désormais reconnaître mes émotions, les accueillir, les endiguer ou accompagner le mouvement. J’identifie les situations qui m’insécurisent, évite les relations qui me fragilisent. J’ai appris à renégocier mes rapports au monde pour qu’ils me soient plus profitables, moins violents, ou plus sûrement pour qu’ils s’assainissent et rendent plus acceptables les interactions qui s’y jouent. En toute honnêteté, je ne peux qu’admettre que cette connaissance intime de moi m’apaise, qu’elle me libère et me consolide, l’actuelle stabilité qui soutient mon quotidien m’offrant évidemment de nouvelles et prometteuses perspectives de vie (commençant par la vie elle-même). Pourtant, l’idée que je dois en grande partie cette relative tranquillité matérielle et psychique à la renormalisation émotionnelle et comportementale dont j’ai fait l’objet, fait ressurgir en moi l’ambivalence première. J’ai été frontiérisée. J’ai retracé les limites du moi en m’imposant la redéfinition d’un périmètre d’expression circonscrit, de ce qui doit être contenu et de ce qui a la permission de déborder, comment, avec qui et dans quelles circonstances. J’ai redressé des digues pour me rendre infranchissable, à moi-même et aux autres, pour redevenir Sujet et colmater les multiples effractions. Mais c’est seulement une fois le chantier achevé que j’ai compris que ces remparts n’avaient jamais existé auparavant, qu’au lieu de reconstruire j’ai en réalité bâti tout autre chose. J’avais toujours été un débordement. En voulant me réparer j’ai fait mentir mon monde.
Conformément à ce que Arlie Hochschild nomme « travail émotionnel » (emotion labor) j’ai pu, appuyée notamment par les outils de la troisième vague des TCC, transformer mes émotions pour en faire advenir d’autres. Dans son ouvrage Le prix des sentiments. Au cœur du travail émotionnel, la sociologue américaine souligne que « la malléabilité des sentiments et leur adaptabilité à des techniques de remodelage paraissent évidentes. La gestion même des émotions peut être vue comme constituante de ces émotions » (Hochschild, 2017, p. 49). À l’issue de sa recherche, celle-ci distingue deux grands types d’actions sur les émotions. D’un côté, la gestion émotionnelle (emotion work/emotion management25) propre à toute vie sociale, qui s’exprime dans nos interactions quotidiennes, avec pour objectif de produire et réguler nos émotions afin qu’elles soient conformes aux valeurs impliquées dans la situation. C’est par exemple le fait de performer la tristesse (ou ne pas se montrer trop joyeux·ses) à des funérailles alors même que nous ne sommes pas affecté·es, ou encore de rire à une plaisanterie si le reste du groupe s’y montre sensible, ou pour ne pas froisser la personne l’ayant racontée. D’autre part, il y a le travail émotionnel (emotion labor) qui, s’il est également un effort personnel de production d’une émotion appropriée à un contexte donné, est surtout le fruit d’une prescription organisationnelle (dans le cadre d’un travail salarié) inscrit dans une économie de service, et soumis au contrôle d’un·e employeur·e. Pour le dire autrement, il s’agit de modifier ses propres émotions pour pouvoir agir sur les émotions des autres. En cela — et Hochschild mobilise un vocabulaire marxiste pour énoncer la distinction — la gestion émotionnelle n’aurait qu’une valeur d’usage au service d’une mise en scène de la vie quotidienne26, là où le travail émotionnel constitue une valeur d’échange très prisée dans le monde du travail, notamment dans le secteur du service à la personne.
Lors de son enquête auprès du personnel de bord de la Delta Airline, la sociologue a analysé la manière dont les hôtesses de l’air doivent, d’une part, faire montre d’une déférence et d’un visage souriant en toute circonstance et, d’autre part, gérer des relations parfois difficiles avec les passagers, considérés en premier lieu comme des clients de la compagnie ayant payé une prestation de service. C’est ainsi qu’à partir du concept de « jeu en profondeur » emprunté au metteur en scène russe Constantin Stanislavski, elle dresse le constat suivant : plutôt que feindre en surface des émotions, ce qui crée à termes une multiplicité de situations dissonantes entre ce que l’on simule superficiellement et ce que l’on ressent réellement, il est plus opérant de prendre « le contrôle des leviers de production de ses sentiments [puisqu’] en simulant profondément, elle (l’hôtesse) se transforme elle-même » (Hochschild, 2017, p. 65). Ainsi, comme le recommande les formateur·ices de la compagnie, le plus simple et le plus efficace consiste donc à se convaincre soi-même que l’émotion performée est réelle, amenant l’hôtesse, via différentes techniques, à inscrire si profondément cette émotion en elle qu’elle pourra la ressentir vraiment (Hochschild, 2017).
Les différents leviers du travail émotionnel décris par Hochschild sont en écho direct avec certains outils proposés par les TCC, en ce qu’ils reposent notamment sur la mobilisation de souvenirs antérieurs permettant d’en rescripter le contenu émotionnel. Un parallèle des plus frappant concerne l’exercice dit des « colonnes de Beck », outil majeur des TCC de deuxième vague, que j’ai moi-même réalisé à plusieurs reprises dans un cadre (sensément) thérapeutique puis de nouveau pour mes recherches. S’il existe quelques variations, la trame socle de l’exercice, pensé comme un outil d’autogestion de ses émotions, se présente en différentes colonnes (au minimum trois et pouvant aller jusqu’à cinq ou six) dessinées sur une feuille et portant les en-têtes suivants : situation (ce que je fais), émotion (ce que je ressens), pensée automatique (ce que je me dis), pensée rationnelle/alternative (ce que je pourrais me dire). Il s’agit de remplir les trois premières colonnes à partir de situations réelles passées en essayant d’être le·a plus fidèle possible à ses ressentis sur le moment, puis d’utiliser la dernière colonne pour tenter d’imaginer ce qu’aurait pu être une façon alternative, plus rationnelle, de réagir à l’événement décrit. La dernière colonne présente un intérêt particulier puisqu’elle incarne le lieu où est rendu possible la métamorphose des cognitions. Elle nous invite à changer de regard sur une situation pour en amoindrir l’impact émotionnel, perçu comme excédentaire, et responsable en conséquence d’une réaction comportementale disproportionnée et inappropriée.
De façon tout à fait analogue, l’une des hôtesses de l’air interrogée par Hochschild explique comment, lorsqu’elle est confrontée à un passager vulgaire, violent ou trop exigeant, elle convoque dans son esprit une lecture alternative de la scène, dans le but de rationaliser sa colère et l’injustice qu’elle ressent, et pouvoir continuer à le servir sans trop souffrir de dissonance. En « faisant comme si un événement traumatique était survenu dans [la] vie (du passager) » (2017, p. 55) elle désamorce sa propre colère, ne le percevant plus comme un homme injurieux et dangereux mais comme une personne en souffrance, un être vulnérable ne sachant pas exprimer sa douleur et dont il faudrait prendre soin. En opérant en son for intérieur et en direct une requalification de son émotion — via ses cognitions —, elle transforme sa colère en pitié voire en empathie, modifie presque instantanément son attitude, et obtient en retour une transformation de l’humeur du passager qui, adouci par une hôtesse restée souriante malgré la maltraitance, réajuste à son tour son comportement. Ces techniques de « désensibilisation à la colère » et de « réduction du stress » ont été mis en avant par la Delta Airline comme des éléments de prévention et de protection, tout en ne précisant jamais de « qui, de l’employé ou de l’entreprise, est ainsi le mieux “protégé” » (Hochschild, 2017, p. 61).
Par comparaison, l’interrogation m’interpelle car il me semble que c’est ce qui est globalement attendu de chacun·e d’entre nous, que cette capacité à agir sur ses propres émotions pour préserver l’ordre social et ses conventions (bourgeoises) apparaît comme un apprentissage obligatoire. Et que cet apprentissage, s’il a manqué ou fauté à un moment de notre construction, peut prendre les traits d’une éducation thérapeutique plus tardive, dont on dira qu’elle est un processus de guérison, la maturité d’un·e adulte sain·e ou un empuissancement salvateur. Pour les gens comme moi, invitées émérites du bal des folles, on dira que c’est un levier de stabilité, la possibilité d’avoir une vie normale, moins intense, moins douloureuse, plus apaisée, plus calme. Mais plus calme pour qui ? Pour qui ne suis-je plus un danger ?
Soigner les émotions, guérir son enfant intérieur
Ivan Garrec, dont j’ai déjà cité le travail de thèse, formule à la suite de son enquête de terrain des constats rejoignant mes intuitions. Lors d’une ethnographie dans un hôpital de jour (HDJ) spécialisé dans les troubles de la personnalité borderline au sein duquel il a effectué entretiens et observation participante, Garrec assiste à la réalisation encadrée d’une version de ces fameuses « colonnes de Beck ». Dans le cas présent, l’exercice n’est pas explicitement nommé ainsi et travaille davantage sur les comportements que sur les cognitions, les colonnes « réactions primaires » et « actions constructives » se substituant aux « pensée automatique » et « pensée rationnelle » de mon exemple personnel. La mécanique de remodelage n’en reste pas moins exactement identique, et la méthodologie employée (rationaliser une impulsion non contrôlée) rigoureusement la même. Il en relate ainsi le déroulé : Anne-Lise, psychologue de l’HDJ mène la discussion à partir des colonnes remplies par deux patientes, ou figurent les termes d’« injustice » et d’« oppression » menant à des réactions primaires d’« attaque » ou d’« agressivité ». Au sujet de ces réactions, la psychologue leur explique le fonctionnement du cerveau reptilien et la façon dont il intervient « en mode réflexe et qui demande moins d’énergie » (Garrec, 2024b). Dans la suite de la retranscription, le sociologue indique que :
Lorsqu’il est question des actions « constructives », Anne-Lise explique que l’action constructive face à la colère consiste à rétablir ses « droits », à travers l’expression d’une demande de « changement ». Il apparaît ici que la psychologue réalise un travail normatif en explicitant ce que devrait être une réaction « saine » et « légitime » face à un sentiment de colère. Anne-Lise explique ainsi qu’il est impossible de demander un changement ou un rétablissement de ses droits lorsque l’on crie ou que l’on s’exprime mal : « Je ne peux pas rétablir mes droits et demander à l’autre de changer si je suis agressif » (Anne-Lise). (Garrec, 2024a, p. 146).
Un point qui ressort de façon très claire dans cet extrait, et qui me semble central car l’une des difficultés de l’analyse critique se situe là, c’est que ce qui est source de souffrance pour ces patientes est précisément ce qui fait défaut dans la conformation aux attentes sociales. Je l’ai ébauché en amont, il est toujours épineux de démêler « qui de l’œuf ou de la poule », ces attentes sociales (et leur manquement) étant incorporées simultanément à l’apprentissage de leur expression. Audrey Linder, également sociologue de la santé mentale et ayant travaillé sur le rétablissement, exprime clairement dans sa thèse cette difficulté d’apporter un éclairage critique sur des pratiques qui engagent personnellement les individus. Elle constate « qu’il n’est pas évident de critiquer le Récit de Rétablissement au travers de l’analyse d’un récit individuel sans paraître cynique et sans sembler remettre en cause le vécu du “rétablissement” » (Linder, 2023). Aussi, si dans le passage retranscrit le travail de redéfinition des comportements et le recadrage normatif effectués par la psychologue sont flagrants, il n’en reste pas moins toujours délicat de pointer le problème socio-politique que pose cette intention thérapeutique. Avec une implacable clarté, Garrec en propose la lecture suivante :
Ce travail engendre également ce que l’on peut nommer comme étant une forme de dépolitisation correspondant à une euphémisation de la conflictualité et une individualisation des difficultés (Comby, 2014). De l’injustice et l’oppression, la discussion a été réorientée sur des droits non respectées. Ainsi, dans le discours de la psychologue, le niveau où se situe les difficultés est celui de la « relation interpersonnelle », entre deux individualités en interaction où les enjeux sociaux et politiques ne semblent pas pouvoir être abordés. La gestion de la colère passe ainsi avant tout par une demande de changement, qui doit se faire en respectant les règles régissant les rites d’interaction (Goffman 1974). (Garrec, 2024a, p. 146)
Dans la suite de cet atelier, le recadrage se poursuit toujours sous un format très scolaire (présupposant par ailleurs un capital culturel dont disposent en premier lieu les classes moyennes et supérieures blanches et éduquées27), en dépit du souhait revendiqué d’un échange libre et horizontal. Julie et Anne-Lise (les deux psychologues qui animent la séance) vont tour à tour dispenser des leçons, sous forme d’explicitations, sur les émotions ressenties, leurs qualifications et leurs gestions. Une distinction fondamentale est effectuée de prime abord entre les émotions, présentes en chacun·e de nous et donc naturelles (le fond), et la façon de les exprimer (la forme). Si les émotions nous appartiennent et vont être continuellement ratifiées via des formules de validation également très usitées dans le développement personnel (il « est ok » de ressentir cela, cela a une signification, un sens et nous devons nous y tenir à l’écoute), la manière adéquate de les éprouver semble devoir se ranger du côté d’une rationalité attribuée aux adultes. En cela, ce modèle thérapeutique colle parfaitement avec les grilles de lecture psychiatriques et psychopathologiques associant bien souvent troubles émotionnels et immaturité. Largement perçues comme ayant des « comportements adolescents » (Garrec, 2024b), ces patientes sont invitées à interpeller la part saine en elles (c’est-à-dire adulte, mature et rationnelle), en entamant un dialogue intérieur avec les parties brisées, traumatisées, toujours hurlantes et donc incapables de maîtrise au cours d’interactions sociales ou dans l’espace public.
Notion cardinale de la thérapie des schémas28 — thérapie apparentée en pratique aux TCC de deuxième vague, au moment de sa création, et très utilisée pour traiter les troubles de la personnalité du groupe B — (Young, 2005), la figure de l’« enfant intérieur » porte en elle tous les enjeux de la domination adulte (Mozziconacci et al., 2023 ; Piterbraut-Merx, 2024), en reproduisant ces procédés de renormalisation à partir des émotions du petit enfant toujours en nous. Dans la thérapie des schémas, le rapport à la temporalité est particulier et révélateur car pour avoir accès à l’enfant, il faut nécessairement passer par l’adulte, qu’il soit parent punitif ou adulte sain (l’idée étant de renforcer le mode adulte sain29). Sans aucune ambiguïté, les manuels pratiques à destination des praticien·nes rappellent que « le Mode Adulte Sain est celui qui se comporte de façon adaptée au travail, en tant que parent, en tant qu’adulte responsable ; qui sait se distraire, avoir des activités intellectuelles, culturelles, sportives, relationnelles, sexuelles, esthétiques et sait prendre soin de sa santé. C’est le sujet normal […] » (Pascal, 2015). Pour le dire autrement, il s’agit ici d’effectuer une forme de « reparentage » (Young, 2005), sorte de jeux de rôles au sein duquel cet·te adulte sain·e, modelé en partie par le·a thérapeute, fera fonction de référent adulte émotionnellement stable et sécurisant pour notre enfant intérieur (nommé Mode Enfant Vulnérable), l’objectif final visé étant la capacité à se rassurer seul·e en faisant dialoguer ces différentes parties. Il s’agit donc d’être pour soi-même le ou les parents sains et aimants qui nous auraient fait défaut dans notre enfance. En clair, il est question d’auto-éduquer notre partie souffrante d’enfant comme un « bon parent » devrait le faire, en calquant ses préceptes sur les éléments apportés en séances par le·a soignant·e, éléments dont nous avons vu qu’ils permettent la conformation à des attentes sociales structurantes et particulièrement contraignantes.
Cet exemple me saisit à au moins deux endroits ; d’une part, je crois qu’il est important d’interroger le fait que ce modèle thérapeutique repose en réalité sur la reproduction volontaire d’un schéma de domination adulte-enfant où, comme l’avait déjà finement analysé le philosophe Tal Piterbraut-Merx « on n’échappe pas à cette idée que l’enfant est un être qu’il faudrait façonner par l’éducation » (Piterbraut-Merx, 2021). Lorsque je dis volontaire, je n’indique pas nécessairement une volonté individuelle active et consciente de dominer les enfants, en nous et hors de nous. Je pointe un angle mort dans l’analyse des rapports de domination systémiques (et c’était le sujet de thèse de Tal30), la parentalité et la famille traditionnelle constituant l’espace privilégié d’assujettissement des êtres les plus vulnérables, sous couvert de dépendance et d’éducation. D’autre part, et pour rejoindre l’analyse effectuée par Ivan Garrec, ce procédé d’auto-réparation médiée ne mobilise à aucun moment la revendication, la mobilisation ou la lutte sociale pour les droits qui ont été bafoués. Il ne se situe qu’au niveau individuel et intrapsychique, ce fameux noyau dur interne qui nous constituerait en tant que Sujet. Aucun pont, aucune passerelle n’est faite avec la possibilité d’une demande de réparation au plan politique31, alors même que l’écrasante majorité de la clinique reconnaît elle-même l’origine des troubles de la personnalité (notamment ceux du groupe B) dans la maltraitance intrafamiliale, les violences physiques, sexuelles et psychologiques ou l’inceste.
En définitive, sont reproduits simultanément et à plusieurs niveaux non seulement des schémas ancrés de domination, mais également des façons stéréotypées, réductrices et totalement dépolitisées d’y répondre. En naturalisant et psychologisant des comportements produits par des rapports sociaux de pouvoir totalement passés sous silence dans les soins psychiques, l’accent est mis sur les ressources individuelles permettant un apaisement de soi décorrélé de toute revendication pour l’émancipation politique. En reproduisant à l’infini des clivages binaires erronés et vides de sens, le moment thérapeutique nous invite à admettre que de telles frontières existent sans aucune porosité, qu’il y aurait le temps de la réparation subjective puis, en seconde instance si et seulement si (on a les ressources, l’envie, l’énergie, etc.) celui de la revendication, de l’activisme, ou de formes de vies nécessitant de laisser de nouveau déborder quelque chose de nous. Nous n’aurions le droit de nous laisser envahir que si nous prouvons être en mesure de pouvoir nous contrôler. C’est ainsi — et seulement ainsi — que notre existence est tolérée. Enfin, ces normes psychothérapeutiques rendent compte de l’extrême pauvreté de nos intentions envers nous-mêmes, à l’endroit de ce que prendre soin peut évoquer pourtant de façon si puissante et réparatrice. Il nous faut attentivement et affectivement prendre soin de nos ennemis intérieurs, non pour les éduquer en les dominant, mais parce qu’ils nous indiquent qui nous sommes collectivement, et de quelles luttes nos existences sont le véritable enjeu.
Conclusion : se rétablir sur la norme, esquisses d’une existence liminaire
En apprenant à rationaliser mes pensées, provoquant in fine de nouvelles émotions en moi (en « performant-intériorisant » dirait Aurélie Jeantet, 2021), je reconnais donc expérimenter une toute nouvelle façon de m’inscrire dans le monde, d’exister et de relationner dans le social. Je découvre que le rapport à l’Autre, à moi-même et à certaines institutions peut être moins conflictuel, et que toute tension saurait, dans une certaine mesure, être désamorcée. Il m’apparaît clairement que prendre du recul sur certaines situations permets la plupart du temps de les appréhender différemment, et parfois pour le mieux. En outre ma grille de lecture, en tant que philosophe et chercheuse en mad studies, n’est pas de m’interroger sur le caractère probant de ces démarches thérapeutiques. Il semble par ailleurs qu’elles montrent de plutôt bons résultats, en atteste l’expérience des patientes de l’HDJ, la mienne, et bien d’autres encore largement documentées. Ce qui m’intéresse, hormis le fait que je règle sans nul doute des souffrances intimes, c’est surtout de comprendre quelle structuration politique, quel régime rend possible et désirable un mode d’autogouvernance aussi aliénant, via un travail consenti et une autogestion de nos affects.
Car en admettant que les règles formelles soutenant une institution déterminent le cadre de la palette émotionnelle qui y seront appliquées (Hochschild, 2017), identifier mes propres émotions, plus qu’un travail individuel et thérapeutique, constitue une voie d’accès privilégiée à la superstructure socio-économique qui nous entoure et nous constitue. Si je ne peux substituer une analyse critique du pouvoir et des dominations à mes tensions internes et mes ambivalences constitutives, je les fais coexister en me tenant sur la brèche, en restant sur le seuil. Je ne suis pas rentrée dans la norme mais me tiens en équilibre sur elle. Je ne franchis aucune frontière, je suis la frontière. Je stagne dans l’interstice entre vouloir et pouvoir, entre hors-normalité et renormalisation. Ainsi, je garde à l’esprit que « l’émotion est un mode d’intériorisation de l’ordre social, elle est non seulement ce qui fonde le social, mais aussi ce qui pourrait le compromettre, mais dont le social assure la gestion et l’inhibition » (Despret, 2001, p. 229).
Il est donc toujours temps de se compromettre.
Conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêt déclaré.