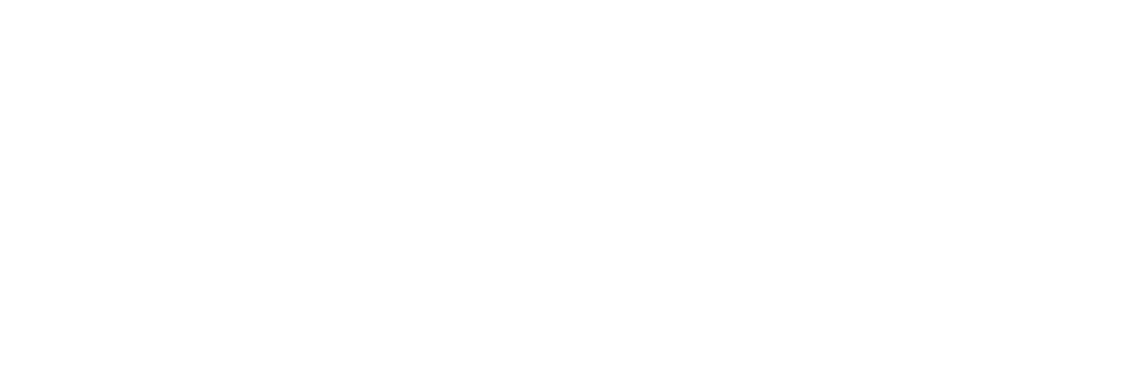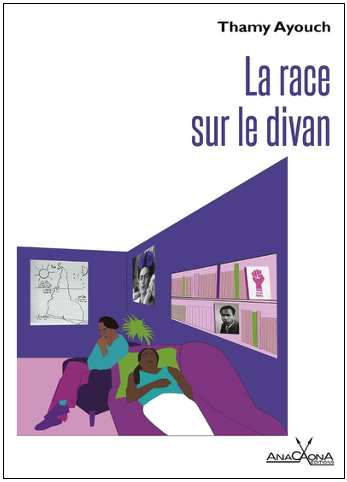
Une histoire d’âmour ?
J’aime Thamy Ayouch depuis longtemps1. J’ai eu l’occasion de lui déclarer ma flamme — intellectuelle, clinique et politique — à plusieurs reprises, en public comme en privé. Je profite de l’occasion qui m’est ici donnée pour la renouveler. Je sais que, lui comme moi, rêvons parfois d’être des âmes jumelles.
Le dernier livre de Thamy est polémique à plus d’un titre. Il souhaite aborder les questions raciales et post-coloniales en psychanalyste. Il y tord volontairement l’intime et le politique, la métapsychologie et la race, l’engagement dans la pratique psychanalytique et dans la lutte sociale.
À priori, les lignes qui suivent ne pourraient tenter salto plus risqué : un compte-rendu partial à propos d’un livre engagé. On me reprochera mon manque d’objectivité. On dira de Thamy qu’il a confondu psychanalyse et sociologie. On taxera la proximité qui nous lie de vilain narcissisme des petites différences : une méchante colère contre nos pères/paires, une bruyante promiscuité wokiste qu’il vaudrait mieux faire taire pour revenir au sérieux caractéristique du divan. On nous priera de cesser nos petits jeux en miroir, nos bravades alambiquées et nos critiques de premiers de la classe. On nous enjoindra de nous taire et de retourner nous allonger chacun de son côté… Bref, les reproches pleuvront de toutes parts… Qu’ils pleuvent ! Les sols psychanalytiques ont tellement besoin d’être irrigués !
Situer les résistances
La race sur le divan (Ayouch, 2024) s’avance, d’abord et avant tout, comme un livre situé. Son auteur est lui-même impliqué, racisé, déplacé, immigré, enragé, minorisé. À la fois sujet et objet de l’enquête, les tonalités de sa langue sont celles de celui qui a vécu, de celui qui a voyagé, de celui qui a rencontré des langues et des pays, mais de celui aussi qui a pleuré, qui a souffert, qui a été humilié, moqué, silencié parce que moins conforme, parce que trop visible, parce que différent. Par ailleurs, son contenu prend acte de l’histoire : celle au long cours, comme la plus actuelle. À quel moment socio-politique est apparue l’épistémologie psychanalytique si ce n’est celui du triomphe des colonies ? Quelles accointances le sujet de l’inconscient entretient-il avec un savoir toujours déjà en train d’opprimer au nom d’un sujet universel dont la Raison s’affirme avec une certitude méprisant les altérités de race, de classe ou de genre ? Dans quelle mesure les déclarations de principe, niant l’existence de toute race au nom de l’universelle condition humaine, continuent-elles aujourd’hui encore d’entériner un racisme systémique, soit : des relations de forces, de discrimination, d’exploitation qui dépendent moins de la volonté d’individus que d’un ordre — rarement interrogé — organisant les rapports politiques, sociaux, administratifs… ? En outre, l’ouvrage vaut comme une sorte de réponse aux récentes prises de position psychanalytiques se prémunissant contre tout changement, et dans l’exercice et dans la réflexion, face à l’entrée des théories post-coloniales, queers et intersectionnelles dans le champ de la pensée quant aux corps et aux sexualités.
Depuis sa construction même La race sur le divan déploie ainsi une fresque spatio-temporelle au plus près de ce qui est longtemps resté hors-champ et qui fait pourtant brusquement retour sur le devant de la scène. Le livre interroge un impensé — la race — qui, une fois aperçu, s’impose avec urgence et nécessité pour recomposer passé, présent et futur. Pareille trajectoire de pensée, pareil mouvement tordu, pareille attention à ce qui a priori pouvait sembler secondaire s’avère, en réalité, au plus proche du geste freudien : s’intéresser à ce qui a été refoulé, à ce qui jusque-là n’avait pas été entendu, à ce qui semble a priori secondaire permet de reconfigurer et déplacer ce qui se pensait être le centre.
Les couleurs de l’inconscient
Face aux conservatismes théorico-cliniques, Thamy choisit d’arpenter les terres de l’inconscient à contre-courant, depuis une lecture profane, rétive. Il décale les rêves, les lapsus, les actes manqués et les symptômes au-delà des confortables frontières d’un familialisme blanc, bourgeois et hétérocentré. Il décadre les concepts et les lois métapsychologiques depuis les marges. Il décentre les certitudes cliniques vers le Sud Global. Il tonne : « Quelles sont les couleurs de l’Œdipe ? » ; « Aux yeux de qui comptent la castration et le phallus ? » ; « Quelle pigmentation cachent les anamnèses et les diagnostics qui s’abattent comme des jugements absolus ? ». Il dévoile au cœur de la praxis ce que dissimulent les meilleures intentions et les pires convenances : le silence policé, l’incontournable neutralité, la bienveillance de façade, l’universel catégorique. Tantôt avec lucidité, tantôt avec colère, tantôt encore avec drôlerie, toujours avec tact et érudition, Thamy indique comment l’épistémologie psychanalytique court toujours le risque de se draper du voile d’une « blanchité » intellectuelle. Thamy explique : « On pourrait alors définir la blanchité comme une opération discursive procédant à l’élimination de tout autre discursivité qui n’obéit pas à son idéal d’universalisme, un positionnement où le sujet s’affirme garant moral d’un ordre universaliste, occultant ainsi tous les aléas auxquels les sujets racisés sont confrontés » (Ayouch, 2024, p. 181). Faute d’être retouché, chiffonné ou reteint un tel voile finit toujours par étouffer les mouvements et les devenirs que rendent possibles la libido et les pulsions. Le châle immaculé de l’analyste menace toujours de boucher ses oreilles ou de bâillonner les bouches de certain.es analysant·es sur le divan.
Concrètement, le mouvement opéré par l’ouvrage va dans deux sens à la fois et pose une question clinique fondamentale : « comment entendre ? ». A l’heure de la globalisation, des exodes, des migrations et de la résurgence des fascismes, pareille question résonne avec une urgence toujours plus forte. D’un côté, Thamy se demande comment prêter oreille aux personnes racisées, à la spécificité de leur trajectoire de vie ? Comment interpréter le vécu de tout·es celleux qui ont rencontré un Autre a priori discriminant, oppressant, injuste, voire hostile, menaçant, mutilant, cruel ? De l’autre, à partir de cette question technique concrète, Thamy déplie une interrogation métapsychologique tout aussi fondamentale que révolutionnaire : quel statut donner au transfert et au rapport à l’Autre dans le cadre des cures psychanalytiques ? Y va-t-il d’un simple jeu structural, d’un strict positionnement langagier, d’un ordre symbolique intangible, de combinatoires signifiantes visant chacun·e de la même manière ou, tout au contraire, certain.es d’entre nous entretiennent-ils et elles des places, un lien au langage, un rapport à l’Autre toujours-déjà déclassé, opprimé, marginal ? Dans quelle mesure celles et ceux qui vivent l’expérience du racisme, de près comme de loin, n’entretiennent-ils pas — avant même d’avoir pu apprendre à parler, à se dire, à faire avec l’Autre, avant même d’avoir rencontré le trauma de l’insulte ou de l’exclusion —, un rapport que l’on pourrait qualifier avec Deleuze et Guattari de « mineur » avec l’inconscient ?
Dans leur livre sur Kafka, les deux auteurs écrivaient : « Combien de gens aujourd’hui vivent dans une langue qui n’est pas la leur ? Ou bien ne connaissent même plus la leur, ou pas encore, et connaissent mal la langue majeure dont ils sont forcés de se servir ? Problème des immigrés, et surtout de leurs enfants. Problème des minorités. Problème d’une littérature mineure, mais aussi pour nous tous : comment arracher à sa propre langue une littérature mineure, capable de creuser le langage, et de le faire filer suivant une ligne révolutionnaire sobre ? Comment devenir le nomade et l’immigré et le tzigane de sa propre langue ? » (Deleuze et Guattari, 1975, p. 35).
Qu’on prenne les choses sur le versant technique comme sur le versant métapsychologique, il s’agit donc, à suivre Thamy, de minoriser la psychanalyse, soit : d’entrainer ses expériences et les concepts qui en découlent vers une ligne de fuite révolutionnaire. Fuir ne signifie pas ici abandonner l’héritage de Freud et de Lacan mais en percer les relents conservateurs, les impasses liées à des époques qui percevaient l’occident comme l’alpha et l’oméga de toute civilisation, forer leur universalisme majoritaire jusqu’à le réoxygéner.
Aussi, Thamy ne réduit-il jamais le racisme à l’individu. Même si la situation peut prendre cette forme, elle ne se rabat jamais comme une simple haine personnelle exercée envers quelqu’un·e d’autre. De la même manière Thamy n’envisage pas non plus la psychanalyse à partir de l’excuse rabâchée du réel du cas par cas, de l’intimité strictement privée du sujet, de l’unicité de chaque vie vécue. Les mouvements d’amour comme de haine ne s’expliquent pas seulement depuis le petit pré carré du Moi. Ils passent par l’histoire, les continents, les technologies et les discours qui nous façonnent. Au plus près des mouvements économico-politiques, main dans la main avec un nombre impressionnant d’auteur·es non européen·es, Thamy déconstruit les relations de pouvoir à l’œuvre dans le racisme. Il montre comment, quand on se garde de les y débusquer, ce type de relations se rejoue inévitablement au sein même des cures. Il s’efforce de dépasser l’imaginaire racial et raciste pour en montrer les ressorts symboliques, systémiques, structurels. Autrement dit, en sortant la race de dessous le tapis, il indique comment la théorie psychanalytique (exception faite pour plusieurs auteur.es brésilien·nes que Thamy connaît à la perfection) a refoulé de ses propres procédés techniques et métapsychologiques des attitudes, des regards, des actes trahissant un a priori colonial.
Plein sud : déjouer notre histoire
L’enjeu est de taille : comment ne pas réduire l’espace analytique à un espace de reproduction de rapports hégémoniques ? Mais il ne s’agit pas seulement d’indiquer les erreurs, les manquements ou les limites de l’héritage freudo-lacanien au regard des déconstructions post-coloniales. Il s’agit de remanier cet héritage pour penser une métapsychologie du racisme et entraîner le sexuel infantile vers un racial infant. Bref, il s’agit de résister en psychanalyste, soit : reprendre en main les outils de Freud et de Lacan non seulement pour critiquer l’éventuel racisme psychanalytique mais raviver le travail avec l’inconscient depuis un horizon multiculturel, hybridé, métissé, afin d’entreprendre « l’historicisation des normes raciales de subjectivation, leur désontologisation, et la possibilité pour le sujet d’y circuler avec davantage de fluidité » (Ayouch, 2024, p. 187). D’un côté, Thamy reprend à son compte le modèle du genre mis au point par Judith Butler : les occidentaux, dès les premières conquêtes coloniales, ont performé quelque chose de l’ordre d’une « mélancolie de la race ». Il précise : « Si, dans la mélancolie de genre, l’ordre hétéronormatif a longtemps invisibilisé les corps queers pour fabriquer des corps genrés, dans la mélancolie de race, la blanchité hégémonique ne fait pas disparaitre socialement les corps racisés mais les classes et les subordonne à l’idéal blanc, fabriquant ainsi des corps glorieux et des corps honteux » (Ayouch, 2024, p. 185). En détournant ainsi Deuil et mélancolie de Freud par le biais du genre et de la race, Thamy s’autorise à inventer des formats de deuils inédits, capables de jouer avec les fantômes de la « folle » et du « noir », en mesure de saisir la relativité aussi bien de la matrice de la pensée occidentale que de son désir hétérocentré. Le colosse n’était qu’un géant aux pieds d’argiles ! Le faire tomber ne signifie pas abandonner l’inconscient ni la pratique psychanalytique mais renouveler les formes et les formats du transfert pour chaque cure et pour la discipline en général.
C’est, je crois, le tour de force du livre de mon ami Thamy. Il ne se limite pas à prendre en compte les compromissions inconscientes de la praxis avec une représentation du sujet de l’inconscient phallogocentrique (la plupart du temps pensée depuis la présence d’une parole structurée par les jeux d’une référence au phallus) ou leukologocentrique « où leukos renvoie à sa blanchité invisibilisée » (Ayouch, 2024, p. 186). Non, Thamy va plus loin. Il nous explique que culpabiliser ne sert à rien. À moins de garder un goût pour conserver les rapports de pouvoir tels quels, mauvaise conscience en plus. Mieux vaut assumer sa responsabilité. Ce qui revient à repérer la position imaginaire depuis laquelle on écoute. Ce qui signifie réfléchir le « transfert symbolique », pour reprendre une expression lacanienne, en jeu dans l’analyse. Dès lors, plusieurs questions s’imposent. De quelle manière fonctionne un régime de pouvoir dans la relation analayste/analysant·e ? Comment ne pas se fourvoyer dans une analyse du même par le même ? Comment préserver un registre de parole situé ailleurs que du côté de la simple reconnaissance ? Comment garder vivant les jeux des différences, des transversalités et des multiplicités sans reproduire la verticalité et les mécanismes de sulbalternisation ? Si le dispositif psychanalytique s’inscrit en plein dans le dispositif de la sexualité dont Foucault avait brillamment fait la genèse et si ce dispositif a comme corrélat des rapports de domination qui passent par la race, alors comment s’autoriser à continuer d’interpréter ? Comment prendre la parole et comment se taire dans la cadre d’une cure et comment transmettre les enjeux de la talking cure en dehors du cas par cas ? En fait, je crois que le livre de Thamy se demande comment devenir analyste au xxie siècle et comment le rester ? Comment amener la discipline à rester à la hauteur des reconfigurations qui traversent le monde contemporain ? À toutes ces problématiques, Thamy a décidé de ne jamais donner de réponse à sens unique : non pas parce qu’il ne serait pas en mesure de tenir sa démonstration, mais parce que celle-ci ne vaut qu’à condition de rester ouverte, suspendue, dans un perpétuel mouvement de déterritorialisation. S’élancent ainsi des chemins de traverse en mesure d’autoriser la pratique à se reformuler, à tenter cette expérience un peu folle de croire qu’entendre, dire et interpréter peuvent encore changer nos manières de répéter nos souffrances et d’inventer un peu de joie.
Vers la fin de son parcours Thamy cite Jean Genet : « Toucher aux choses, c’est toucher à la langue », dit le grand écrivain homosexuel, proche des Black panthers (1961/2002, p. 634). Le livre de Thamy ose toucher à un intouchable de la métapsychologie psychanalytique : la race. Non pas pour tout détruire. Non pas pour tout réinventer ex nihilo. Mais pour créer d’autres voies pour (se) dire, pour désirer et pour penser ce qui se joue au creux de nos angoisses et de nos rêves. En touchant à l’intouchable, Thamy invente des tactiques de lecture et d’écriture pleines du tact nécessaire pour se défendre, pour affronter l’injustice, pour contrer les oppressions, pour défaire les inégalités. Son livre redessine les contours du symbolique. Il politise le réel. Il reconnecte notre pratique centenaire avec les puissances les plus révolutionnaires de l’inconscient. Merci à toi, mon ami.