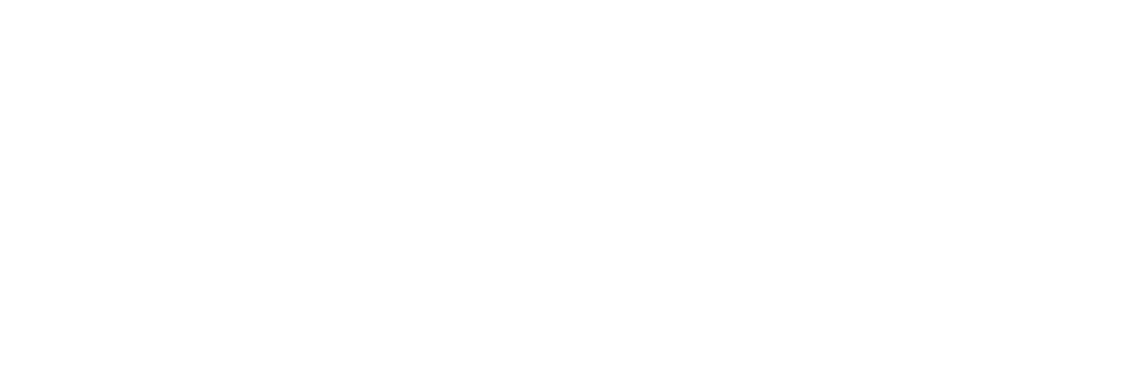A l’origine : le sadomasochisme
1886, Stuttgart : le Dr. Krafft-Ebing publie un ouvrage novateur intitulé Psychopathia Sexualis (Krafft-Ebing 1886), abordant pour la première fois des questions liées aux perversions sexuelles. Krafft-Ebing mène une recherche de paternité approfondie et attribue finalement les termes « sadisme » et « masochisme » aux noms de Sade et de Sacher-Masoch, respectivement.
Sur fond de répression sexuelle, d’émergence de la classe bourgeoise, de libération future des corps des femmes, puis de révolution numérique et de victoire du rat sur l’homme1, le sadomasochisme voit le jour.
« SADOMASOCHISME » : un nouveau mot fait son apparition dans les recherches sur la sexualité humaine ; comme d’habitude pour le domaine de la psychologie à la fin du siècle, le phénomène provient d’Allemagne et d’Autriche. Le concept se diffuse chez Havelock Ellis (1906), et chez Alfred Féré (1899), mais non chez Freud, contrairement à ce que l’on croit souvent. Freud (1915), quant à lui, maintient une attitude ambivalente : il perçoit une étrange affinité entre le plaisir d’infliger et celui de recevoir la douleur, sans toutefois valider pleinement le concept unifié de sadomasochisme.
Dans la célèbre préface accompagnant la publication de Le froid et le Cruel, Gilles Deleuze (1967) proteste contre l’idée qu’un investissement érotique commun de la douleur fonderait la complémentarité supposée entre sadisme et masochisme, justifiant ainsi l’usage du terme « sadomasochisme ». Le sort que lui a conféré la psychologie en construisant cette entité : SADOMASOCHISME, ce « monstre » épistémologique !
Point central de sa thèse : le masochisme n’est pas l’envers du sadisme. Il éjecte la figure du père, refuse la castration symbolique, et affirme que « la féminité est posée comme ne manquant de rien », que « la mère est investie du pouvoir symbolique de la loi » (Hart, 2003, p. 128). Ce pouvoir repose, selon Deleuze, sur la nature contractuelle du masochisme. Le contrat, loin de reproduire une autorité patriarcale, est conclu avec une femme — à son avantage — dans des termes qui consacrent son autorité symbolique. Le masochisme à la Sacher-Masoch devient alors une mise en scène inversée du pouvoir, où le cadre libéral du contrat permet de faire émerger une figure de femme souveraine.
En analysant les silences de Wanda chez Sacher-Masoch et la matérialité des corps souffrants, je défends une hypothèse : en parlant de partage des souffrances plutôt que de domination, s’ouvre un autre monde, un espace à part, comme le suggérait Deleuze à propos du masochisme. Ce faisant je soulignerai l’importance des affects pour penser les questions relatives à l’éthique. En effet, le destin de l’éthique est intrinsèquement lié à la prise de parole. Les mots prononcés ne sont pas seulement guidés par des idéaux de justice et de régulations sociales alternatives, mais aussi par des blessures, des traumatismes singuliers, des expériences enracinées profondément (Lippi et Maniglier, 2023).
Il s’agit donc d’écouter ce que les voix marginalisées ont à nous apprendre sur les limites du contrat pour penser le consentement. Ce faisant, je me baserai sur l’autobiographie d’Aurora von Rümelin, sa première femme qu’il épouse en 1873, et qui publie son autobiographie en 1906 sous le nom de Wanda von Sacher-Masoch. Cette relation est marquée par la domination et l’exploitation de Wanda. La relation avec Aurora/Wanda, sublimée dans l’incarnation de Wanda von Dunajew, l’héroïne de La Vénus à la fourrure (Sacher-Masoch, 1870), influencera magistralement cet ouvrage.
Cette autobiographie nous fait prendre conscience du paradoxe au cœur de l’analyse sur le masochisme : la partenaire masochiste, conçue dans la théorie de Deleuze comme une femme à qui « il ne manque rien », est en réalité coupée de l’expérience d’une femme — Wanda — qui manque de tout (capital économique, symbolique, culturel). Cette division entre théorie et expérience, le sujet et l’objet, le privé et le public est, pour Teresa de Lauretis, sémioticienne féministe, le paradoxe de la femme :
Le paradoxe de l’être qui est simultanément prisonnière et absente du discours, on en parle constamment mais elle est elle-même inaudible ou indicible, montrée comme spectacle et encore non représentée ou non représentable, invisible, pourtant constituée comme objet et garantie de la vision ; un être dont l’existence et la spécificité sont simultanément affirmées et reniées, niées et contrôlées. (de Lauretis 1990, p. 25)
Si nous prenons au sérieux l’adage féministe selon lequel « le personnel est politique » (Hanisch, 1970), alors nous devons saisir le paradoxe entre l’expérience de Wanda et la théorie de Deleuze (1967) sur le masochisme, car il met en valeur non seulement la manière dont l’homme masochiste construit la femme dominante, mais aussi l’absence de représentation du désir des femmes, concomitante avec le manque de représentation de leur parole.
Cette analyse met en valeur que penser l’éthique implique de dépasser le cadre du consentement, tel qu’il est souvent réduit à la transparence et à la communication. Le contrat masochiste, lorsqu’il est vidé des affects du corps et de sa matière sensible, devient insuffisant pour penser les luttes réelles des minorités sexuelles et sociales.
#MoiNonPlus. Sade : sexe, violence, cruauté et rébellion
La lecture de l’œuvre de Sade, telle que Les 120 journées de Sodome (Sade, 1953), incite souvent à étiqueter son comportement comme immoral et à le dépeindre comme un criminel pathologique. Pourtant, son œuvre stimule la réflexion sur la sexualité et l’éthique en mettant en lumière la violence qui est habituellement invisibilisée dans ces domaines. Sade, selon Bataille (1957), exhibe cette « part maudite » de l’humanité, et sa cruauté agit comme un cri d’alarme : il nous force à voir ce qu’est vraiment la vie en société. La violence est partout ! L’individu est continuellement contraint, par l’éducation qu’il a reçue, par les règles de vie communautaire, de respecter des principes qui vont à l’encontre de ses désirs naturels, de ses pulsions. Comme l’ont souligné Adorno et Horkheimer (1944), Sade révèle la logique brutale cachée derrière les idéaux des Lumières : une raison instrumentale qui justifie la domination. L’État s’impose à l’individu par la force et se perpétue à travers lui, mais il prend soin de la déguiser, de la dissimuler, de la camoufler sous l’apparence de la légitimité et de la nécessité. La société est violence, que ce soit dans les relations individu-individu ou État-citoyen au nom du maintien de la cohésion sociale. Ainsi l’apparente cruauté de Sade n’est qu’un cri d’alarme : il veut que nous n’oubliions pas ce qu’est vraiment la vie dans la société moderne ; il veut que nous ne nous endormions pas devant l’État, qui place de plus en plus la société à son service, alors que l’inverse devrait se produire. La société sombre, enveloppée dans un écran de fumée, dans le piège de la vertu. Avant de penser à la vie ou à la survie de ses membres, elle pense surtout à la sienne.
L’éthique n’est évidemment pas la principale préoccupation de Sade, mais sans être un modèle, il met en lumière la relation entre la sexualité et le politique. Il remet en question l’idée que nous pouvons être entièrement transparents avec nous-mêmes, nous invitant à réfléchir à ce qui est menaçant et terrible dans les relations humaines. Il ouvre également un espace de réflexion sur la violation du consentement (Beauvoir, 1955).
Cela dit, Sade et la justice sociale sont deux choses distinctes. Pour lui, puisque la cruauté sexuelle est une force naturelle, un impulse irrépressible, il revendique son droit fondamental, le droit au sexe, son droit à exprimer ses fantasmes dans les bordels. Rien sur les droits des femmes y travaillant, assurant des conditions de travail décentes, un soutien médical, et généralement rien sur la protection contre la violence envers les femmes et rien sur leur droit de dire non (Beauvoir 1955).
La pression que les individus privilégiés peuvent exercer sur les personnes vulnérables, cet aristocrate s’en contrefiche. Même après avoir été accusé et emprisonné pour des agressions allant jusqu’à des mutilations atroces durant des orgies privées avec des prostituées et/ou des domestiques, il reste totalement indifférent aux conséquences de ses actes.
La revendication de Sade du droit au sexe est essentiellement le droit des hommes d’avoir des relations sexuelles et d’accéder aux corps des femmes. Ce qui est glorifié, c’est le plaisir des hommes : le plaisir de contraindre, de torturer, d’humilier, de tuer. Ce discours pourrait sembler ridicule à notre époque s’il n’était pas au cœur d’actes misogynes commis par des hommes dans le monde : quid des féminicides de masculinistes voulant se venger d’être rejetés par les femmes2 ? Mais ce phénomène est aussi bien présent dans les communautés S/M sur des plateformes comme Fetlife, où certains hommes blâment, dénigrent les femmes en se considérant injustement rejetés par elles. Je pense notamment aux messages insultants, au revenge porn et aux dickpics non sollicitées que reçoivent de nombreuses femmes dans les communautés S/M. Ce sont tous des actions d’hommes qui voulaient se venger des femmes qui refusaient de leur accorder le droit à la sexualité et voulaient affirmer, revendiquer ce droit. Ce type de sadisme n’est pas toléré dans les communautés S/M et n’y a pas sa place, mais malheureusement, comme partout ailleurs, il existe.
Mes amies, Mistress Margot et Madame Francesca3, qui travaillent en tant que dominatrices professionnelles, m’ont confié qu’elles font face à des insultes, des harcèlements, des messages haineux, voire menaçants de la part d’hommes quotidiennement. Ces hommes croient avoir le droit de dénoncer l’injustice selon laquelle ces femmes ne mettent pas gratuitement leurs corps, leur attention ou leur amour à leur disposition.
Il ne s’agit pas d’essentialiser les femmes comme figures de paix et les hommes comme figures de violence, mais de reconnaître que les sujets ne sont pas situés socialement de la même manière, et que cette position structure leur rapport au monde, aux autres, et à l’action politique. Cette différence de positionnement social affecte profondément leurs perceptions et expériences, même lorsqu’ils poursuivent des objectifs politiques communs, comme la défense des communautés S/M. C’est pourquoi, comme le souligne Sandra Harding (1986), il est essentiel de partir du point de vue des groupes sociaux marginalisés pour penser les questions liées aux injustices et inégalités sociales, car ces positions offrent un accès privilégié à la critique des structures de pouvoir.
Sade se moque des questions d’injustice. Son univers se complaît dans l’indifférence, la décadence et la décomposition : son éloge de la cruauté, sa fascination pour la flagellation et l’automutilation en font un dandy cultivant l’indécence comme ultime provocation. Pierre Klossowski (1947) voit en lui un « prochain monstrueux », dont la rébellion oscille entre jeu et nihilisme — une posture où la réalité se confond avec la mise en scène. Rebelle sans cause, Sade brouille les limites entre vécu et représentation : son incarcération et son internement forcé ont transformé sa fureur sexuelle en légende, lui offrant une forme de martyr romantisé. Comme le souligne Annie Le Brun (1986), Sade a contribué à forger sa propre légende, transformant sa rébellion en une figure mythique de la transgression. Sade s’est enfermé dans son propre mythe, incapable (ou refusant) de se libérer de l’image qu’il avait construite. Son œuvre ne reflète jamais nos luttes – seulement nos contradictions.
Le masochisme à la Sacher-Masoch, un contrat doré ?
Le contrat dans les écrits de Sacher-Masoch est au cœur du dispositif masochiste. Ce qui permet à Deleuze de distinguer le masochisme du sadisme. Contrairement au sadisme, qui s’appuie sur une logique de transgression violente d’une loi intériorisée (généralement associée à la figure du père), le masochisme repose sur une scène contractuelle où les partenaires négocient les termes de la relation. « Il exige le consentement mutuel (norme contemporaine cardinale de la sexualité) de partenaires considérés comme égaux — au moins idéalement — et par là la préservation de l’intégrité éthique, juridique et politique de l’individu » (Mazaleigue-Labaste, 2016, p. 129). C’est cette base contractuelle — dans laquelle la femme est souvent investie d’un pouvoir symbolique, comme chez Sacher-Masoch — qui distingue le masochisme d’un simple renversement du sadisme.
La structure contractuelle du masochisme ouvre un espace de jeu autour des relations de pouvoir. Une sophistication souvent élevée dans le monde de Sacher-Masoch, présente dans ses jeux favoris comme jouer à l’ours, se déguiser en serviteur et faire un « contrat » avec la femme aimée. Cette sexualité, conçue pour mener à un certain niveau de sensibilité, demande du temps, de l’attention, de la disponibilité, des moyens, et suppose une graduation dans la progression des échanges : un contrat écrit, le fétichisme, et l’amour étaient censés immerger les partenaires dans un grand bain de communication et de bonheur. Sade, en revanche, pense principalement au plaisir sans chercher rien de plus profond, préférant la sueur à l’extase. Il rejette la nature divinisée et ritualisée de la sexualité telle que conçue par Masoch.
Mais le dispositif masochiste produit d’autres émotions. Puisqu’il appelle la confiance des partenaires, l’abandon de l’un à l’autre, la responsabilité de l’un sur l’autre, il rend possible l’amour fou. (Mazaleigue-Labaste 2016, p. 132)
Il n’y a pas une ligne sur l’amour dans les écrits de Sade. Sade est athée dans ce domaine. Le sexe, évidemment, il n’y est pas opposé ; quant à l’amour, il reste le désir ; voilà tout, aussi simple que cela. Le contrat... pourquoi auriez-vous besoin d’un maudit document légal entre les gens ? aurait-il sûrement demandé. L’amour passionné, comme on nous l’enseigne, n’est qu’une source de malheur, une maladie à guérir. Destiné à manipuler et à asservir, l’amour est une notion artificielle, créée de toutes pièces, l’un des éléments du paquet de liens imposés à l’homme, pour l’ancrer dans son environnement et dans son époque, lui donnant l’illusion qu’il a une mission et un destin sur terre (Vailland, 1946). Puisque les relations sentimentales sont hautement codifiées dans le corps social, Sade voulait célébrer leurs aspects les plus tabous pour finalement les nier, car ils ne sont qu’une forme d’aliénation, du pur commerce, de la valeur marchande, des compromis, que ce soit dans la rue ou pour attirer les clients dans un magasin. Né dans un monde où l’indifférence règne envers son prochain, Sade veut devenir le plus parfait parmi eux, sans émotion, sans souffrance.
En revanche, l’amour est fondamental dans l’univers de Masoch ; les femmes sont placées sur un piédestal. Pour lui, le contrat masochiste est un acte de soumission et de renoncement à soi, démontrant un acte d’amour ultime.
Alors oui, à l’origine, le rôle du contrat était de transmettre le pouvoir du père au fils. Les femmes n’étaient pas à la table des négociations. Et quand vous n’êtes pas à la table des négociations, cela signifie que vous êtes au menu. Mais ici, dans le dispositif masochiste, le contrat a une fonction tout autre. Il structure la relation, fixe ses bornes spatiales, temporelles et symboliques. Il définit les prérogatives du dominant, mais aussi les modalités et les limites précises de l’exercice de son pouvoir (Mazaleigue-Labaste 2016). Il n’y a pas de risque que le masochiste tombe entre les mains d’une fasciste qui le soumettrait contre sa volonté — avec un regard à la Mein Kampf — puisque c’est lui qui façonne la femme dominante selon son propre scénario. La dialectique du maître et de l’esclave y est suspendue ou court-circuitée.
Trouver La Vénus à la fourrure et la suivre comme un talisman pour découvrir le double fond des choses, sous les fausses perceptions, à travers les apparences quotidiennes trompeuses des simulacres, et s’éveiller à la réalité : au moment fatidique du choix (prendre ou non la « pilule » rouge, se réveiller ou non), voilà ce à quoi Deleuze nous invite : « Suivez la Vénus à la fourrure »… Sacher est Néo dans Matrix : en se réveillant dans la réalité, dans un sinistre tout postapocalyptique (le monde est un grand tombeau contre une skyline en ruine, un monde de pierres sans humanité), il tombe sans fin dans la steppe, le traînant dans les entrailles de la mère utérine, complétant sa renaissance, entouré de glace et protégé par la fourrure.
Mais qui est la Vénus ?
Sa bien-aimée Wanda elle-même, portant un masque et de la fourrure, qui le guidera fouet en main dans sa perte progressive absolue de contrôle sur l’espace-temps illusoire de la Matrice.
Mais immédiatement, des problèmes surgissent : Pourquoi est-ce la femme qui bat, et non un autre homme ? Si les femmes avaient le pouvoir symbolique dans les sociétés, voudraient-elles toujours battre le père ? Et si c’est le père qui est battu dans le fantasme et non la mère, n’est-ce pas parce que les hommes ont le pouvoir matériel et symbolique dans les sociétés ?
Deleuze embrasse cette confusion, lui permettant de lier les fantasmes masochistes au contenu culturel de la société dans laquelle il vit. Pour lui, c’est une femme qui doit tenir les rênes et punir, par besoin d’éviter un choix homosexuel trop manifeste. Deleuze s’arrête là. En n’allant pas plus loin, il tend à nourrir la croyance en la nécessité du contact entre les hommes et les femmes et à naturaliser les relations hétérosexuelles. En fait, le tabou de l’homosexualité plane comme un fantôme sur toute sa théorie (Hart, 2003). L’univers masochiste qu’il décrit en dépend.
On ne peut pas, sans être de mauvaise foi, essayer de jouer sur les deux tableaux simultanément, réalité sociale et contenu imaginaire, et parler de pure symbolique en interrogeant la théorie du masochisme de Deleuze.
Dans son œuvre, le concept de castration reste fondamental. Des symboles d’un retour à la Mère, tels que la castration d’Attis ou l’engloutissement par un dragon, expriment le besoin de sacrifier la sexualité génitale héritée du père pour permettre une renaissance en un nouvel homme aux sensibilités gynocratiques (Deleuze, 2006). Cependant, la castration n’a pas qu’une fonction purement logique ; elle a également un impact profond sur les corps humains, car elle touche à la manière dont le désir et l’expression de soi se structurent à travers les différences anatomiques et psychologiques. Et elle n’a cet impact sur les corps humains que parce que quelque chose à propos de l’impossibilité et de la nécessité d’exprimer son désir passe par des différences anatomiques. Et pourquoi cela passerait-il par-là ? « Pourquoi, sinon parce que quelque chose à propos de la capacité de certains êtres humains à exercer librement leur désir par rapport à d’autres passe précisément par la possession de ce petit morceau de chair ? » (Lippi et Maniglier, 2023, p. 79)
Nous pouvons différencier autant que nous le voulons entre fantasme et pratique sexuelle, souligner que le pouvoir du père est annulé, que le contrat masochiste est subversif car il est conclu avec et pour le bénéfice de la femme. Cependant, Deleuze n’a pas réussi à construire une théorie authentiquement moniste de la sexuation ou à la débarrasser avec succès de la référence génitale. Le pivot de cette théorie reste toujours la figure masculine, le corps doté de cet organe étrangement mobile, capricieux et étouffant, le pénis, si central à tout moment.
L’idéalisation de la femme chez Sacher-Masoch ne libère pas la femme de l’oppression ; elle redouble l’assignation, en la rendant désirable. Comme l’écrit Juliet Mitchell (1974), idéalisation et dénigrement sont les deux faces d’une même médaille : « l’éternel féminin » n’est pas une victoire, mais un piège. Comme le défend Hart (2003), dans cet univers, ce sont encore les femmes qui portent la responsabilité de sauver le monde en sauvant les hommes d’eux-mêmes. C’est à elles de prendre en charge la renaissance de cet homme aux sensibilités gynocratiques, de prendre soin de lui, de l’accompagner dans cette quête.
Aurora et Sacher-Masoch : Les liaisons dangereuses
La compagnie d’un artiste n’est pas sans danger. Depuis le mouvement #MeToo, certains amants désillusionnés ont révélé, dans des livres et à l’écran, le côté sombre de ces relations. Comment vivre avec un grand homme ? Comment ne pas être submergé par le monstre sacré ? Mensonges, manipulation, violence quotidienne et brouillage des frontières entre fiction et réalité plongent ces amants dans un véritable cauchemar, où ils finissent souvent représentés comme des personnages grotesques, ou leurs vies transformées en tragédies.
Lorsqu’Angelika Rümelin rencontre Leopold von Sacher-Masoch, il est déjà célèbre, ayant écrit Vénus à la fourrure, un roman où il décrit en détails sa femme idéale : les vêtements, les matériaux, les coupes, et les fourrures. La nature des coups et de cette femme, sa cruauté, son froid, son sarcasme. Le rôle de Wanda était précédemment tenu par une autre femme portant le même nom.
Angelika Rümelin nous apprend dans Confessions de ma vie qu’elle entre dans le jeu masochiste sous un malentendu (Sacher-Masoch, 1994). Rien ne la destinait à rencontrer Sacher-Masoch. Ce dernier est né dans une famille riche et aristocratique et a reçu une excellente éducation. Angelika Rümelin vient d’un milieu beaucoup plus modeste. Sa situation empire lorsque son père, ayant vendu tous leurs meubles, disparaît soudainement, les laissant dans une extrême pauvreté. Malgré ces épreuves, elle parvient à apprendre le métier de brodeuse, améliorant modestement leur situation.
Sacher-Masoch et Angelika Rümelin se croisent inopinément grâce à Mme Frischauer. C’est elle qui ouvre la porte aux œuvres de Leopold von Sacher-Masoch pour Angelika, posant ainsi les bases de cette rencontre inattendue. Mme Frischauer suggère à Angelika que la femme correspondant aux préférences de Sacher-Masoch serait cruelle et sadique. Cette dernière restant sceptique, elle lui propose alors un pari. En acceptant le défi, Angelika accepte de lire les lettres échangées avec Mme Frischauer dans le cadre de cette correspondance et de découvrir si Sacher-Masoch recherchait vraiment une femme cruelle. Mais le pari prend une tournure inattendue lorsque le fils de Mme Frischauer, un ami de Sacher-Masoch, reconnaît l’écriture de sa mère. Mme Frischauer doit alors cesser immédiatement ses correspondances. Son honneur est en jeu, et elle demande à son amie Angelika de récupérer ses lettres. Ainsi, elle doit aller rencontrer Sacher-Masoch pour qu’il lui rende les lettres qu’elle lui a envoyées et faire semblant d’être l’expéditeur de cette correspondance. Elle se rend au rendez-vous à contrecœur, endossant accidentellement le rôle d’une femme sadique comme une actrice remplaçant une autre.
Elle apparaît voilée lors de sa rencontre avec Masoch. C’est là que commence le jeu d’écriture entre eux, sans lequel elle n’aurait pas pu rester la Vénus à la fourrure. Il ne passe pas beaucoup de temps avant qu’il n’exprime son intérêt romantique pour elle, et ils commencent une correspondance dans laquelle il exprime son amour pour la narratrice.
Masquée puis voilée, c’est parce qu’elle interprète romantiquement les fantasmes de Masoch que la version qu’elle donne de Wanda reste, aux yeux de Sacher-Masoch, la seule valable. Elle le séduit d’abord par sa correspondance ; il détecte en elle une écrivaine et, avant de lui conférer un rôle important dans sa vie et son œuvre, il la forme à l’écriture en lui suggérant d’écrire pour une revue. Mais c’est parce qu’elle est elle-même une inspiration qu’il veut la garder près de lui et lui propose le mariage. Elle incarne non seulement la femme de ses désirs, Wanda dans Vénus à la fourrure, mais elle est aussi le remède à ses difficultés créatives (Constant, 1989).
La jeune femme est impressionnée. Il y avait tant d’hommage aux femmes dans les discours de Sacher-Masoch que cela l’a bouleversée. Même si les choses dont il parlait lui étaient étrangères et semblaient parfois absurdes, sa manière calme de les dire, son utilisation impeccable de la langue, son art de la rhétorique donnaient vérité à ses discours. C’était sa manière de les dire qui éveillait vraiment quelque chose en elle. Ils n’imposaient rien. C’est ainsi qu’elle s’est laissée emporter par le jeu de Sacher-Masoch. Une chose l’attirait : il n’essayait pas d’imposer son savoir ; il était modeste, humble, plus en quête d’un échange avec une personne qu’avec un public anonyme. Venant d’un homme avec une certaine réputation, cela l’avait troublée, attirée et lui avait ôté toute sa présence d’esprit.
Son histoire résonne complètement avec la mienne. J’ai aussi commencé à jouer au jeu masochiste sous un malentendu, apparaissant masquée avec un profil de dominatrice sur Facebook pour recueillir des informations pour ma thèse de maîtrise sur la domination féminine. Apparaissant sous un jour peu flatteur, luttant avec des petits boulots, vivant dans un squat délabré à Amsterdam, j’ai aussi, sans en être pleinement consciente, embarqué dans une véritable séduction intellectuelle avec Lèchebotte, un homme qui se présentait comme esclave de sa femme, cherchant des amies dominantes pour jouer avec sa femme. Bien que j’aie trouvé quelque peu surprenantes les conversations qu’il initiait, modelées sur la relation médiévale entre vassal et seigneur, son langage frisant parfois le ridicule, il touchait aussi mon narcissisme. Il me décrivait comme une perle brute, inaccessible, une femme exceptionnelle et remarquable (Lugand, 2023). Et comme Wanda, sa politesse extrême, son expression impeccable et raffinée, ses pensées élégamment et poétiquement articulées, tout présenté avec une extrême servilité, me plaisaient et me touchaient. J’avais l’impression que je pourrais accomplir des merveilles dans un monde où je jouerais le rôle principal. J’étais comme mystifiée.
Notre correspondance a duré plus d’un an, après quoi il a disparu. Il était le premier et pas le dernier homme masochiste à disparaître ainsi, ne laissant aucune trace.
C’est pourquoi il vaut mieux ne pas se laisser emporter trop rapidement par de telles belles déclarations. La jeune Angelika le sait. C’est pourquoi elle reste prudente et sceptique. Consciente de la nature changeante de Sacher-Masoch, qui en est à sa première tentative d’amour, elle ne croit pas initialement en ses intentions et reste sur ses gardes. Néanmoins, Sacher-Masoch persiste et propose le mariage. Malgré son doute initial, la narratrice finit par accepter son offre.
Cette histoire de conte de fées tourne rapidement au cauchemar. Bien que sa situation se soit améliorée — elle fait désormais partie de la noblesse, vivant avec un écrivain populaire et renommé, profitant de domestiques — ils vivent toujours dans une certaine pauvreté. Elle se plaint, précisant qu’il dépense sans compter, prenant tous ses désirs et fantasmes au sérieux sans se soucier des réalités matérielles. Ils sont en fait submergés de dettes.
C’est alors que Sacher-Masoch propose le contrat. Elle l’utilise, voyant une opportunité de sauver sa famille de la misère, et se force ensuite à accomplir les fantasmes de son mari et à honorer sa part du contrat : « Initialement, ma répugnance était grande ; mais progressivement, je m’y suis habituée, bien que je ne l’aie jamais fait que de manière réticente et contrainte par la nécessité » (Sacher-Masoch, 1994, p. 112).
Ainsi, le contrat masochiste, contrat sexuel, bien que formellement négocié, repose sur une illusion de réciprocité (Fraisse, 2007) : Wanda « consent » à jouer la dominatrice, mais ce rôle lui est imposé par ses besoins économiques. Comme le souligne Fraisse, le consentement ne devient émancipateur que s’il inclut la possibilité réelle de dire non — ce que le cadre matrimonial de Wanda lui refuse.
Wanda cède à son mari, se plie à ses caprices, revêt des fourrures inconfortables ; épuisée, elle manie le fouet à contre-cœur, uniquement pour inciter Masoch à travailler, à gagner sa vie, car pour que le gentilhomme travaille, il faut qu’il soit « bien disposé et que quelque chose [le] stimule » (Sacher-Masoch, 1994, p. 119).
Pas-à-pas, elle le conduit vers la vie de famille idéale qu’elle envisage, alimentée par les souvenirs d’une enfance dominée par le froid et la faim. Prise par l’anxiété mortelle, il lui demandait de le torturer, trouvant son bonheur dans ces tourments, c’était l’image de ces enfants qui l’empêchait de céder au désespoir :
Pas un jour ne se passa sans que j’eusse fouetté mon mari, sans que je lui eusse prouvé, que je tenais ma part de contrat. Au commencement ma répugnance fut grande ; mais peu à peu je m’habituais, bien que je ne l’aie jamais fait qu’à contre-cœur et contrainte par la nécessité. (Sacher-Masoch, 1994, p. 116).
C’est ainsi que les pulsions sexuelles de Masoch étaient contenues dans les limites étroites d’une famille. Le deuxième contrat qu’elle signe est marqué par ce sceau : elle satisfera ses demandes érotiques, et il écrira une littérature de bon goût. Leur vie est alors hantée par la fiction.
Vivant au jour le jour et devant rester avec lui lorsqu’il écrit, elle prend également la plume. Mais elle doit le faire sous certaines conditions. L’écriture ne l’exempte pas de devoir représenter la femme cruelle. Elle doit écrire, enveloppée dans des fourrures, par 30 degrés de chaleur, se consacrant exclusivement à des histoires cruelles pour plaire à son mari. Vénus prend vie, et elle en prend conscience en même temps. Wanda co-écrit l’œuvre de Masoch. Et ce sont aussi ses œuvres comme La véritable Hermine (Sacher-Masoch, 1879) que Krafft-Ebing explore dans son étude du masochisme, faisant ainsi d’elle une auteure « masochiste » de plein droit.
Devenir la Vénus à la Fourrure
Vénus, chez Masoch n’est ni une femme, ni une courtisane. Elle est une déesse. L’univers de Masoch émane du mythe, de la religiosité chrétienne, du paradis perdu de son enfance en Galicie, de concepts abstraits. Il est suspendu, en attente, sans racines. Par la seule dextérité, les coordonnées du temps et du lieu sont dissoutes, transcendées, converties en image. Ainsi, le corps de Vénus est là et pourtant pas « là » : « Vénus est une statue. Son corps est de marbre, ses yeux, morts et pétrifiés. Elle est une présence sépulcrale, une figure funèbre. Plus qu’une femme-objet, elle est un objet-femme, une créature posthume, inerte » (Michel, 2006, p. 71). Comme dans les mythes de Roland Barthes, cette « victime assassinée » — vidée et inerte — a aussi un alibi, un ailleurs, littéralement « fabriqué » à partir de fourrures, de peaux dures, de masques, de fouets et de bottes. Cet « ailleurs » était aussi un « nulle part » — une zone créée à partir de la négativité qui semble s’ouvrir sur un autre monde, mais ces portes « mènent à un corridor circulaire » (Breton, 1937).
Peuplé d’invariants anthropologiques et transhistoriques, La Vénus à la Fourrure est incapable de renouveau ; elle est éternellement arrêtée. À cet égard, Wanda dirait :
Parfois, il m’était difficile de cacher l’ennui et la fatigue causés par les conversations - toujours les mêmes - que nous avions sur le thème de la ‘Vénus à la Fourrure’. Lui-même ne trouvait rien de nouveau dans sa riche imagination, et nous tournions constamment en rond. La décision d’être prudent devant les enfants l’obligeait à se contenir et me permettrait parfois de retirer mon esprit de cette torture mentale (Sacher-Masoch, 2014, p. 238).
Les conséquences de ces comportements sont accablantes pour son Wanda censée incarner les contradictions de cet homme en quête de mythes et les porter au plus haut danger : une responsabilité écrasante, des tensions entre des demandes parfois contradictoires, la peur des menaces et des jugements, la fatigue due à l’attention dirigée vers les besoins de Sacher-Masoch, le manque de temps de Wanda pour prendre soin d’elle-même, pour nourrir ses propres rêves, espoirs, désirs, fantasmes, sensualité. En bref, une relation vécue sous le signe de la toxicité.
Les confessions de Wanda c’est un trou noir autour duquel le masochisme se compose. Wanda est là, toujours à l’heure, voire plus tôt, fouet en main, mais pas désireuse d’être suivie. Dans les confessions, Wanda enlève enfin son masque, révélant sous son manteau de fourrure un profil avec un œil pleurant de fatigue :
Le lendemain de mon accouchement alors que j’étais encore épuisée, L. von Sacher-Masoch lui a lu, « une annonce du Wiener Tagblatt, dans laquelle un jeune homme, beau, riche et énergique, cherchait une jeune, jolie et élégante femme pour s’amuser ensemble. » Le neuvième jour, je me suis levée, et il a été convenu que je partirais à Mürzzuschlag.
(...) Je pensais que le lendemain le bébé serait privé de moi ; comment ferions-nous tous les deux ? Puis j’ai pensé qu’il faisait terriblement froid dehors, qu’il y avait tellement de neige que les trains ne roulaient plus, ou seulement avec des heures de retard, et pourquoi je devais y aller. Découragée et triste, j’ai commencé à pleurer.
J’ai dû nourrir son enfant avec du lait de vache, mettant sa vie en danger pour le plaisir de mon mari. Il faisait moins 24 degrés. Les écoles étaient fermées. Quand Staudenheim a fait remarquer à Sacher-Masoch que les femmes et les enfants n’étaient pas autorisés à sortir par ce froid, il a répondu : « C’est parce que tu compares ma femme aux autres femmes. Ce qui nuirait à une autre femme ne fait rien pour elle ». Le lendemain, le nouveau-né avait la dysenterie, et j’ai failli le perdre (Sacher-Masoch, 2014, p. 320).
La Vénus à la Fourrure n’est rien d’autre que le rêve flottant prolongeant l’esprit d’une petite mort. La naissance « d’un nouvel homme », comme le professait Deleuze, n’a pas eu lieu ! Ce qui subit une certaine soumission chez Sacher-Masoch, c’est son imagination. Chaque fois qu’il impose ses désirs à Wanda, il se soumet inconsciemment aux normes patriarcales. Sacher-Masoch a choisi la glorification de Wanda en tant que déesse plutôt que de courir le risque de s’engager dans un processus de réflexion. Ce n’est pas son goût du risque comme on pourrait le croire qui a créé son malheur mais son obsession de laisser les choses à leur place. S’il craint quelque chose, c’est de laisser Wanda respirer librement, éprouver de la joie, des désirs, de peur que cela ne perturbe l’ordre soigneusement construit de son monde par ses maîtres. Sa peur est voilée par le beau portrait frigide et rigide de Vénus. Ce qu’il cache, ce sont les conséquences de sa peur sur elle — menaces, contraintes, harcèlement et tromperie. Les révélations de Wanda transcendent de simples exceptions ou incidents mineurs ; son corps devient un champ de bataille où elle est involontairement poussée, soumise à la mutilation.
Son refus devient une facette intégrante de ce jeu pervers. Comme un ours ou une louve capturée, Wanda est choyée, crainte et adorée, tout cela dans le seul but d’être sacrifiée dans un jeu insensé, pour sa beauté. La vénération dans La Vénus à la Fourrure réside dans la manifestation du pouvoir patriarcal — repoussant les limites de la puissance féminine à travers des techniques absurdes et morbides.
Construire une relation éthiquement viable ne consiste pas à essayer d’atteindre un idéal mais de l’attention aux dynamiques inconscientes qui nous constituent. Précisément parce que notre inconscient est composé uniquement d’événements ou de singularités non contractualisables, nous ne pouvons pas le décrire comme un plan de réalité immuable (Lippi et Maniglier, 2023).
Angelika Rümelin et Wanda von Sacher-Masoch prennent le large
La nature atypique de la relation Wanda/Sacher-Masoch, son indiscrétion, conférait un caractère dangereux et romantique à cette histoire d’amour : seul·es contre tou·tes, uni·es contre l’étroitesse d’esprit des personnes dites « décents », iels devaient défier les tabous culturels pour se livrer à la passion. Certes, le jeu était dangereux. Mais ça en valait la peine. Rebondissements, retournements dramatiques, matériau pour une œuvre littéraire qui se mêle aux mythes originaux.
Comme l’a analysé Eva Illouz (2012), la rationalisation de l’amour en Occident a conduit à pathologiser ses manifestations extrêmes — passion, obsession, dépendance affective —, désormais perçues comme des symptômes à éradiquer plutôt que comme des expériences constitutives du lien. Dans ce contexte, les travaux de Mazaleigue-Labaste (2016) sur le masochisme montrent comment le dispositif masochiste, en codant rigoureusement la relation (rôles, scénarios, limites), permet une exploration contrôlée de ces mêmes émotions, offrant ainsi une alternative à leur répression sociale. Il permet de les canaliser, offrant ainsi une réponse quant aux réserves émises à leur sujet.
C’est précisément cette architecture fantasmatique, fondée sur un récit suivant les trames de l’amour romantique, que viennent déranger les Confessions de Wanda. En livrant sa propre version de l’histoire, plus réaliste, plus triviale, Wanda brise l’image idéalisée de la femme cruelle que Leopold von Sacher-Masoch avait patiemment façonnée. Aux yeux de certains, comme l’écrivain Schlichtegroll (1906) elle aurait dû taire ses souvenirs par respect pour un homme mort et incapable de se défendre. Mais ce que ses confessions mettaient réellement en péril, c’était le cœur même du dispositif masochiste : l’amour idéalisé comme fondement du pacte de domination. En introduisant des considérations féministes — l’inégalité des sexes, le travail domestique, la domination masculine —, Wanda introduisait un corps étranger dans le récit, qui menaçait de faire imploser l’univers fantasmatique de Masoch de l’intérieur. L’obscurité du tableau peint par Wanda, les détails de sa vie, étaient trop réalistes. Un tollé massif s’ensuivit.
Cette relecture de l’amour romantique en tant que dispositif susceptible d’occulter les rapports de domination, résonne avec les travaux de Solveig Lelaurain et David Fonte (2022) sur les représentations de la violence conjugale. Ceux-ci montrent comment les formes romanesques de l’amour peuvent neutraliser les analyses sociopolitiques de cette violence. Les confessions de Wanda, en dévoilant ce qui se joue sous le voile de l’amour, participent déjà de cette déconstruction : elles rendent visibles les rapports de pouvoir que le récit amoureux tend à effacer.
Aussi il n’est pas faux de dire qu’en croyant pouvoir se fier à un discours romanesque pour guider nos relations, nous finissons par en faire une idéologie, où « l’idéologie, dans un sens assez précis, consiste à relier un aspect de la vie humaine à ses spécificités à un ensemble de généralités toutes faites sur lesquelles nous pouvons nous accorder, mais parce que nous taisons nos différences » (Lippi et Maniglier, 2023). Cette confiance accordée au récit amoureux neutralise les conflits, gomme les asymétries, et empêche une véritable prise de parole sur ce qui fait l’expérience vécue.
De fait, ces références romanesques, qu’elles soient des chefs-d’œuvre ou non, ne peuvent servir de théorie pour construire nos relations : elles ne sont pas destinées à guider la pratique. Ces romans, qu’ils soient des chefs-d’œuvre ou non, ne peuvent pas se substituer à la capacité des femmes à parler de la sexualité dans l’espace public ou académique de leur point de vue, sans risquer de perdre contact avec ce que nous faisons, ce que nous vivons, ce que nous ressentons.
Le masochisme, tel que le pratique Masoch, puisqu’il ne s’intensifie que dans les limites étroites du consentement affirmatif de l’autre avec le contrat, ne peut pas servir de ressource pour penser aux relations éthiques. On ne peut pas penser les rapports de domination dans la sexualité uniquement avec les outils du droit, du contrat ou du consentement « affirmatif ». Avec Avgi Saketopoulo (2023), je suggère en effet qu’une des complications ici est que, bien qu’il soit utile que les gens expriment exactement ce qu’ils veulent — directement, clairement et de manière évidente tout le temps — cela n’est tout simplement pas la réalité. Bien que la communication fréquente et directe soit souhaitable, il y a toujours des éléments non exprimés. Cela est particulièrement vrai dans les jeux masochistes où une grande partie de l’érotisme et de l’attraction réside dans le jeu explicite avec le consentement, souvent en brouillant intentionnellement les frontières. Que ce soit par des pratiques de « non-consentement consensuel », où l’idée sous-jacente, comme le nom l’indique (bien que mal formulée, car ambiguë), est de prétendre ne pas respecter le consentement à la forme la plus légère de bondage, en passant par le simple fait que le dominant dicte les actions du soumis — tous ces scénarios masochistes sont enveloppé de l’apparence du non consentement (Williams et al., 2014). Les praticiens BDSM expérimentés le savent bien et comprennent que naviguer sur cette fine ligne du consentement est ce qui donne vie au BDSM. Essayer de cadrer le consentement avec des règles strictes et des critères explicites, c’est, dans une certaine mesure, nier l’existence de l’inconscient. C’est pourquoi il est intéressant de se tourner vers la psychanalyse pour comprendre ce qui se joue à ces frontières. Non pas pour tracer une limite entre ce qui est normal de ce qui ne l’est pas, mais parce que les pratiques sexuelles inventives et les fantasmes qu’elles engagent, ainsi que les questions qu’ils soulèvent, appellent à être réfléchis, élaborés, travaillés. Ils exigent d’autres formes de médiation que la seule mise en place de protocoles. Comme le souligne Juliet Mitchell (1974), la psychanalyse, permet de penser comment elles se répètent, se rejouent, se fixent dans les structures psychiques. Elle offre ainsi un cadre pour analyser les affects, les répétitions, les contradictions internes, les souffrances et traumatismes qui traversent nos expériences sexuelles et relationnelles — et que les contrats sont incapables de saisir.
À l’inverse, Sacher-Masoch semble évoluer dans une mise en scène fantasmatique close sur elle-même. Tandis que Sacher-Masoch progresse dans une immobilité totale, se délectant de ses fantasmes de stagnation triomphante, Angelika ne se raconte pas d’histoires. Elle se cantonne à faire les comptes, à tourner en rond avec les mêmes conversations sur Vénus à la fourrure et doit se résigner à une existence ennuyeuse et fatigante.
Mais peut-être que ces confessions déplacent le sens de l’histoire. Peut-être que sa rencontre avec l’écriture ne transforme pas simplement une fiction en action, mais révèle une autre force qui l’accompagnait en silence : le féminisme. Lorsqu’elle retire la fourrure et les masques — ceux qui l’étouffaient, qui entravaient ses gestes —, lorsqu’elle invente ce livre, lorsqu’elle se détache de Masoch et demande le divorce, c’est un autre récit qui s’ouvre.
Nous ne savons pas comment le féminisme s’est inséré dans sa pensée. Nous savons qu’elle a eu mal dans sa vie, depuis son enfance mais nous ne savons pas exactement d’où vient sa blessure. Elle dit qu’elle est à bout de souffle, et quelque chose hante ses pensées. Elle commence à raconter son histoire. Elle nous raconte l’histoire d’une femme que nous connaissons, privée d’action par le pouvoir, perdue dans les mauvais combats pour le bénéfice de ceux qui les dominent.
Pourquoi le mouvement féministe n’intervient-il pas ici ? Pourquoi ne va-t-il pas à la racine du problème, pour balayer cette vieille institution pourrie du mariage, si contraire à nos pensées et sentiments modernes, ou s’il ne peut pas la balayer, l’ignorer ? Tant que les femmes n’auront pas le courage de régler ce qui les concerne seules sans intervention de l’État ou de l’Église, leurs relations avec les hommes ne seront pas libres (Wanda von Sacher-Masoch, 1994, p. 421).
Confession de ma vie ne sont pas seulement un roman sur la véritable histoire de Wanda et Masoch. Ce roman est le roman post-Masoch : La Vénus en furie. Il nous parle non seulement du monde contre lequel Wanda s’est battue mais du monde dans lequel nous nous battons encore maintenant.
Si on se retrouve encore dans son histoire, c’est parce que nous continuons à poser les mauvaises questions. Nous nous interrogeons sur l’essence de la féminité, où sont les femmes dominantes, comment les repérer, pourquoi il y en a si peu, pourquoi les femmes sont plus masochistes. Nous nous demandons dans ces relations, qui est le bourreau qui est la victime. Des énigmes qu’aucune théorie ne pourra jamais élucider entièrement.
Angelika Rumerin, qui a pris le nom d’une aristocrate : Wanda von Sacher-Masoch, est confrontée à son passé, à son histoire en tant qu’épouse : La petite fille aimante, craignant de vivre dans la pauvreté et l’abandon, se mettra en rébellion. Elle prend sa plume, ridiculise Masoch et ses fantômes, règle ses comptes avec les mythes. A partir de maintenant elle ne se laissera plus berner par les vieux mensonges sur l’amour, la fausse spiritualité et les contrats moisis. Cette fois, ça ne se passera pas comme ça !
Son livre pose la bonne question : qu’est-ce qui étouffe les femmes, les empêchent de respirer ?
Car aucune idée n’a jamais bougé le monde ; ce sont les affects, à travers l’excès de pulsions qu’ils encapsulent, qui peuvent renverser l’ordre des choses. Tout cela se passe dans les corps, à partir des corps, et est d’autant plus politique pour cela (Lippi et Maniglier, 2023).
L’émancipation, dans ce contexte, ne peut consister à améliorer les termes de l’échange, mais à abolir le monde dans lequel les femmes sont censées s’émanciper, pour reconstruire un monde en référence féminine. On ne peut consentir librement à une relation dans un monde qui organise notre subordination.
L’éthique relationnelle ne commence pas dans la négociation interindividuelle, mais dans une transformation des conditions structurelles de cette rencontre. À bout de souffle, la seule façon de se libérer est de changer le monde. Arrêter de vivre dans un monde d’hommes pour en créer un autre et retrouver un second souffle.
Nous ne sommes pas loin de la sororité du film Céline et Julie vont en bateau (Dames fantômes sur Paris) de Jacques Rivette sorti en 1974, dans l’interprétation que Pacôme Thiellement en donne4. La connexion est d’autant plus évidente que les dames fantômes luttent contre des figures du mal qui ne sont pas des figures de marginalité mais de domination. Dans Confessions de Wanda von Sacher-Masoch, il s’agit de la domination de classe, du patriarcat, de la pauvreté, mais aussi du rationalisme et de la culture dominante. Un autre point commun est que ces femmes sont submergées. Submergées par les événements, signifiant déborder d’événements, de la nouveauté des choses. Être submergé, c’est aussi être ouvert à ce que l’autre a apporté, s’ouvrir à une pratique de l’ouverture à ce que personne ne sait mais que Freud appelait l’inconscient, qui se manifeste à travers des lapsus et des symptômes, des choses que nous n’aurions pas voulu dire, ressentir, faire, et c’est donc cet espace de résistance à ces événements qui est la trace de quelque chose de nouveau.
Bien sûr, il est difficile de parler de sororité dans le cas de Wanda, car elle est assez solitaire. Mais dans le livre, elle cherche à montrer qu’au fond, ce n’est pas le problème du père qui l’agite mais un désir de créer une relation soustraite à l’empire des hommes, au-delà du désir masculin. Et alors quoi d’autre que la recherche de compagnonnage avec d’autres femmes avec qui elle partage la condition ? Quoi d’autre qu’une relation avec une autre femme ? C’est ce qui la motive, mais ce n’est pas dicible, comme tout élément inconscient.
Alors que Wanda quitte Masoch, elle dit :
Libre ! Délivrée de dix ans de tourment !... Pour m’appartenir à nouveau, ne plus jamais porter de fourrure, ne plus jamais tenir de fouet et ne plus jamais entendre le mot grec !... Comme une lourde armure portée depuis de nombreuses années, qui m’avait comprimée, entravé les mouvements naturels de mon corps et menaçait de me mutiler. (Wanda von Sacher-Masoch, 1994, p. 420)
Elle écrira ces confessions et partagera ses amères souvenirs avec le monde, avec ses sœurs. Dans un curieux rebond, il arrive que la prison elle-même ouvre à la liberté5.
Conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêt déclaré.
Lugand, N. (2023). A psychodynamic approach of female domination in BDSM heterosexual relationships: Sexuality between pleasure and work. Routledge.