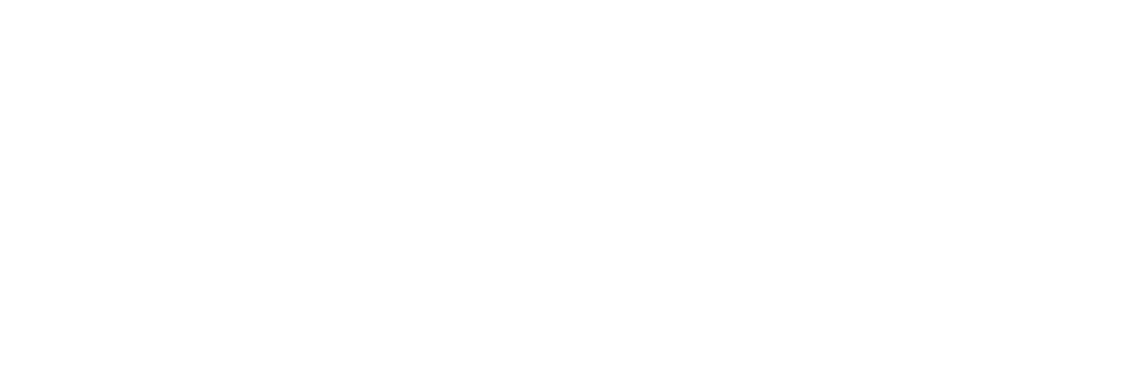Introduction
En tant que chercheuses féministes, comment pouvons-nous produire des connaissances qui sortent du moule androcentrique et permettent de mener des recherches pour les femmes plutôt que sur les femmes ? C’est une question avec laquelle les chercheuses féministes en sciences sociales se sont débattues depuis l’essor du féminisme de la deuxième vague. Au début, les chercheuses ont eu tendance à affirmer que les approches qualitatives étaient particulièrement adaptées aux objectifs féministes (Duelli Klein, 1983 ; Griffin, 1986 ; Mies, 1983). Plus récemment, un changement de perspective a eu lieu pour souligner qu’une diversité de méthodes (ne privilégiant ni les approches qualitatives ni les approches quantitatives) est plus appropriée à la démarche pluraliste des sciences sociales féministes (Griffin et Phoenix, 1994 ; Maynard, 1994 ; Peplau et Conrad, 1989 ; Riger, 1992).
Cet article s’intéresse aux développements historiques et contemporains de la réflexion féministe sur la méthode. Il comporte trois parties qui, ensemble, présentent une préoccupation globale pour les questions d’épistémologie, de théorie et de pratique de la recherche. La première décrit les origines et le développement de deux positions — favorable à la recherche qualitative ou au pluralisme méthodologique — qui ne sont ni l’une ni l’autre exemptes de contradictions ou de dilemmes. Nous craignons en particulier que l’enthousiasme actuel pour le pluralisme méthodologique ne masque des positions potentiellement contradictoires, ce qui n’aide pas à résoudre les tensions portant sur le statut de l’expérience des femmes et la question du bien-fondé des interprétations féministes. Ces tensions ont été annoncées dans les discussions sur l’importance des méthodes qualitatives pour le féminisme, mais elles se manifestent aujourd’hui dans les débats plus larges sur les épistémologies féministes. Par conséquent, la deuxième partie de l’article examine la façon dont nous pouvons continuer à faire de la recherche depuis une position féministe tout en dialoguant avec les critiques d’inspiration post-moderne. La dernière partie traite de ces tensions au niveau de la pratique de la recherche, en utilisant des exemples d’analyses qualitatives contemporaines qui cherchent à maintenir une revendication d’objectivité féministe mais aussi à éviter l’appropriation de « l’autre ». Nous plaidons en faveur de l’abandon du pluralisme méthodologique, en créant un espace pour explorer plus avant les liens entre la recherche qualitative et les formes contemporaines de la théorie du positionnement situé. L’un des bénéfices de cette approche est de placer au centre des débats féministes sur la méthode les questions de profondeur et de fondements théoriques.
Les premières critiques féministes du positivisme
Les premières critiques féministes du positivisme au sein des sciences sociales se sont concentrées sur les questions d’invisibilité (des femmes et des questions relatives aux femmes), d’épistémologie et d’éthique. Comme l’a souligné Marcia Westcott (1979, p. 423), le problème de « l’invisibilité ou de la distorsion des femmes en tant qu’objets du savoir » est dû au fait que la science n’est pas à l’abri des pratiques institutionnalisées qui produisent et renforcent les biais de genre à travers les sociétés. Les femmes sont sous-représentées dans les postes à responsabilités et les positions d’autorité dans la science, et leurs préoccupations sont souvent entièrement ignorées dans la recherche ou considérées uniquement comme des écarts par rapport à la norme masculine. L’une des solutions proposées est de promouvoir l’équilibre (et donc de parvenir à une science moins « biaisée ») en augmentant le nombre des femmes, en tant que scientifiques et participantes, et en incluant dans la recherche un plus large éventail de thèmes en rapport avec les préoccupations féministes.
La critique épistémologique remet en cause les fondements mêmes de la science positiviste. L’objet de cette critique apparaît clairement dans le domaine de la psychologie qui reste dominée par la méthode expérimentale hypothético-déductive. En psychologie, on prétend que la méthode est à la fois nécessaire et suffisante pour éradiquer les « biais » (incluant la subjectivité du chercheur) qui pourraient menacer la validité et la fiabilité des résultats de la recherche. Toutefois, ce modèle est mis à mal par la prise de conscience du fait que toutes les connaissances (et pas seulement celles qui sont biaisées) ont des origines sociales et historiques (Reinharz, 1979, 1983). La science ne peut être décrite comme une activité neutre sur le plan des valeurs ou exclusivement objective, car les hypothèses qui sous-tendent la science en général, comme les projets scientifiques particuliers, sont toujours déterminées par la culture, la politique et les valeurs d’une société (Du Bois, 1983).
L’une des implications est ici que le connaissant et le connu ne peuvent être séparés sans ambiguïté1, comme le suppose la norme de l’objectivité (Smith, 1974). En conséquence, le rôle du/de la chercheur·euse doit être considéré comme central dans le processus de recherche (Stanley et Wise, 1983a, b), la révélation de l’aspect personnel de la recherche fait alors partie de l’explication des bases de la connaissance. L’approche conventionnelle de la conduite de la science et de son compte-rendu, dans laquelle les attitudes des chercheur·euses ne sont pas révélées, reconnues ou analysées (dans le but d’être « objectif » et « exempt de valeurs »), contraste avec le point de vue féministe selon lequel les engagements des chercheur·euses doivent être pleinement décrits et discutés, et leurs valeurs « reconnues, révélées et signalées » (Reinharz, 1983, p. 172).
La pensée féministe a également toujours été claire quant aux défis éthiques et émancipateurs qu’elle a lancés à la science positiviste. Par exemple, l’une de ses préoccupations concerne le fait que la manipulation et la mesure expérimentales participent d’un discours de contrôle (Bowles et Duelli Klein, 1983). En outre, l’accent mis sur l’isolement des « variables » exclut des aspects de la signification inhérents au contexte et à la vie des femmes dans sa totalité (Condor, 1986 ; Parlee, 1979), et sape nécessairement la relation entre la/le chercheur·euse et son/sa participant·e. Dans ce contexte, Maria Mies (1983, p. 123) affirme que l’utilisation d’outils quantitatifs dans une situation de recherche hiérarchique « va à l’encontre de l’objectif même de la recherche [car] elle crée une méfiance aiguë chez les “objets de la recherche” qui ont l’impression d’être soumis à un interrogatoire » (voir également Nicolson, 1986).
L’affinité entre la recherche féministe et les méthodes qualitatives
Les critiques du positivisme ont conduit certaines chercheuses féministes à explorer le potentiel des méthodes qualitatives (par exemple Reinharz, 1979 ; Mies, 1983 ; Griffin, 1986). Les méthodes de collecte de données moins structurées typiquement associées à la recherche qualitative, telles que les entretiens et l’observation participante, peuvent permettre un degré d’implication plus étroit entre la chercheuse et ses participant·es et, par conséquent, une plus grande sensibilité aux droits des participant·es en tant que personnes plutôt qu’en tant qu’objets de recherche.
De nombreuses approches qualitatives soulignent également l’importance de créer de nouvelles façons de voir plutôt que de tester la théorie antérieure, ce qui permet à la recherche d’avancer de façon innovante et progressive (Henwood et Pidgeon, 1992). Ceci est particulièrement pertinent pour les chercheuses féministes qui ont besoin de se libérer du carcan des théories et des modèles androcentriques. Les méthodes qualitatives se prêtent également à une approche de l’ensemble du processus de recherche qui reconnaît pleinement l’interrelation critique, et même nécessaire, entre les subjectivités de la chercheuse et de ses participant·es dans la construction sociale du savoir. Ces facettes de la recherche qualitative ne sont pas en soi émancipatrices, mais elles ont un potentiel considérable pour contribuer à l’objectif de faire de la recherche pour les femmes plutôt que sur les femmes (Henwood, 1993).
Il existe aussi des raisons épistémologiques plus profondes de considérer la recherche qualitative comme une activité impliquant des problématiques paradigmatiques alternatives, distinctes de celles de la recherche quantitative et positiviste, et incommensurables avec elles (voir par exemple Bryman, 1988 ; Guba et Lincoln, 1994). Un courant important des sciences sociales féministes suggère que la chercheuse doit adopter « une perspective dans laquelle les expériences, les idées et les besoins des femmes (aussi différents et divergents soient-ils) sont valables en tant que tels » (Duelli Klein, 1983, p. 89). Cet accent mis sur la nécessité de valoriser l’expérience des femmes vue dans leurs propres termes, ou de « voir à travers les yeux des femmes », rejoint l’exhortation de l’ethnographie traditionnelle à « voir les choses du point de vue de l’autochtone [sic] » (Geertz, 1979, p. 221 ; voir aussi Hammersley et Atkinson, 1983), ainsi que la conviction, de ce que l’on appelle le nouveau paradigme de recherche, selon laquelle « la véritable enquête humaine doit se fonder de manière ferme sur l’expérience de celle et ceux qu’elle prétend comprendre » (Reason et Rowan, 1981, p. 113). L’approche connexe de l’enquête naturaliste est, de façon similaire, centrée sur les participant·es « parce que ce sont leurs constructions de la réalité que l’enquêteur·ice cherche à reconstruire » (Lincoln et Guba, 1985, p. 41).
Les méthodes qualitatives sont préconisées au sein de toutes ces approches en raison de leur flexibilité particulière. Elles peuvent notamment représenter des compréhensions spécifiques au contexte et protéger contre le risque d’écraser les subjectivités intérieurement structurées des participant·es sous des systèmes de signification « objectifs », imposés de l’extérieur (Griffin, 1986). En évitant la distance supposée par le positivisme, les chercheuses du paradigme qualitatif2 s’efforceront souvent d’établir des rapports et des relations de coopération avec leurs participant·es, et de se débarrasser des idées préconçues et des hypothèses culturelles qui pourraient constituer un obstacle à la compréhension. De cette manière, les chercheuses peuvent connaître, apprécier et refléter les expériences et les cadres de référence de leurs participant·es, vus de l’intérieur.
Enfin, les chercheuses en ethnographie conservent simultanément une perspective d’« outsiders » ou d’« étrangers ». L’objectif est d’éviter d’adopter totalement un point de vue d’insider (ou d’« attitude naturelle ») qui rendrait plus difficile la reconnaissance des présupposés culturels tacites. Ensemble, ces caractéristiques forment la condition sine qua non de la plus grande partie de la recherche qualitative.
Dilemmes de la recherche qualitative féministe
L’argument selon lequel les approches et les méthodes qualitatives sont utiles compte tenu des préoccupations pratiques, épistémologiques et éthiques des chercheuses féministes, est convaincant. Cependant, il existe un certain nombre de dilemmes non résolus qui impliquent que la recherche féministe qualitative ne soit probablement pas totalement exempte de problèmes. Cette section présente trois de ces dilemmes, comme préalable à l’examen de certains développements contemporains de la théorie et de la recherche féministes.
Quantité et qualité : un faux dualisme ?
Il est clair qu’il existe de solides raisons philosophiques et pragmatiques à l’association historique entre la quantification et le positivisme, d’une part, et entre la recherche qualitative et la critique féministe, ou du nouveau paradigme, d’autre part. Toutefois, ces connexions ne sont pas absolues ou nécessaires. Toby Jayaratne (1983), Rhoda Unger (voir Kitzinger, 1989), ainsi que Letitia Peplau et Eva Conrad (1989) soutiennent tou·tes que les méthodes quantitatives peuvent être utilisées en sciences sociales pour contester les affirmations substantielles fondées sur des biais de genre. Par exemple, les chercheuses féministes peuvent être plus à même de provoquer des changements politiques (lorsque cette volonté existe) en travaillant à l’intérieur de la rhétorique des enquêtes représentatives et de la quantification « exacte » (Fonow et Cook, 1991 ; Griffin et Phoenix, 1994 ; Reinharz, 1992 : ch. 4)3. En outre, les procédures de recherche quantitative et qualitative peuvent toutes deux être interprétées comme des formes de la même pratique analytique de la re-représentation, au sens où elles cherchent toutes deux à arranger et à ré-arranger l’enchevêtrement des données « brutes » (Latour, 1987). Ensemble, ces arguments mettent en garde contre le rejet total de la quantification, même si, pour des raisons que nous expliquons plus loin, ils ne remettent pas en cause la nécessité de théoriser le lien entre les approches et méthodes qualitatives et la recherche féministe.
L’éthique
Les méthodes qualitatives peuvent rendre les études scientifiques plus éthiques en accroissant la collaboration, en donnant une voix aux participant·es, etc. Toutefois, si certains problèmes éthiques sont réduits, d’autres peuvent être exacerbés. Par exemple, Janet Finch (1984) reconnaît que ses participant·es furent beaucoup plus exposé·es à certaines formes d’exploitation que dans le cadre d’une recherche quantitative et positiviste. Cela s’explique par le fait qu’en tant que femme sympathique, elle s’est vue accorder un accès privilégié à des espaces privés de la vie de ses participant·es. Favoriser pendant un certain temps les relations entre la chercheuse et la personne enquêtée amplifie également l’effet de l’interruption de la relation : « Plus l’intimité, l’apparente réciprocité de la relation entre la chercheuse et l’enquêté·e est importante, plus important est le danger » (Stacey, 1988, p. 24 ; voir également Shaffir et Stebbins, 1991). En outre, les lesbiennes féministes se sont tournées vers des tests et des échelles quantitatives pour contrer les tendances hétérosexistes des études cliniques, principalement qualitatives, qui avaient initialement pathologisé la santé mentale des lesbiennes (Kitzinger, 1990).
Ces exemples de dilemmes éthiques remettent en question l’idéal implicite selon lequel la recherche qualitative fait toujours partie d’un processus libre et démocratique (voir Gubrium et Silverman, 1989 ; Ribbens, 1989 ; Phoenix, 1990). Il est tout simplement naïf de supposer que les méthodes qualitatives ne sont pas concernées par les problèmes de relations de pouvoir asymétriques dans un contexte de travail de terrain. Par conséquent, nous défendons le point de vue selon lequel les chercheur·euses adoptant des méthodes qualitatives doivent être prêt·es à s’engager dans une analyse de telles relations de pouvoir. Cela peut également aider à sortir les chercheur·euses du problème du relativisme (voir Burman, 1992).
Intégrer la dimension personnelle dans la recherche
L’intégration réflexive de la dimension personnelle dans la recherche est importante dans les sciences sociales féministes en tant que stratégie de démystification du mythe de l’objectivité totale dans la recherche scientifique. Assurément, il existe de multiples formes de « subjectivité » impliquées dans le processus de production et de justification du savoir (Landline et al., 1992 ; Henwood et Pidgeon, 1995). Il s’agit évidemment du point de vue (de l’insider) sur les participant·es à la recherche, des hypothèses, des engagements et des valeurs personnelles de la/du chercheur·euse, ainsi que des hypothèses culturelles plus larges (souvent tacites) qui déterminent les agendas de recherche et les cadres de compréhension. Un dernier aspect de la subjectivité découle des réseaux sociaux et institutionnels au sein desquels les idées scientifiques sont évaluées et légitimées.
En expliquant et en justifiant les fondements de ses analyses, la chercheuse qualitativiste devient responsable de ses interprétations et de leurs conséquences sociales et politiques sur elle-même, sur ses participant·es et sa communauté (Gill, 1995). Il s’agit là d’un aspect de l’ouverture au public du processus de recherche et de ses objectifs. Néanmoins, la pratique de la réflexivité ne renforce pas automatiquement la crédibilité d’une contribution. Bien que son importance puisse être reconnue par les perspectives féministes et les autres perspectives critiques sur les sciences sociales, les résultats de la recherche sont généralement évalués dans une discipline qui demeure largement non réflexive, ce qui a des implications pour les chercheuses féministes qualitativistes qui souhaitent présenter les résultats de leurs travaux à un public universitaire classique ou à un public plus large4.
Pluralisme méthodologique
Dans leur réflexion sur la méthode, les féministes ont toujours voulu éviter la « méthodolâtrie » (qui rend invisibles les problèmes et les questions soulevées par les chercheuses féministes, comme dans la science patriarcale, Daly, 1973), dans le cadre d’une défiance générale à l’égard de toute forme d’orthodoxie (voir Reinharz, 1985). Les arguments en faveur de la recherche qualitative ont donc toujours été contrebalancés par le souci d’éviter de remplacer simplement une orthodoxie par une autre (Kelly, 1978).
Il n’est donc pas surprenant que, durant la période récente, un point de vue couramment exprimé soit qu’il n’existe pas une unique méthode exclusivement féministe. Au contraire, la diversité des questions et des objectifs fixés par la recherche pour les femmes exige une grande variété d’approches et de méthodes (voir par exemple Clegg, 1985 ; Peplau et Conrad, 1989 ; Nielsen, 1990 ; Riger, 1992). Selon Sandra Harding (1987, p. 109), « il y a probablement peu de méthodes de collecte de preuves... qui ne peuvent pas être utilisées pour produire de l’or par les mineurs féministes ». Cette évolution vers le pluralisme méthodologique est renforcée par la reconnaissance des dilemmes (discutés plus haut) que soulève la réflexion sur l’utilisation des méthodes qualitatives.
Une suggestion connexe est que nous devrions éviter toute tendance à « idéaliser » certaines variantes de la méthode, mais plutôt examiner les exemples de ce que les chercheuses font dans la pratique et y réfléchir (Clegg, 1985). C’est pourquoi a commencé à paraître un certain nombre d’écrits sur les « modèles » de recherche féministe (voir par exemple Cook et Fonow, 1986 ; Nielsen, 1990 ; Stanley, 1990). Le plus complet de ces écrits est l’ouvrage de Shulamit Reinharz, Les méthodes féministes en sciences sociales (1992), qui souligne explicitement la pluralité des méthodes en usage.
Selon nous, l’acceptation généralisée du pluralisme méthodologique, bien que nécessaire à l’établissement d’un « climat de recherche chaleureux et accueillant pour tou·tes » (Martin, 1994, p. 651), occulte un certain nombre de positions qui pourraient être incompatibles entre elles. Par conséquent, le consensus sur ce sujet pourrait davantage relever de l’illusion que de la réalité. Au sens large, la notion de pluralisme méthodologique est purement descriptive, elle exprime la diversité des méthodes et des approches utilisées, comme en témoigne la littérature sur les modèles. Un premier problème réside dans le fait que cette lecture passe sous silence la distinction faite par Sandra Harding (1987) entre l’épistémologie (les hypothèses sur les fondements de la connaissance), la méthodologie (l’analyse théorique définissant un problème de recherche et la manière dont la recherche doit se dérouler) et la méthode (la stratégie ou technique de recherche spécifique). Si l’on se réfère au sens plus spécifique de la méthodologie chez Sandra Harding, le pluralisme méthodologique fait nécessairement partie intégrante de la diversité des théories féministes.
Un niveau supplémentaire de complexité apparaît parce que le pluralisme en général (y compris dans sa version méthodologique) définit le postmodernisme, dont l’influence est croissante sur la pensée féministe (voir par exemple Allen et Baber, 1992 ; Flax, 1987, 1992). Ici, la critique épistémologique est primordiale, car les chercheuses s’opposent aux prescriptions de méthode/méthodologiques au motif qu’il ne peut y avoir de fondements certains pour la connaissance. Enfin, la pluralité des méthodes (ou les méthodes mixtes, lorsque le choix entre la qualité et la quantité repose uniquement sur des préoccupations techniques ou pragmatiques) est également compatible avec l’empirisme à l’ancienne5. Dans ces conditions, la tendance actuelle à préconiser une pluralité de méthodes pourrait simplement réinstaurer la notion de neutralité des valeurs dans les sciences sociales. Il y a bien sûr des éléments régressifs dans cette croyance, laquelle s’oppose historiquement à la critique féministe de l’androcentrisme dans les sciences sociales6.
Michelle Barrett a affirmé que « le pluralisme est en fait devenu le plus petit dénominateur commun du féminisme » (1987, p. 32). Il s’agit sans doute d’une caractérisation excessive. Mais il est clair que nous devons regarder de l’avant et sortir de la confusion qui définit actuellement la position du pluralisme méthodologique. En particulier, il est difficile de voir comment cela résout les nombreuses questions qui ont d’abord nourri le souci d’établir une perspective féministe dans la recherche, que ce soit en termes d’objectifs politiques/émancipateurs, de préoccupation concernant l’influence transversale du genre et des asymétries de genre, ou en tant que constellation de principes ou de thèmes méthodologiques (par exemple Cook et Fonow, 1986 ; Gergen, 1988 ; Reinharz, 1992). Une façon d’aller de l’avant serait de considérer l’enquête féministe comme un « paradigme » de recherche, qui, simultanément, pose de nouvelles questions, propose de nouvelles explications ou théories, et se met en quête de procédures et de méthodes adaptées (Nielsen, 1990). Un problème se pose à cet égard, c’est que la notion de paradigme peut s’apparenter à une position trop uniformisatrice (Henwood et Pidgeon, 1994). D’un autre côté, il est tout aussi important que la vogue actuelle du pluralisme ne soit pas réduite à une position où le choix des méthodes devient une question purement technique ou non théorisée. Cela risquerait d’obscurcir le lien dialectique (c’est-à-dire méthodologique) entre la théorie et la pratique féministes.
Ainsi, par exemple, Shulamit Reinharz (1992) adopte explicitement une stratégie inductiviste pour son étude des méthodes utilisées. Cela ne peut être perçu comme un choix technique que si l’on prend pour acquis son acceptation épistémologiquement informée du principe de l’expression d’une diversité de voix de femmes. Il est également utile de garder à l’esprit l’affirmation de Wendy Hollway (1989) selon laquelle certaines méthodes (en particulier de la psychologie expérimentale et même de la psychologie humaniste) peuvent transformer les questions de recherche jusqu’à ce qu’elles se trouvent déconnectées de ce que la chercheuse féministe souhaite savoir. Ainsi, Shulamit Reinharz (1992, p. 95) admet que, bien que l’on puisse trouver des exemples d’expérimentation féministe, « il [lui] est presque impossible de présenter des “voix” féministes faisant de la recherche expérimentale », parce que les pratiques au sein de la recherche expérimentale excluent l’inscription de la dimension personnelle.
À notre avis, une raison supplémentaire pour laquelle nous ne devrions pas exclure à la légère la relation entre la théorie et la méthode — la question de la méthodologie dans le féminisme — est qu’au cœur de ce débat se trouve le statut des expériences et des récits des femmes, et leur rôle dans la justification de nos interprétations. Comme nous l’avons noté précédemment, certaines des premières chercheuses féministes ont compris qu’il fallait d’abord saisir les expériences, les conceptions et les vies des femmes elles-mêmes, envisagées de leur propre point de vue. Comme l’idée de voir à travers les yeux des participant·es est centrale dans le programme qualitativiste des sciences humaines, un lien méthodologique distinctif pourrait être forgé avec certains principes théoriques des sciences sociales féministes. Aujourd’hui, il est cependant reconnu que l’idée selon laquelle le savoir résiderait dans l’unique perspective des femmes n’est pas simple. Elle implique plutôt un débat à plusieurs niveaux sur ce que l’on entend par épistémologie du positionnement situé et ses implications pour la relation entre la théorie et la méthode. Ce débat englobe également la question de savoir comment, à la lumière de la critique postmoderne, les interprétations peuvent être justifiées et contribuer à une action politique efficace en faveur des femmes. Dans les sections suivantes, nous explorons d’abord ces développements théoriques, puis nous examinons des exemples de la manière dont ils peuvent guider la pratique de la recherche.
Défendre un féminisme du positionnement situé
Dans la pensée féministe, l’épistémologie qui s’est concentrée sur la relation entre l’expérience des femmes et la production du savoir scientifique est celle de la théorie du positionnement situé (voir par exemple Smith, 1974 Hartsock, 1983 ; Rose, 1983 ; Harding, 1986a, 1991). Les théoriciennes du positionnement situé soutiennent que la science fait partie de l’ordre social, puisque le savoir est toujours situé et construit depuis la perspective de positions et de situations sociales déterminées. Donna Haraway (1991) décrit utilement la vision positiviste traditionnelle de la science comme un « tour de passe-passe divin », parce qu’elle prétend tout voir sans se situer nulle part. En revanche, la conception de la connaissance de Donna Haraway s’apparente à la vision concrète, elle « regarde » toujours depuis quelque part. La théorie du positionnement situé intègre l’analyse des rapports de pouvoir et décrit les schémas conceptuels dominants comme le résultat d’un savoir produit exclusivement à partir des activités sociales des puissants au sein d’une société (à savoir typiquement, mais pas nécessairement, les hommes). Elle soutient ensuite qu’une assise plus complète pour le savoir ne peut être trouvée qu’en partant de la perspective des expériences et des vies des femmes, en tant qu’actrices de la société, aussi bien que de la vie d’autres groupes sociaux habituellement exclus de l’ordre social dominant.
Il existe des différences entre les positions qui ont été désignées sous le concept-valise de « positionnement situé ». Par exemple, son développement en tant que position épistémologique formalisée est plus étroitement associé au travail de Sandra Harding (l986a ; 1991). D’autres chercheuses tiennent davantage à ce que la notion reste fermement liée à la politique pratique de l’expérience des femmes qu’elle a d’abord servi à saisir (Smith, 1992).
Bien que tous les chercheur·euses soient concerné·es par le domaine personnel/politique de l’expérience, peu d’entre elleux accepteraient l’idée qu’il est possible de se contenter de tendre un miroir pour refléter les points de vue des participant·es. Cela s’explique en partie par des raisons philosophiques : les « données » sont toujours interprétées et rendues signifiantes au prisme de la théorie. Plusieurs auteur·ices l’affirment dans les débats sur la recherche qualitative, mettant en garde contre l’idée naïve qu’il serait possible de mener une recherche participative purement descriptive ; toute analyse intellectuelle implique un certain degré d’abstraction vis-à-vis de l’aspect purement phénoménologique (voir par exemple Hammersley et Atkinson, 1983 ; Hammersley, 1990). Sur ce point, les chercheuses féministes ont souligné que la théorisation implique nécessairement un examen des présupposés personnels de la/du chercheur·euse, tels qu’ils sont ancrés dans des contextes historiques, culturels et sociaux particuliers.
De nombreux exemples d’analyse féministe reconnaissent la nécessité de comprendre pleinement la perspective de la vie des femmes et de fonder la recherche sur elle, tout en soulignant l’impossibilité de se contenter de tendre un miroir à la réalité. Christine Griffin (1985, p. 102) note que nous devrions prendre « les paroles et les actions des gens au sérieux, sans nécessairement les aimer ou prendre leurs paroles pour argent comptant ». L’argument de Wendy Hollway (1989, p. 42) est que les récits
… entretiennent une certaine relation avec les événements. Mais cette relation est si complexe qu’une théorie de la signification intégrant l’histoire personnelle, la culture, les processus inconscients et les différences sociales est nécessaire pour leur conférer une signification satisfaisante.
Selon Renate Duelli Klein (1983), le point de départ de la recherche féministe consiste à adopter une position de subjectivité consciente. Cela implique que la chercheuse compare ses propres expériences et états subjectifs avec ceux d’autres femmes ; ce qui doit aussi être distingué de l’acceptation non critique de ce que les gens disent7. Du point de vue de la philosophie, Sandra Harding (1991, p. 124) est claire sur le fait que
… ce ne sont pas les expériences ou les discours [seuls] qui fournissent les fondements des revendications féministes, ce sont plutôt les observations et les théories du reste de la nature et des relations sociales qui leur sont articulées par la suite — observations et théories qui partent de la vie des femmes et regardent le monde de ce point de vue.
Un autre débat plus critique a porté sur la notion même de positionnement situé, et sur le statut apparent de la théorie du positionnement situé en tant que « science de relève » [successor science], à savoir sa position sur les questions de raison, de réalité et de vérité. Ces questions ont tendance à être débattues avec les défenseurs de la pensée postmoderniste8, qui mettent l’accent sur la multiplicité des perspectives, des voix et des subjectivités pour s’opposer à toute forme de fondationnalisme. Cela a conduit à placer l’idée de positionnement situé dans une position précaire entre l’essentialisme, d’une part, et le relativisme, d’autre part (Stanley et Wise, 1990, 1993). Plus précisément, cette idée a été accusée de « valoriser » sans esprit critique « l’expérience », en tant qu’expression d’une différence essentielle entre les femmes et les hommes, et d’impliquer un fondement ultime et individuel de la connaissance située dans l’expérience authentique de chaque femme (Barrett, 1987 ; Riley, 1987).
En ce qui concerne l’accusation d’essentialisme, de nombreuses tensions découlent de la présomption — qui peut facilement se lire dans la notion de positionnement situé —, selon laquelle les femmes constitueraient une catégorie homogène pouvant parler d’une seule voix. Cela rendrait invisible la diversité des expériences vécues parmi les femmes, par exemple dans des contextes variés en termes ethniques, sexuels et de classes sociales. Il est donc clair, comme l’affirment Liz Stanley et Sue Wise (1990, p. 33-34), que « la catégorie “femmes” doit être déconstruite », afin que le féminisme du positionnement situé puisse théoriser la diversité. Ce faisant, les théoriciennes du positionnement situé ont soutenu que la « femme » est une catégorie socialement et politiquement construite, fondée sur une expérience commune de l’oppression, bien que pour différentes femmes, elle soit toujours construite à partir de circonstances matérielles multiples et variées, c’est-à-dire que « l’expérience de la “femme” est ontologiquement fracturée et complexe » (1990, p. 22). En effet, cet élément a constitué le fondement de la première critique du positionnement situé à l’égard des écrits féministes universitaires, lesquels ne reflètent que les expériences et les analyses des « femmes du premier monde », blanches, hétérosexuelles et issues de la classe moyenne, et les considèrent comme universelles (Stanley et Wise, 1983a, 1983b).
La deuxième critique est que la théorie du positionnement situé équivaut au relativisme si la fragmentation des points de vue, en tant que simples expressions de l’expérience authentique et de la biographie individuelles (Riger, 1992), est poussée jusqu’à sa conclusion logique. Une telle critique manque en outre de force parce qu’elle écarte de manière inappropriée un principe fondamental de la théorie du positionnement situé : la collectivisation de l’expérience en tant que fonction de la position sociale des femmes (voir par exemple Currie et Kazi, 1987). De surcroît, la position de la subjectivité consciente peut être un moyen d’explorer les discontinuités et les fractures dans les récits des femmes, en tant qu’expressions de l’influence compensatoire des mécanismes idéologiques et des conditions matérielles de la vie des femmes. C’est pourquoi la critique de la théorie du positionnement situé au motif qu’elle supposerait le sujet unitaire de l’humanisme libéral, est quelque peu exagérée9.
On peut désormais affirmer que les accusations liées d’essentialisme et de relativisme renvoient à un débat qui concerne surtout la fin des années 1980. Une préoccupation récemment exprimée est que les accusations d’essentialisme peuvent devenir nuisibles, en réduisant au silence et en étouffant la recherche intellectuelle (Brennan, 1989 ; Martin, 1994). Tout comme les hypothèses d’unité catégorielle totale ou de similitude, et d’intégrité/authenticité individuelle, peuvent masquer la contradiction et la différence, le fait de ne parler que de différence peut conduire à la généralisation erronée selon laquelle tous les concepts et toutes les catégories sont nécessairement essentialistes. En cherchant à s’affranchir de ces accusations et contre-accusations, Sherry Gorelick (1991, p. 473) souligne que la différence n’implique pas inévitablement l’absence de relation. Elle plaide en faveur d’une science sociale située « cumulative » dans laquelle « les visions de chaque sous-groupe de femmes doivent réorienter ou conduire à revoir les connaissances de tous ». Un point de vue assez différent, avancé par Shane Phelan (1993, p. 769), est que nous devrions continuellement essayer de faire entrer le postmoderne dans le moderne, et que
« …cela implique l’allégeance simultanée aux catégories de vérité et de raison et la perturbation et la remise en question permanentes — parfois même le rejet — de ces catégories (voir également Harding, 1986b). »
Chacun de ces éléments suggère qu’il est possible pour les féministes du positionnement situé de réintégrer le souci de la diversité et des subjectivités multiples dans une perspective ou un point de vue qui peut constituer la base d’une action politique au nom des femmes.
Une autre raison de soutenir le féminisme du positionnement situé tient à la nécessité de justifier la validité des revendications de connaissances de notre recherche. Toutes les épistémologies qui rejettent l’idée de fondations absolues du savoir, fondées soit sur l’expérience directe, soit sur les règles de la méthode scientifique, sont confrontées à cette même tâche. Le postmodernisme résiste à la nécessité de répondre à une telle question en défendant l’incommensurabilité et l’acceptation pluraliste de revendications conflictuelles en matière de connaissance.
La théorie féministe du positionnement situé s’oppose au glissement vers un relativisme total en insistant sur le fait que les chercheuses peuvent générer des croyances moins partielles et moins distordues en partant de la perspective des groupes marginalisés. Cela signifie implicitement que les groupes marginalisés peuvent avoir une vision particulière, en tant qu’étrangers aux cadres de pensée patriarcaux dominants, puisqu’ils peuvent voir ce qui est invisible depuis l’intérieur de cet ordre. Sandra Harding (1991) appelle cela la position des « outsiders de l’intérieur » (voir aussi Hill-Collins, 1991)10. Les chercheuses du point de situé soulignent également l’importance de révéler de manière réflexive toute la gamme des influences personnelles et sociales qui jouent inévitablement un rôle dans la forme que revêt le savoir (voir par exemple Wilkinson, 1988). De cette manière, il est possible de rendre compte de manière plus complète, et donc plus satisfaisante, des fondements du savoir. En reconnaissant pleinement les conditions de sa propre production, la science du positionnement situé peut atteindre une plus grande objectivité, ce que Harding (1991, 1992) appelle l’objectivité forte ou l’objectivité subjective (voir aussi le concept d’objectivité féministe de Haraway, 1991).
Bien que le féminisme du positionnement situé soit une tentative sérieuse de répondre à la crise du relativisme dans l’épistémologie moderne, il ne va pas sans controverse à cet égard. Mary Hawkesworth (1989, p. 539) note que le degré d’intérêt porté aux sources de la connaissance a empêché de progresser sur les questions de justification et de validité en permettant
« … à un certain nombre d’hypothèses épistémologiques contestées, portant sur la nature de la connaissance, sur les normes de la preuve et les critères d’évaluation, d’être incorporées de manière irréfléchie dans les argumentations féministes. »
De plus, Loraine Gelsthorpe (1992, p. 215) affirme que
« La compréhension de la production de connaissances exige plus que de partager du mieux que l’on peut le processus d’acquisition du “savoir” et du “savoir” d’un point de vue particulier. Il faut être capable de distinguer les “connaissances bonnes et utiles” des “connaissances moins bonnes et moins utiles11”. »
Suite à ce débat, divers ajouts ont été intégrés aux propositions de Sandra Harding pour justifier les connaissances générées à partir de différents points de vue (voir par exemple Cain, 1986). Selon Joyce McCarl Nielsen (1990), ils comprennent des considérations critiques, herméneutiques et empiriques, mais elles ne prétendent pas éluder les questions théoriques centrales des expériences des femmes, de l’engagement émotionnel et politique de la/du chercheur·euse, et des relations de genre ou de pouvoir dans le processus de recherche (Ramazanoglu, 1992). L’exemple le plus développé est sans doute la tentative de Kum-Kum Bhavnani de déterminer des questions qui définissent les unes après les autres des critères et des principes pour la mise en œuvre de la conception de l’objectivité féministe de Donna Haraway. Les suggestions de Kum-Kum Bhavnani (1993, p. 98) sont d’abord que, dans le cadre de sa responsabilité vis-à-vis du projet global des féminismes, la recherche « ne peut pas être complice des représentations dominantes qui rétablissent l’inégalité ». Deuxièmement, il découle d’une préoccupation pour le pouvoir et le positionnement que la/le chercheur·euse doit s’intéresser à la micropolitique de la conduite de la recherche. Troisièmement, étant donné la partialité de tous les savoirs, les questions de différence ne doivent pas être supprimées, mais intégrées à la recherche. Ensemble, ces trois considérations sont recommandées comme un moyen d’établir des liens créatifs et dynamiques au sein de la recherche féministe afin que « la partialité de la vision ne soit pas synonyme de partialité de la théorisation » (1995, p. 97).
Au-delà du pluralisme méthodologique : exemples d’analyses féministes qualitatives pertinentes
Bien qu’elle mette l’accent sur la question du pluralisme et en raison de son épistémologie antiréaliste, le postmodernisme privilégie le texte. Les empiristes adoptent des méthodes mixtes dans un cadre positiviste. En dessinant le paysage intellectuel changeant des débats sur l’épistémologie et la méthodologie féministes, notre intention dans cet article a été d’ouvrir les espaces intermédiaires, d’examiner plus avant s’il y a lieu d’établir un lien méthodologique entre la théorie du point de vue situé et la recherche qualitative. Cette tâche est menée à bien dans cette dernière section, en présentant deux excellents exemples d’analyse qualitative comportant un engagement féministe déterminant, l’un utilisant l’approche de la théorie ancrée [grounded theory] et l’autre une forme de déconstruction. L’objectif de cette démarche est d’identifier certaines caractéristiques de l’analyse qualitative féministe — en particulier celles relatives aux questions de fondations et de profondeur — qui peuvent renforcer les revendications d’objectivité féministe. Ce faisant, nous ne souhaitons pas affirmer qu’il existe une relation nécessaire et exclusive entre la qualité et le point de vue situé. Notre position est plutôt qu’il est important de reconnaître où des liens théoriques particuliers peuvent être utilement établis. De plus, l’exercice est précieux dans la mesure où il met en lumière des stratégies analytiques et de présentation utiles qui ont été développées ou adaptées par des chercheuses féministes qualitativistes, et qui pourraient être mises à disposition pour une utilisation plus large.
L’idée que la recherche doit être bien fondée est largement répandue dans le discours féministe et d’autres discours critiques. Elle est parfois utilisée comme une déclaration rhétorique pour signifier la « justesse » [goodness] d’une interprétation ou d’un travail. Cependant, la théorie ancrée a été introduite pour la première fois en tant que terme spécifique par les sociologues Barney Glaser et Anselm Strauss (1967). Il y a deux raisons immédiates pour lesquelles la notion de théorie ancrée est utile aux objectifs féministes : la première est le souci de localiser la théorie dans le monde des participants ; la seconde est de contribuer au processus visant à sortir des limites de la théorie androcentrique. L’approche de la théorie ancrée identifie des stratégies spécifiques pour l’analyse étroite et détaillée du matériel qualitatif non structuré, et pour la génération d’une nouvelle théorie12.
Liz Stanley et Sue Wise (1983a) ont cependant critiqué à juste titre cette approche pour avoir été formulée à l’origine dans un langage sexiste et pour avoir mis en avant une forme de positivisme inductiviste. Cela apparaît, par exemple, dans l’accent mis sur l’« émergence » des catégories ou la « découverte » de la théorie à partir des données. Par conséquent, Cathy Charman (1990) a plaidé en faveur d’une nouvelle vision constructiviste de la théorie ancrée (voir également Henwood et Pidgeon, 1995). À cet égard, il est désormais clair que la pratique de l’interprétation qualitative implique une interaction plus complexe et constante entre le matériel de recherche et la conceptualisation, un « va-et-vient » entre les idées et l’expérience de la recherche (Bulmer, 1979 ; Henwood et Pidgeon, 1992). En discutant de l’utilisation de la théorie ancrée dans la recherche féministe, Dawn Currie (1988) la décrit de la même manière comme un « processus dialectique » entre l’expérience et la conscience de la chercheuse et de ses participant·es, où les deux sont informés et se développent par l’échange réciproque13.
La notion constructiviste d’ancrage [grounding] est précieuse parce qu’elle fait appel à une métaphore de la profondeur (Parker, 1994), allant au-delà du simple reflet de la réalité, pour explorer les strates multiples et fissurées des subjectivités qui se cachent sous la surface. La théorie féministe du point de vue situé recourt à la même métaphore lorsqu’elle s’attache à rendre visible l’invisible — à mettre en évidence ce qui est dissimulé sous la surface du sens commun idéologique — en recherche d’une forte objectivité14. Cette conception de la recherche féministe du point de vue situé comme une quête de profondeur, mais sans les certitudes d’un fondationnalisme absolu, comporte en soi un engagement à rechercher une vision plus profonde de la « réalité » (objectivité forte) tout en évitant la réinscription (Bhavnani, 1993) ou l’appropriation de « l’autre » (Opie, 1992) à l’intérieur de schémas conceptuels dominants mais superficiels. Des exemples de la manière dont un équilibre entre ces deux considérations peut être atteint nous permettent de voir certains des avantages de la recherche qualitative du point du vue situé.
Premier exemple
L’étude de Dawn Currie (1988) sur la prise de décision en matière de reproduction est un excellent exemple d’étude de théorie ancrée, fondée sur des entretiens avec 76 femmes à Londres. S’inspirant de l’approche de Barney Glaser et Anselm Strauss, elle met en lumière les codes in vivo des délibérations sur la maternité, du bon moment et des sentiments de conflit et de culpabilité, et cherche à établir une analyse théorique dense, nuancée et multidimensionnelle des liens qui existent entre eux. Dawn Currie documente le mélange de thèmes positifs et négatifs dans les attitudes et les perceptions de la maternité de ses participantes. Elle affirme qu’ils suggèrent une ambivalence à l’égard de la maternité, celle-ci étant plus précisément perçue comme offrant un choix « impossible » de récompenses relationnelles, mais immanquablement au prix de désavantages matériels. En l’absence de raisons concluantes pour se décider pour ou contre la maternité, les décisions des participantes reposaient en fin de compte sur la notion de bon moment. D. Currie interprète ce fait comme une résolution personnelle de ses répondantes face aux contraintes matérielles qui pèsent sur la maternité (par exemple, en atteignant la sécurité financière et professionnelle, et la capacité de payer des services de garde d’enfants). Et elle note qu’« en discutant de leurs expériences dans un contexte biographique de “temps” plutôt que dans un contexte social de “processus”, la prise de décision des femmes restait souvent inexplicable, même pour elles-mêmes » (1988, p. 248). En outre, elle identifie la rhétorique de la liberté reproductive comme un obstacle idéologique à la prise de conscience qu’elles avaient intériorisé des antagonismes structurels comme étant d’ordre personnel. Dans le prolongement de son analyse, D. Currie en est venue à constater que les sentiments de conflit et de culpabilité dans la prise de décision des femmes étaient le résultat inévitable de leur personnalisation des problèmes engendrés par des processus structurels d’ordre matériel. Cela se produisait indépendamment de la décision finale des femmes d’avoir ou non des enfants.
Dawn Currie parvient à une profondeur d’analyse grâce à la manière dont elle entremêle les détails du discours de ses participants avec ses propres lectures en tant que chercheuse féministe et sociologue de formation. La stratégie résolument qualitative de l’analyse comparative constante — l’exploration systématique des différences et des similitudes entre et à l’intérieur des catégories et des récits (comprenant à la fois les récits des participantes et de la chercheuse) — est clairement, dans ce cas, un bon exemple de la position de la subjectivité consciente15. Elle précise également les cas où elle a élevé les catégories descriptives à un niveau analytique. On le voit, par exemple, lorsqu’elle identifie le « bon moment » comme un euphémisme, puisqu’il ne réfère pas du tout au temps chronologique, mais plutôt à une configuration de circonstances matérielles. Ce faisant, elle est en mesure de produire une analyse qui n’est pas seulement détaillée et dense sur le plan descriptif, mais qui est passé au tamis et solidement structuré à de multiples niveaux d’abstraction.
Ensemble, ces dispositifs, qui à notre avis sont à la fois pratiques et textuels, montrent le caractère « construit » de son analyse, c’est-à-dire qu’ils sont construits à partir de la juxtaposition de perspectives et de voix multiples. Sont par-là mis en évidence les liens entre les sources du savoir et les analyses produites, Dawn Currie écrit de manière réflexive le long, et sur la base, du processus de son interprétation théorique émergente. Elle évite de relativiser la différence en assumant son argumentation à partir d’une voix autoriale (la sienne propre, mais en s’appuyant également sur d’autres voix qui font référence). Dans le même temps, elle équilibre toutefois cette position par l’adoption d’une position de non-appropriation qui consiste à faire mention des contradictions et des différences chaque fois qu’elles apparaissent significatives.
Deuxième exemple
Tenter de résoudre la tension entre le refus de l’appropriation et la justification des affirmations scientifiques n’est pas chose simple. En fin de compte, comme le souligne Anne Opie (1992), l’appropriation ne peut jamais être complètement éradiquée, mais seulement atténuée16. Dans sa recherche sur le care au sein des familles, A. Opie fait appel à la valeur de la déconstruction comme moyen de mobiliser des pratiques textuelles spécifiques pour atténuer l’appropriation. Il s’agit notamment d’être explicite sur la contingence et l’incomplétude du savoir de la chercheuse et des participant·es, d’être attentive au paradoxe, à la contradiction et à la marginalité au cours de la construction d’une lecture analytique, et d’écrire à plusieurs voix, les critères d’inclusion des extraits comprenant des caractéristiques textuelles de présentation et de représentation (par exemple, l’intensité affective, la complexité émotionnelle et la non-redondance dans le discours) aussi bien que de contenu. En outre, Anne Opie met en avant la notion de « dualité de positionnement » (dans laquelle le sujet est à la fois sujet d’une volonté et exploité/réprimé), ce qui l’amène à réexaminer continuellement « la mesure dans laquelle l’idéologie contribue à l’incapacité de voir au-delà d’elle » (1992, p. 57-58). Perturber et remettre en question les différences atténuées par l’idéologie est considéré par Anne Opie comme un moyen d’autonomiser ses participant·es, en les libérant d’une position de marginalité et en levant le voile qui rend invisible les détails de leurs vies quotidiennes.
Ayant analysé les textes d’entretiens avec 28 pourvoyeur·euses de care familiaux (conjoint·es et enfants adultes), Anne Opie considère que les récits de ses participant·es soutiennent, dans l’ensemble, les analyses féministes de la nature exploiteuse du care prodigué aux personnes dépendantes, malades ou vieillissantes. À l’appui de cette thèse, deux thèmes in vivo ont été mis en évidence : le stress et la monotonie du quotidien, ainsi que les effets destructeurs du care sur la qualité affective de la relation. La lecture attentive (et, selon ses propres termes, déconstructive) qu’Anne Opie fait des récits de ses participant·es attire toutefois l’attention sur les moments brefs et ambigus d’amour et d’affection qui leur permettent de maintenir et de valoriser un engagement dans le care. Elle appelle ces moments des moments idéologiques, car ils sont interprétés comme représentant des occasions de résistance à la micropolitique du pouvoir axée sur une seule orientation idéologique du care. Le statut de ces tactiques de résistance dans l’ensemble des théories féministes du pouvoir et des relations de domination/subordination peut très bien faire l’objet d’un débat (Hartsock, 1990). Malgré cela, il nous semble clair que l’analyse d’Anne Opie est considérablement enrichie et approfondie par sa pratique consistant à s’appuyer sur les contradictions entre l’expérience (dans laquelle le care n’est pas toujours défini comme de l’exploitation) et 1’idéologie (où il l’est) pour construire les mondes de vie des pourvoyeur·euses de care familiaux.
Les recherches d’Anne Opie sont un exemple utile d’analyse féministe qualitative qui tente de concilier les préoccupations du point de vue situé et du postmodernisme, elle est claire sur le fait que « l’analyse déconstructive nécessite l’accès détaillé au monde de la participante » (1992, p. 57). En décrivant son approche, elle se montre intransigeante sur la nécessité de « représenter de manière adéquate la complexité des expériences » dans lesquelles « sont ancrés les textes [de la participante] » (1992, p. 52). À notre avis, cela équivaut à un engagement en faveur de la profondeur, comme elle l’illustre également lorsqu’elle plaide pour le développement « de représentations plus complètes17 du care » (1992, p. 55). En conséquence, son travail s’accorde parfaitement avec certains des principes fondamentaux du féminisme du point de vue situé. L’approche d’Anne Opie diffère bien sûr de celle de Dawn Currie en ce qu’elle s’inscrit dans un cadre de référence spécifiquement postmoderniste. Toutes deux expriment un engagement plus général en faveur des atouts distinctifs de l’analyse qualitative, dans la mesure où elles cherchent à explorer et à célébrer les ressources théoriques offertes par la différence. En outre, Anne Opie vise explicitement à élargir le champ de la critique pour y inclure ce que l’on tient pour acquis dans les cadres existants de l’analyse féministe. En poussant ces arguments plus loin, elle indique clairement que sa position théorique conduit à une position qualitativiste, arguant que la « valorisation de la quantité » sert à dissimuler l’importance d’événements qui soit sont fugaces, soit sont peu fréquents, soit dont on parle peu. À notre avis, il s’agit là de quelques-unes des raisons durables pour lesquelles la théorie du point de vue situé (qui partage le même souci de rendre visible ce qui est habituellement invisible) pourrait encore avoir un lien méthodologique avec certaines des stratégies offertes par la recherche qualitative.
Remarques conclusives
L’un des objectifs de cet article était de fournir une ressource qui retrace l’évolution de la réflexion sur la recherche qualitative et sa relation avec l’épistémologie, la méthodologie et la méthode féministes. De plus, nous souhaitions examiner et justifier une position argumentée (même si elle passée de mode à certains égards !), qui associe certains principes de la théorie du point de vue situé à la pratique de la recherche qualitative. Dans certaines circonstances, il peut être utile de traiter les approches et méthodes qualitatives/textuelles et quantitatives/numériques simplement comme des technologies de représentation interchangeables. Cependant, il serait selon nous erroné de négliger la position opposée de ces termes dans les systèmes culturels et sémiotiques de signification, qui permettent de distinguer (au moins deux) pratiques de représentation comme étant de nature différente. En outre, s’il est vrai, comme nous l’avons soutenu, que la position indubitablement utile du pluralisme méthodologique a néanmoins ses limites, notre article a peut-être aussi identifié certaines tendances porteuses pour l’avenir.
Nous avons également cherché à explorer l’espace actuellement disputé entre l’épistémologie du point de vue situé et le postmodernisme. Ce faisant, nous n’avons pas cherché à résoudre le large éventail de dilemmes que ce projet soulève. Par exemple, nous n’avons pas cherché à savoir si le point de vue situé peut incorporer de manière adéquate une analyse des subjectivités des puissants. Notre projet était plus modeste, bien que polémique, et a consisté à remettre en question l’idée selon laquelle tout mouvement allant du modernisme (le point de vue situé) au postmodernisme, peut être un mouvement totalement unidirectionnel, passant de l’ignorance à l’illumination.
L’article se termine par des exemples de recherches féministes du point de vue situé qui adoptent un mode d’analyse qualitatif et textuel. Nous avions ici à l’esprit l’objectif spécifique de dégager des pratiques et des principes analytiques que nous estimons utiles pour la recherche sur le point de vue féministe. En outre, cela fait également partie d’un engagement méthodologique en faveur de la profondeur afin d’éviter un relativisme extrême, tout en atténuant les risques d’appropriation en tenant compte des contradictions et des différences au sein et entre les récits des participant·es et ceux des chercheur·euses. Ces engagements sont essentiels si nous voulons pouvoir prétendre à l’objectivité féministe. Théoriser (par opposition à relativiser) la différence dans le cadre de la théorie féministe du point de vue situé exige d’intégrer des voix provenant de positions et de perspectives multiples, qui serviront de base à une révision du privilège de la perspective partielle.
En 1983, Renate Duelli Klein affirmait que les objectifs de la recherche féministe seraient mieux servis en « regardant “en avant” » et en inventant, créant, changeant, adaptant et améliorant les méthodologies de recherche existantes ... [plutôt qu’]... en travaillant “à rebours” (1983, p. 98). En cherchant à « refaire le lien », nous ne souhaitons pas non plus nous attarder sur le passé, mais plutôt faire avancer les débats sur la pratique et la méthode à la lumière du développement continu et créatif des concepts théoriques et épistémologiques au sein de la recherche féministe. Nous pensons qu’un programme plus large a maintenant été établi, de sorte que nous pouvons commencer à développer une meilleure appréciation de la position particulière que la recherche qualitative occupe au sein des sciences sociales féministes.
Remerciements
Nous souhaitons remercier Renate Klein, Harriette Marshall, Helen Smith, Jonathan Smith et les deux évaluateurs anonymes pour leurs critiques détaillées et incisives des versions précédentes de cet article, ainsi que Sue Wilkinson pour ses encouragements et pour nous avoir guidé·es à travers les différents points de vue qui ont été apportés à notre projet.
Droits de reproduction
Henwood, K., & Pidgeon, N. (1995). Remaking the link: Qualitative research and feminist standpoint theory. Feminism & psychology, 5(1), 7-30. © Sage Publications, Inc. Le comité éditorial remercie les auteur·ices pour avoir donné l’autorisation de traduire leur article. Il remercie également l’éditeur pour les droits de reproduction.