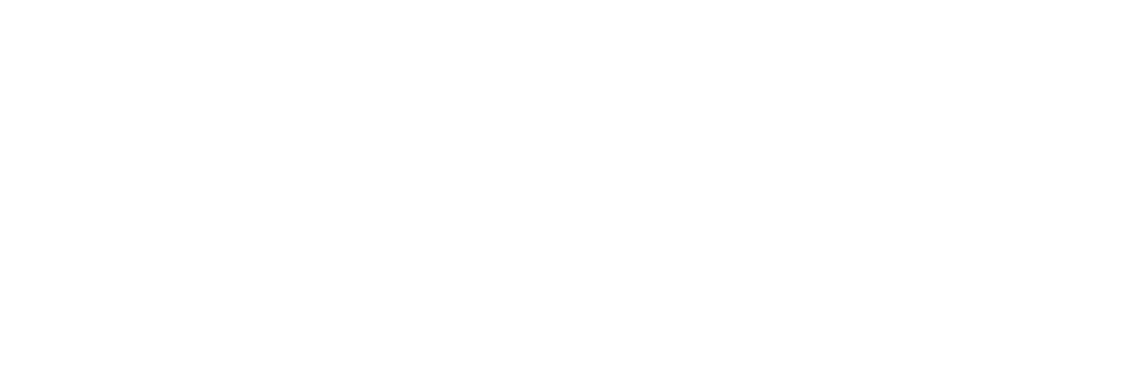Introduction
« Les homosexuels on n’en veut pas. Un enfant il a besoin d’un papa et d’une maman et pas de deux mamans ». Cette phrase a été prononcée par une enfant de dix ans, interrogée par les journalistes de France Inter le 5 octobre 2014 alors qu’elle marchait au sein d’un cortège organisé par La Manif Pour Tous (LMPT) (France Inter, Journal de 19h). Il s’agit d’un exemple, parmi tant d’autres, de propos auxquels les personnes homosexuelles se sont retrouvées exposées lors des différentes actions de ce mouvement, particulièrement médiatisé.
Les études empiriques montrent une plus grande prévalence des troubles psychopathologiques, notamment les troubles de l’humeur et les troubles dépressifs, chez les personnes homosexuelles que chez les personnes hétérosexuelles (Bostwick et al., 2010 ; Pakula et al., 2016 ; Pakula et Shoveller, 2013 ; Williams et al., 2021). Ces résultats suggèrent donc que les personnes homosexuelles seraient, comparativement aux personnes hétérosexuelles, plus à risque de présenter une santé mentale altérée. Par ailleurs, il semble exister, chez ces personnes, un lien entre la santé mentale et la formation de l’identité sexuelle (Jaspal et al., 2022 ; Kranz et Pierrard, 2018 ; Rodriguez et al., 2017). Une identité sexuelle associée à des représentations négatives et faiblement intégrée à l’identité globale s’accompagne d’une plus grande détresse psychologique ainsi que d’un plus grand nombre de symptômes anxio-dépressifs (Jaspal et al., 2022 ; Waterman et al., 2013).
Afin de mieux comprendre les problématiques affectant la santé mentale des personnes homosexuelles, il s’agirait donc de s’intéresser aux processus sous-tendant la formation de leur identité sexuelle. Pendant longtemps, les auteur·es étudiant le développement de l’identité sexuelle chez les personnes homosexuelles ont insisté sur l’importance du coming out. La révélation de son homosexualité aux autres était considérée comme essentielle à l’avènement d’une identité positive et intégrée (Carrion et Lock, 1997 ; Cass, 1979 ; Coleman, 1982 ; Rasmussen, 2004 ; Van De Meerendonk et Probst, 2004). Toutefois, dans des études qualitatives plus récentes, le coming out à soi-même est décrit par les participant·es comme le moment le plus difficile de leur développement identitaire (Guittar, 2013 ; Klein et al., 2014). Les personnes homosexuelles ont tendance à accorder une valeur plus grande à cette étape qu’à l’annonce de leur identité sexuelle aux autres (Guittar, 2013 ; Klein et al., 2015). Ainsi, Rosenberg (2017) développe, plus tardivement, le concept de coming in pour définir ce processus intérieur de découverte et de compréhension de soi au terme duquel un individu accepte et assume son identité sexuelle.
L’homophobie de l’environnement est présentée comme venant compliquer ce processus de coming in (Kiperman et al., 2022 ; Klein et al., 2015 ; Rosenberg, 2017). L’homophobie désigne le fait de dénier et de dénigrer tout comportement, identité, relation ou communauté homosexuels tout en faisant la promotion incessante de la supériorité de l’hétérosexualité (Herek, 1990). Cette homophobie s’exprime notamment par l’agression, la stigmatisation et la discrimination des personnes homosexuelles (Bostwick et al., 2014). Une études quantitative réalisée par Kiperman et collaborateurs (2022) montre que plus les personnes sont victimes d’agressions homophobes par leurs pairs, plus l’acceptation de leur identité sexuelle s’avère difficile. La théorie de l’identité sociale permet de comprendre que la construction identitaire est motivée par le besoin de renforcer son estime de soi et son sentiment d’efficacité personnelle ainsi que par le besoin d’être reconnu socialement (Breakwell, 2015 ; Brown, 2019 ; Jaspal et Breakwell, 2014). Les individus vont ainsi avoir tendance à chercher à s’identifier à des catégories socialement valorisées (Crocker et Luthanen, 1990). De cette manière, l’homophobie vient entraver et compliquer le processus de coming in, en tant qu’elle contribue à présenter l’homosexualité comme étant une identité sexuelle dévalorisée, non désirable (Jaspal, 2022 ; Marzetti et al., 2022 ; Vignoles, 2011).
Certains contextes spécifiques ont été mis en avant comme pouvant causer une intensification de la stigmatisation et de la discrimination des personnes homosexuelles. Cela est notamment le cas de la période de débat public ayant lieu à l’occasion de la légalisation du mariage homosexuel dans certains pays du monde (Casey et al., 2020 ; Russel, 2004 ; Riggle et al., 2005). Des études quantitatives réalisées en Australie et en Irlande montrent qu’être exposé·es au discours des opposants a des effets négatifs durables sur la santé mentale des personnes homosexuel·les (Casey et al., 2020 ; Dane et al., 2016 ; Verrelli et al., 2019). En France, le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe est déposé au Parlement en novembre 2012. Il fait l’objet de débats intenses et connaît une forte opposition (Fracchiolla, 2015). La campagne contre la légalisation du mariage homosexuel est en majeure partie menée par le mouvement autodénommé « La Manif Pour Tous », regroupant plusieurs associations. Les partisan·es de LMPT revendiquent le maintien d’une discrimination institutionnelle envers les personnes homosexuelles : iels souhaiteraient en effet empêcher les couples homosexuels d’accéder au droit au mariage et à l’adoption (Fracchiolla, 2015). LMPT est à l’origine des manifestations et des actions les plus importantes, que ce soit en termes d’effectif ou d’impact médiatique (Fracchiolla, 2015).
A notre connaissance, aucune étude en psychologie ne s’est encore intéressée aux liens pouvant exister entre le mouvement de LMPT et la santé mentale des personnes homosexuelles. Il s’agirait de s’intéresser plus particulièrement aux personnes homosexuel·les ayant grandi dans une famille participant à LMPT, en tant qu’iels ont été directement confronté·es au discours de ce mouvement porteur de représentations homophobes. Le coming in constituant une cible d’intervention fondamentale lorsqu’il s’agit de promouvoir le bien-être des personnes homosexuelles, il est nécessaire de s’intéresser à cette expérience de manière soutenue. Cela nous amène à nous interroger sur la façon dont les personnes homosexuelles ayant grandi dans des familles ayant été impliquées dans LMPT ont vécu leur coming in. Il s’agira d’explorer leur expérience subjective dans ses dimensions représentationnelles, interpersonnelles, émotionnelles ainsi que d’investiguer les processus par lesquels elles mettent en sens cette expérience.
Si nous parvenons à obtenir un aperçu plus détaillé des spécificités de l’expérience de coming in de ces personnes, nous pourrons penser des dispositifs de soutien psychique et d’accompagnement plus adaptés, afin de limiter les effets délétères de l’homophobie sur leur bien-être.
Méthodologie
La philosophe et militante afro-américaine bell hooks (1989) nous renseigne sur l’importance de donner la parole directement aux personnes issues de groupes minoritaires. Avoir la possibilité de faire entendre leur voix propre, de raconter leur expérience, permet aux personnes discriminées et stigmatisées de sortir de la position d’objet et de prendre une place de sujet (hooks, 1989). Ainsi, nous avons choisi d’adopter une méthodologie qualitative, centrée autour de la réalisation d’entretiens. Au cours de cette étude, nous avons pris soin de suivre les lignes directives COREQ (Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research) destinées à la recherche qualitative (Gedda, 2015 ; Tong et al., 2007).
Participant·es et procédure de recrutement
Nos critères d’inclusion sont les suivants : (1) être majeur·e ; (2) s’identifier comme homosexuel·le ; (3) avoir grandi dans une famille ayant participé à LMPT ; (4) avoir lu la lettre d’information et signer le formulaire de consentement ; (5) avoir une maîtrise suffisante de la langue française pour participer aux entretiens. Nos critères d’exclusion sont les suivants : (1) retirer son consentement au cours de la recherche ; (2) s’identifier comme bisexuel·le ou pansexuel·le. En effet, le discours de LMPT ciblant spécifiquement les personnes homosexuelles, leur expérience était susceptible d’être la plus évocatrice des potentielles difficultés attachées au processus de coming in, lorsque celui-ci se déploie dans un environnement délétère.
Le recrutement des participant·es a eu lieu entre février et avril 2024. Des affiches présentant l’étude ont été déposées dans les locaux de plusieurs associations LGBTI+ (Le Centre LGBTI+, Le Dorothy, Le MAG…), avec l’objectif de pouvoir, par ce biais, toucher des personnes s’identifiant comme homosexuelles. L’une de ces affiches a également été postée sur des groupes incluant, sur les réseaux sociaux, des personnes LGBTI+ dont les familles étaient impliquées dans LMPT. De plus, chaque participant·e était invité·e à promouvoir le projet au sein de son propre cercle de connaissances. Si les personnes acceptaient de participer à l’étude, elles recevaient la note d’information et remplissaient le formulaire de consentement.
Recueil des données
Les entretiens se sont déroulés en présentiel, dans des cafés sélectionnés pour leur calme et leur caractère confidentiel. Ce sont les participant·es qui ont suggéré ces lieux. Il semblait que, face au caractère potentiellement stigmatisant des thématiques abordées, le fait de se rencontrer dans un environnement qui, tout en restant calme et contenant, apparaissant plus informel et décontracté, pouvait contribuer à faciliter les échanges. Ces entretiens étaient réalisés par LK (première autrice), sensible aux questions de genre ainsi qu’aux théories féministes et s’identifiant elle-même comme homosexuelle.
Les informations ont été récoltées au moyen d’entretiens semi-directifs, de manière à permettre aux participant·es de produire un discours spontané sur leur expérience de coming in (Flahault et al., 2022). Les entretiens étaient conduits à partir d’une question unique : « Est-ce que vous pourriez me parler de la manière dont vous avez pris conscience de votre homosexualité ? ». Des reformulations, des relances et des questions d’approfondissement ont été utilisées afin d’explorer plus en détails l’expérience des participant·es. Cette consigne large avait pour objectif de ne pas induire de biais de réponse, notamment concernant le lien entre leur coming in et le contexte familial dans lequel iels ont grandi.
Les échanges ont été enregistrés au moyen d’un dictaphone puis retranscrits et systématiquement anonymisés. Chaque participant·e a eu la possibilité de choisir iel-même son propre pseudonyme, de précédents travaux ayant montré la pertinence de ce choix méthodologique pour les recherches s’adressant aux personnes LGBT+ (Marzetti et al., 2022 ; Vincent, 2018). Une fois ces retranscriptions effectuées, les enregistrements originaux ont été détruits.
Méthode d’analyse
Le contenu des verbatims a été exploré en s’appuyant sur les techniques de l’analyse phénoménologique interprétative (IPA). Cette méthode d’analyse standardisée vise à saisir les processus subjectifs à l’œuvre dans la construction identitaire et relationnelle des individus (Pietkiewicz et Smith, 2014). Or, le coming in constitue une expérience éminemment personnelle et intime, en étroite relation avec l’identité et la subjectivité de l’individu (Rosenberg, 2017). La perspective idiographique caractérisant l’IPA permet de penser le fait que chaque individu vit, perçoit et met en sens ses expériences d’une façon qui lui est propre, selon les spécificités de son histoire et de son monde interne (Larkin et al., 2006 ; Smith, 2016). Elle se trouve ainsi être particulièrement pertinente quand il s’agit de s’intéresser aux spécificités du coming in des personnes homosexuelles ayant grandi dans des familles participant à LMPT. Les principes sous tendant l’IPA mettent en évidence le rôle interprétatif que le·la chercheur·e exerce par rapport aux données récoltées (Larkin et al., 2021). Ainsi, cette forme d’analyse s’effectue par une double herméneutique : il s’agit d’interpréter la façon dont le·la participant·e interprète sa propre expérience (Larkin et al., 2021).
Cette analyse a été réalisée en plusieurs étapes, suivant une procédure standardisée (Smith, 2016). Dans un premier temps, LK a relu les verbatims avec attention plusieurs fois, de manière à se familiariser avec leur contenu. Le texte de chaque verbatim a ensuite été divisé en unités de sens, auxquelles elle a assigné des commentaires. Ces commentaires pouvaient être d’ordre descriptif, conceptuel ou encore linguistique (Larkin et al., 2021). A partir de ce travail, elle a pu identifier et nommer les sous-thèmes contenus dans les verbatims. Après cela, elle a recherché les connexions existantes entre ces sous-thèmes, ce qui lui a permis de les regrouper en thèmes majeurs (Smith et Nizza, 2022). Ces thèmes et leur contenu interprétatif ont ensuite été relus et contrôlés par LF (deuxième autrice, chercheuse spécialisée en IPA).
Résultats
Description de l’échantillon
Le recrutement en association n’a pas été concluant ; en revanche, les démarches effectuées sur les groupes virtuels ont permis de rencontrer six personnes en entretien. L’une d’entre elle a dû finalement être exclue de l’étude, car il s’est avéré qu’elle s’identifiait comme bisexuelle et non comme homosexuelle. L’échantillon final comprend donc cinq participant·es (voir Tableau 1), ayant entre 18 et 25 ans (M = 22,8 ; ET = 2,64). La durée moyenne des entretiens est de 43 minutes et 36 secondes.
Tableau 1. Les caractéristiques des participant·es
|
Pseudonyme |
|
Age |
|
Genre |
|
Membres de la famille ayant participé à LMPT |
|
Simon |
18 ans |
Homme |
Simon et tous les membres de sa famille |
|||
|
Sophie |
22 ans |
Femme |
Sophie et sa mère |
|||
|
Alice |
25 ans |
Femme |
Alice et tous les membres de la famille |
|||
|
Etienne |
24 ans |
Homme |
Les parents et les trois enfants les plus jeunes, dont Etienne |
|||
|
Mayeul |
25 ans |
Homme |
Mayeul avec sa mère, ses frères et sœurs et toute sa famille maternelle |
Analyse des Thèmes et Sous-Thèmes
À la suite de l’analyse des verbatim des participant·es, trois thèmes ont émergé (voir Tableau 2). Ces thèmes s’organisent en sous-thèmes. Les autrices se sont également intéressées aux procédés par lesquels les participant·es mettaient en sens ces différentes thématiques (Flahault et al., 2022 ; Lamore et al., 2019). Pour chaque thème sera développé le processus de mise en sens lui étant associé. Ces processus de mise en sens témoignent de tentatives pour trouver une continuité biographique et garantir une identité narrative. Il est donc nécessaire de les explorer afin d’appréhender au mieux le vécu subjectif des participant·es (Flahault et al., 2022 ; Lamore et al., 2019).
Tableau 2. Les thèmes et leurs sous-thèmes identifiés par l’IPA
|
Thèmes principaux |
|
Sous-Thèmes |
|
Un vécu traversé par la souffrance |
La différence comme source de rejet et d’isolement |
|
|
La détresse psychologique |
||
|
L’auto-flagellation |
||
|
Le difficile chemin vers l’acceptation de son homosexualité |
Les signes annonciateurs |
|
|
La prise de conscience source d’une désorganisation massive |
||
|
La lutte acharnée contre cette découverte |
||
|
Une acceptation fragile |
||
|
L’articulation de l’identité homosexuelle avec l’identité catholique traditionaliste |
Des identités inconciliables et contradictoires |
|
|
Un choix douloureux |
||
|
Une possible synthèse |
Un vécu traversé par la souffrance
La différence comme source de rejet et d’isolement
Etienne (24 ans), Alice (25 ans) et Mayeul (25 ans) rapportent avoir été, et être parfois toujours, victimes de rejet du fait de leur identité sexuelle. Etienne évoque un vécu de « harcèlement scolaire » :
Euh... Alors ça me faisait souffrir dans la mesure où en étant un peu euh... efféminé… un peu euh... fin n’aimant pas jouer au foot avec des garçons n’étant pas violent, n’étant... voilà ne collant pas aux stéréotypes du garçon euh…. qui est... violent et... con. Parce que pour dire les choses aussi c’était ça… c’était ça hein. Euh... oui y’avait de la violence de la part de certains garçons. (…) C’était plus euh... du rejet par les pairs, P-A-I-R-S, parce que j’correspondais pas au modèle dominant.
Parce qu’il ne se conforme pas strictement aux codes genrés traditionnels, Etienne (24 ans) se retrouve victime de harcèlement. Par ailleurs, iels ont aussi subi du rejet en raison de leur identité catholique traditionnaliste :
Ouais et puis souvent je suis… j’fais face à beaucoup de… j’veux pas du tout dire « cathophobie » parce que c’est nul mais euh… souvent y’a des remarques en mode « ah bon t’es catho ? Pour quoi faire quoi ? ». Et en fait c’est chiant parce que… c’est chiant d’être rejetée dans tous les cas. (Sophie, 22 ans)
Cela occasionne un sentiment d’isolement considérable, comme l’illustre cette phrase de Sophie (22 ans) : « j’avais l’impression d’être seule au monde… ». De plus, à cause de ces expériences, les participant·es disent s’attendre presque systématiquement à être rejeté·es par les autres : « En fait y’a cette impression de se dire mais où je… Peu importe où je vais aller, j’vais me faire rejeter, il faut que je me construise tout seul… Et c’est super dur. » (Mayeul, 25 ans), ce qui génère du stress et de l’anxiété : « Ben… oui, oui, c’est… c’est la peur de la réaction des autres et ce que ça va entraîner chez moi un petit coup de stress euh…. Un peu de transpiration…mes mains qui vont trembler un petit peu… » (Etienne, 24 ans).
La détresse psychologique
Etienne (24 ans) et Sophie (22 ans) nous confient souffrir d’anxiété sociale. Simon (18 ans) et Alice (25 ans) disent avoir fait une dépression après leur coming in :
Ça a été l’impact vraiment hyper fort euh… psychologique de… fin du coming in en fait. Fin vraiment j’ai fait mon coming in et j’ai fait ma dépression avant de faire mon coming out en fait. Avant, tu vois ? C’est… c’est arrivé bien avant… C’est à dire que juste le fait de me l’avouer à moi-même, ça m’a mise en dépression. (Alice, 25 ans)
Alice lie directement cette dépression à la découverte de son identité sexuelle. Mayeul (25 ans) ne parle pas de dépression, mais fait état d’une détresse psychologique importante :
Pendant assez longtemps j’pleurais… peut-être pas tous les soirs, mais j’pleurais…. Et en plus comme j’dormais pas tout seul, je dormais avec un de mes frères qui était beaucoup plus jeune… il fallait pas que je le réveille… je... j’avais la tête dans l’oreiller… je pleurais le soir la tête dans l’oreiller…
De plus, il se trouve que les cinq participant·es ont pris part à LMPT aux côtés de leur parent. Ils mettent en avant les effets délétères de la participation à LMPT sur la santé mentale et l’équilibre psychique des enfants se révélant par la suite être homosexuel·les :
mais en fait j’ai… j’ai surtout ressenti de la colère contre mes parents et contre toutes ces personnes-là, qui vont… en faisant ça… bah créer des traumatismes chez leurs enfants, parce que j’pense qu’on est un bon paquet euh…d’homosexuels à avoir fait les manifs pour tous en fait… Et en fait on se rend pas compte des… bah des euh… des effets que ça a sur la santé mentale des enfants. (Alice, 25 ans)
L’auto-flagellation
Ce mal-être se trouve être imprégné par une haine de soi non négligeable. Il se caractérise donc par une forte dimension auto-accusatrice. A la suite de leur coming in, Sophie (22 ans), Etienne (24 ans) et Mayeul (25 ans) racontent que l’idée d’avoir participé à LMPT provoquait une intense « culpabilité ».
Certain·es participant·es affirment s’être senti·e·s coupables d’être homosexuel·les. C’est le cas notamment de Sophie (22 ans) : « Fin j’ai l’impression que juste euh… j’avais mis un pied dans l’péché et euh… y’avait vraiment cette idée de culpabilité et de péché… ». En réaction à cette culpabilité, ces participant·es se retrouvent à mettre en place des comportements autopunitifs, qui peuvent prendre la forme de restrictions, d’interdictions :
Limite ça m’a rendu encore plus tradi sur d’autres trucs… en m’disant euh… « ok j’aime les filles mais euh par contre j’suis irréprochable sur tous les autres trucs ». (…) Et ça allait à un point où euh… bah typiquement le… le catholicisme qui met vachement le… l’accent sur euh… tu sais autour des plaisirs qui sont pas utiles et le mal qui est dans le plaisir… et ben j’pouvais m’rendre malade parce que j’m’étais achetée un croissant alors que j’avais pas besoin d’ce croissant, et que j’aurais dû l’donner à un pauvre plutôt, qui avait faim... Alors que moi j’avais pas faim… (Sophie, 22 ans)
Mais également de conduites à tendance auto agressives :
Et j’pense qu’il y a toute une partie de certains euh… rapports que j’ai… fin même vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon corps etc… Et… j’ai un côté… et à l’époque aussi d’ailleurs j’avais un côté très autodestructeur… fin très… parce qu’en fait… tu te détestes (…). Et je sais que je me blesse beaucoup aussi… que je fais beaucoup de sport etc., et je sais que c’est aussi lié… à ça et aux relations… Et ouais… parce que c’est une façon de m’en prendre à moi-même en fait… (Mayeul, 25 ans).
Mayeul précise que ces conduites ont « un côté expiateur », ce qui fait écho à l’idée, évoquée par Sophie (22 ans) de l’homosexualité comme péché. De telles représentations compliquent le processus de coming in et entravent chez les participant·es l’acceptation de leur homosexualité.
Processus de mise en sens
Dans leur discours, les participant·es utilisent beaucoup de tournures de phrases impersonnelles :
C’était des promenades dans Paris avec ma grand-mère, c’était l’aventure, c’était on va retrouver les cousins, c’était on se balade avec des ballons, on se balade avec des drapeaux colorés, y’a une photo on nous dit « Wahou vous êtes super nombreux ! » (Mayeul, 25 ans)
Ou des procédés de généralisation (Sophie, 22 ans : « fallait que j’dise dans toutes les phrases que j’étais lesbienne. J’crois qu’on est beaucoup après ») pour parler de certains éléments de leur vécu. Ce processus est d’autant plus marqué lorsque les participant·es évoquent des éléments de leur histoire considérés comme honteux : « Y’a d’autres rescapés qui m’ont dit ça et qui m’ont dit qu’en fait ils ont adoré aller aux manifs à l’époque… » (Sophie, 22 ans). Cette généralisation d’un ressenti subjectif pourrait donc être interprétée comme une tentative de se défendre face à des vécus d’isolement et de culpabilité trop douloureux. Les participant·es semblent donner sens à ces expériences individuelles sources de souffrance en les rattachant à un vécu collectif.
De plus, iels paraissent avoir tendance à se positionner en porte-parole. Simon (18 ans) raconte avoir contribué à « libérer la parole » au sujet de l’homosexualité au sein de sa famille. Le fait même d’avoir choisi de répondre à l’appel à participation reflète potentiellement une volonté de faire connaître et de partager son vécu. Dans une perspective engagée, iels semblent donner sens à ce vécu individuel douloureux en le transformant en une ressource pour autrui.
Le difficile chemin vers l’acceptation de son homosexualité
Les signes annonciateurs
Enfants déjà, la plupart des participant·es ne se conformaient pas entièrement aux normes de genre dominantes : « Moi on m’disait beaucoup que j’étais garçon manqué… j’aimais pas du tout les… tout ce qui était… j’pouvais pas supporter l’rose, j’pouvais pas supporter d’mettre des jupes ou quoi… », mentionne ainsi Sophie, 22 ans. Certain·es participant·es décrivent avoir expérimenté, durant leur enfance et/ou leur adolescence, des relations particulièrement intenses avec des personnes de même sexe : « Fin j’sais pas… j’avais noué des relations hyper fortes avec certains de mes amis garçons fin qui étaient pas… (rires) pas très straight on va dire… donc ouais (rires) » (Simon, 18 ans). De plus, cela se trouve associé à un manque d’attirance pour les personnes du sexe opposé : « Mais juste je savais que j’étais pas du tout attiré par les mecs et que genre… voilà je… fin voilà… ça m’faisait pas rêver quoi » (Alice, 25 ans). Ces éléments sont interprétés par les participant·es comme des signes de leur homosexualité seulement a posteriori. Avant le coming in, ils n’opèrent pas du tout ce rapprochement, le fait d’être homosexuel·le étant alors « inconcevable » (Simon, 18 ans ; Alice, 25 ans).
La prise de conscience source d’une désorganisation massive
Chez l’ensemble des participant·es, la prise de conscience de leur homosexualité provoque un grand mal-être, associé à un sentiment de panique :
C’est vrai que ça me faisait super peur en fait… parce que j’étais en mode « oulala ça va être la merde ? » Fin l’expression est un peu crue quoi… un peu cash… Mais c’est vraiment ça… J’étais vraiment en mode « oh putain de merde » euh… Et y’a le « pourquoi moi ? » y’a tous ces trucs-là qui passent… qui passent par la tête (Mayeul, 25 ans).
Iels décrivent une perte radicale de repères, Sophie (22 ans) parlant d’« énorme chaos » et Alice (25 ans) disant : « j’étais vraiment comme une boussole euh…. qui est désorientée en fait ».
La lutte acharnée contre cette découverte
La grande majorité des participant.e.s emploie le mot « déni », pour désigner la manière dont iels ont tenté de se préserver de cette découverte et de la désorganisation qu’elle induisait.
Euh… bah en fait euh… je… c’était à peu près vers peut-être 15 ans… 15 ans où j’ai eu un déclic un jour et je me suis dit « bah ça se trouve je suis homosexuelle vu que je n’ai jamais eu de copain »… (…) Et en fait, j’me rappelle vraiment d’avoir eu un frisson qui m’a parcourue et j’me suis dit « Mais non mais pas du tout ! ». Et du coup j’ai… et du coup je… je n’y ai jamais repensé... c’est-à-dire que j’ai même pas remis le sujet sur la table, etc. C’était vraiment du déni. Pur et dur. (Alice, 25 ans).
Les premières prises de conscience étant immédiatement suivies de ce mouvement de déni, plusieurs réalisations successives doivent avoir lieu avant que les participant·es ne s’identifient pleinement comme homosexuel·les. Certain·es disent avoir tenté par tous les moyens de se convaincre que cette perception de leur identité sexuelle était erronée, qu’iels n’étaient pas homosexuel·les.
Sophie (22 ans) : En fait j’le savais et j’voulais tout faire pour essayer de me prouver que c’était pas vrai. J’sais pas comment dire… pour essayer de… debunker l’info… de prouver que c’était faux.
LK : Et les arguments que t’utilisais un peu contre c’était quoi ?
Sophie : Essayer de me convaincre que j’étais attirée par les hommes. C’qui marchait vraiment pas du tout (Rires). Parce que c’était vraiment… j’y croyais pas du tout quoi… à chaque fois j’faisais « Mais si ! Il est beau lui ! », « Ouais si si de loin là ! », « Celui qui a les cheveux longs du coup » ! (Rires)
Mais les participant·es ne parviennent jamais tout à fait à se défaire de cette idée, qui revient de manière obsédante :
de mes 15 à mes 16 ans, j’avais vraiment une période où j’étais en mode... tout le temps j’étais en mode « Mais est-ce que je suis gay ? Est-ce que je suis gay ? Est-ce que je suis gay ? » Et ça revenait constamment pendant un an. (Simon, 18 ans)
Une acceptation fragile
Tou·tes les participant·es déclarent entretenir aujourd’hui un rapport un peu plus apaisé avec leur identité sexuelle : « Fin là je pense que j’ai réussi à arriver à un stade où… bah voilà j’suis gay mais fin c’est ok quoi » (Simon, 18 ans). Toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire stable et définitive. Simon (18 ans) dit : « enfin j’aime beaucoup la politique… j’suis hyper connecté tout ça… fin donc selon les événements qui peuvent se passer ou selon c’que les réseaux d’extrême droite peuvent raconter euh… j’ai plus ou moins de… de colère… de… d’acceptation de moi-même… ». Il décrit cette acceptation comme étant susceptible de fluctuer, notamment en fonction du contexte politique.
De son côté, Alice (25 ans), affirme être désormais capable d’assumer son homosexualité au quotidien, en grande partie grâce au suivi psychologique dont elle bénéficie. Mais elle émet tout de même plusieurs réserves, en précisant qu’elle ne considère toujours pas avoir entièrement accepté son identité sexuelle.
J’me suis pas assez acceptée pour être ok avec qui je suis dans… même dans mon cercle familial. Parce que mine de rien quoi, j’pense que si… si jamais je m’étais acceptée à fond, j’pourrais en parler euh…au taquet à mes parents, mes grands-parents et tout. Là y’a quand même un certain truc où je me dis bah…. non en fait. Fin je… je sais que récemment j’ai pu pleurer avec… fin devant ma devant ma psy… J’pleure tout le temps avec ma psy etc., en disant « bah j’aurais préféré être hétérosexuelle et tout ». (Alice, 25 ans)
Les participant·es soulignent que ce qui peut encore entraver cette acceptation se situe au niveau du rapport soi/autrui.
Je crois que c’est le dernier défi que j’ai...C’est… c’est plus en société... C’est... fin… c’est globalement… accepter… totalement… que les gens en ont rien à cirer que j’fréquente une femme ou un homme… donc ce serait bien que moi aussi je… je sois dans ce même état d’esprit… mais il y a toujours ces petites appréhensions… traumatismes qui sont là pour te rappeler « attention ». (Etienne, 24 ans).
Processus de mise en sens
Les participant·es mettent en sens le cheminement ayant mené à l’acceptation de leur homosexualité en le représentant comme une trajectoire allant de l’enfermement à la libération. Iels mobilisent particulièrement le champ lexical de l’emprisonnement, de l’entrave. Simon (18 ans) se dit « enchaîné », « bloqué » ; Mayeul (25 ans) serait « coincé » ; Alice (25 ans) parle du fait d’être homosexuelle comme d’un « énorme fardeau à porter ». À ces vécus d’emprisonnement, les participant.e.s opposent des vécus de libération. Pour Sophie, le coming in est associée à la libération de ce qui était jusqu’à présent enfermé : « j’avais ouvert la boîte de pandore ». Etienne (24 ans) parle de « libération » pour désigner le moment où il a pu se détacher de son milieu d’origine et de la religion pour découvrir puis accepter son homosexualité :
Euh… la première année d’université… Bon déjà première fin… libération sociale, familiale etc. donc euh… voilà j’ai un espace pour euh… pour me découvrir, pour cheminer donc c’est...beaucoup moins difficile (…). J’me rappelle en première année d’université au début j’allais à la messe tous les dimanches. Et puis petit à petit avec cette découverte, le fait d’assumer, etc. j’me suis très vite détaché… pour être complètement libre.
Ainsi, les participant·es construisent une continuité biographique en dépeignant leur vécu comme un parcours au terme duquel il devient envisageable de se libérer de certaines entraves.
L’articulation de l’identité homosexuelle avec l’identité catholique traditionnaliste
Des identités inconciliables et contradictoires ?
La plupart des participant·es expriment un certain attachement à des valeurs décrites comme traditionnelles. Iels déclarent vouloir se marier et fonder une famille, en accord avec le modèle valorisé au sein du milieu catholique traditionnaliste dans lequel iels ont grandi. Toutefois, les familles catholiques traditionnalistes ayant rejoint LMPT refusent d’accorder aux personnes homosexuelles le droit de se marier et d’avoir des enfants. Pour les participant·es issu·es de ces familles, il paraît donc impossible de pouvoir mener une vie conforme à leurs valeurs tout en s’identifiant comme homosexuel·les. C’est ce que relève, avec regret, Alice (25 ans) :
J’arrive pas du tout à m’dire « ah bah j’vais avoir une femme et des enfants » alors que depuis que j’suis toute petite j’ai toujours voulu avoir des enfants. Donc euh avec un mari hein, logiquement et euh… fin selon mon modèle familial et tout.
S’ajoute à cela le fait que, en assumant leur identité homosexuelle, les participant·es risquent de perdre leur appartenance à leur groupe familial ainsi qu’à leur communauté religieuse : « Parce que t’es hyper tiraillée entre euh ta famille qui t’a apportée, comme j’te disais un modèle stable, avec qui tu t’entends bien, fin voilà… Et euh… toi qui… fin qui va être rejetée par cette famille-là » (Alice, 25 ans). Afin de décrire le fait de vivre avec deux identités associées à des aspirations contradictoires, Mayeul (25 ans) utilise l’adjectif « schizophrénique » et Alice (25 ans) dit s’être sentie « écartelée » voir « séparée en deux personnes ». D’après Sophie (22 ans), il serait impossible de concilier l’identité homosexuelle et l’identité catholique traditionnaliste, ce qui la contraindrait à faire un choix : « j’avais l’impression que j’devais en abandonner un ou l’autre et que tant que j’essayais de garder les deux j’pourrai pas être heureuse et surtout j’pourrai appartenir à aucun groupe euh… et pas avoir une vie stable… ».
Un choix douloureux
Ce choix est représenté par Sophie (22 ans) comme étant, par essence, cornélien, chaque option étant nécessairement synonyme de souffrance :
Oui, j’avais super peur d’avoir à faire un choix définitif où alors soit alors je choisis d’être lesbienne et du coup j’suis condamnée pour toute ma vie… soit j’choisis de plus être lesbienne, mais du coup j’suis malheureuse pour toute ma vie.. mais j’suis ok avec Dieu.
Certain·es participant·es rapportent avoir tenté d’abandonner leur identité homosexuelle. C’est le cas d’Alice (25 ans) :
Euh… je…voilà, j’ai essayé de trouver toutes les solutions possibles et imaginables : « Bon bah peut être que tant pis je le cacherai toute ma vie et je rentre…je me marierai avec un homme… » ; « Bah tant pis j’vais devenir religieuse ».
D’autres décident de prendre de la distance vis-à-vis de la religion. Cependant, rejeter cette identité catholique traditionnaliste n’est pas toujours présenté par les participant·es comme une solution satisfaisante, au contraire. Mayeul (25 ans) nous confie, en parlant des moments où il a voulu renier ses valeurs catholiques et aristocratiques : « c’est hyper violent parce qu’on a l’impression de s’amputer de toute cette partie de soi en fait, et c’est ça qui… fait pas mal peur ».
Une possible synthèse
Toutefois, les participant·es semblent réussir progressivement à imaginer pouvoir surmonter cette contradiction. Voir leur homosexualité acceptée par des personnes issues du milieu traditionnaliste catholique et leur origine sociale acceptée par des personnes appartenant à la communauté LGBT+ leur permet de se représenter ces deux identités comme susceptibles de pouvoir co-exister. Pour Etienne (24 ans), l’existence de communautés religieuses inclusives l’aide à réaliser cette synthèse :
Dans les... communautés... ou en tout cas dans les églises qui sont… progressistes…ou en tout cas classiques...Fin ça me…. J’me sens bien euh…J’me sens accueilli, voilà. Et puis, la dernière fois où je suis allé à un office religieux c’était pendant le mois des fiertés en juin… 2023. Donc là c’était des églises protestantes, ils ont organisé un culte des fiertés…. Et c’était trop cool, c’était très touchant… C’était des croyants, ou plus trop croyants ou non croyants qui juste se rassemblent parce bah… finalement on a été forgés avec des valeurs chrétiennes plus ou moins positives, et là on se retrouvaient que pour les positives.
Mayeul (25 ans), quant à lui, met surtout l’accent sur l’importance considérable de la légalisation du mariage entre personnes de même sexe, qui lui permet d’espérer pouvoir concilier ses deux identités.
Et du coup si voilà si y’a un petit truc que je peux dire c’est heureusement que cette loi est passée, parce que j’pense que pour beaucoup de gens… Dans mon cas personnel encore plus… C’est ce qui fait que… peut-être, d’une certaine façon je tiens, parce que je me dis que c’est possible… J’ai un peu ce rêve, qui est possible, et… une famille c’est peut-être un peu… l’idéal.
Processus de mise en sens
Etienne (24 ans) rapporte avoir plusieurs « flash-back » pendant notre échange, qui l’amènent systématiquement à modifier la perception de son vécu ainsi que le récit qu’il en fait. L’histoire de cette construction identitaire est constamment réinterprétée. Le sens que les participant·es attribuent à leurs expériences est sans cesse en train d’être élaboré et réélaboré.
L’articulation entre l’identité homosexuelle et l’identité catholique traditionnaliste est comprise par les participant·es comme étant dynamique, mouvante : « Et en fait j’me sens capable d’être euh… ce que je veux euh… avec les pourcentages qui faut quoi… et si j’ai envie d’être 100 % lesbienne 0 % catho euh… j’peux. Si j’veux être 100 % les deux j’peux aussi » (Alice, 22 ans).
Chez les particiant·es, l’identité est en perpétuelle création, sans cesse remaniée. Cela nous évoque les travaux de Judith Butler (1990), qui affirme que le sujet ne se contente pas d’être, qu’il est perpétuellement en train de devenir. En effet, l’identité ne serait pas, pour les participant·es, un attribut fixe, mais quelque chose qu’ils créent tout au long de leur vie.
Discussion
Le coming in est, chez les participant·es, un processus associé à une désorganisation massive ainsi qu’à une grande détresse. Cela peut être appréhendé à la lumière de la théorie de l’identité sociale (Breakwell, 2015 ; Brown, 2019 ; Jaspal et Breakwell, 2014). Les discours homophobes auxquels les participant·es sont exposé·es contribuent à présenter l’homosexualité comme étant une identité sexuelle dévalorisée, non désirable (Jaspal, 2022 ; Marzetti et al., 2022 ; Vignoles, 2011). Il est donc compréhensible qu’iels aient tenté de lutter contre cette découverte avec un tel acharnement. Il faut cependant préciser que la valeur attribuée à une identité varie d’un groupe social à un autre. Une étude qualitative menée par Klein et al. (2015) souligne la manière dont la communauté LGBT+ peut aider les personnes homosexuelles à comprendre et à accepter leur identité sexuelle. Il s’agit en effet d’un groupe d’appartenance au sein duquel l’identité homosexuelle est valorisée, associée à des contenus positifs. Toutefois, l’identité globale des participant·es de notre étude est composée de l’identité homosexuelle, mais également de l’identité catholique traditionnaliste.
Or, d’après les participant·es, l’identité catholique traditionnaliste est susceptible d’être dévalorisée, voir stigmatisée dans la communauté LGBT+. Cela permet d’expliquer pourquoi est-ce que les tentatives de recrutement menées dans les associations LGBT+ n’ont pas abouties. L’acceptation de l’identité sexuelle a ainsi tendance à être nettement retardée chez les participant·es, d’une part du fait de l’homophobie du milieu dans lequel iels ont grandi et d’autres par en raison d’un manque d’accès aux ressources communautaires, qui auraient pu constituer un facteur de protection face à cette homophobie (Chard et al., 2015 ; Ross et al., 2013). Ainsi, les participant·es se retrouvent face à l’impression d’être pris·es au piège. Dans leur milieu d’origine, l’identité catholique traditionnaliste est valorisée mais l’identité homosexuelle est dépréciée, stigmatisée, tandis qu’au sein de la communauté LGBT+, l’identité homosexuelle est valorisée mais l’identité catholique traditionnaliste est stigmatisée. Le conflit autour de ces deux identités paraît insoluble, ce qui génère une importante détresse chez les participant·es.
L’ensemble des participant·es déclare aspirer à synthétiser ces deux identités. Abandonner l’une ou l’autre est associé à beaucoup de souffrance, tandis que la possibilité de les concilier est présentée comme la seule perspective satisfaisante.
Nos observations semblent aller à l’encontre des résultats de l’étude quantitative menée par Rodriguez et al. (2017) sur l’articulation entre l’identité sexuelle et l’identité religieuse au sein d’un échantillon de personnes homosexuelles chrétiennes vivant en Californie. Cette recherche montre que le groupe ayant renoncé à son identité religieuse obtient de meilleurs résultats en termes de santé mentale que le groupe étant parvenu à intégrer l’identité religieuse et l’identité homosexuelle. Sachant que les données de cette étude ont été récoltées en 2009, à savoir avant la légalisation du mariage homosexuel en Californie, les informations recueillies auprès de nos participant·es paraissent pouvoir éclairer ces résultats. En effet, dans le milieu catholique, le mariage occupe une place très importante. Pour les participant·es, il s’agit d’une valeur fortement associée à leur identité catholique traditionnaliste. Certain·es participant·es expliquent que c’est grâce à la légalisation du mariage entre personnes de même sexe qu’iels peuvent espérer concilier leurs deux identités : iels ont la possibilité de vivre leur homosexualité selon les valeurs et les modèles qui leur ont été transmis.
Or, cette possibilité n’existe pas pour les participant·es de l’étude de Rodriguez et al. (2017). Nous pouvons ainsi émettre l’hypothèse que conserver les deux identités les confrontait de ce fait à une tension trop importante, chacune d’elles se trouvant être porteuse d’aspirations incompatibles. Rejeter l’identité catholique serait alors un moyen de supprimer cette dissonance, notamment en réduisant la valeur associée au mariage. L’impact de l’appareil législatif d’un pays sur la santé mentale des personnes issues de groupes minoritaires a été mis en évidence par Hatzenbuehler (2014). Ici, nous voyons que la légalisation du mariage homosexuel en France, en autorisant les participant·es à conjuguer leur identité homosexuelle avec leur identité catholique traditionnaliste, leur permettrait d’envisager la possibilité de construire une identité globale satisfaisante. Or, les recherches empiriques ont montré qu’une identité globale positive et cohérente était associée, chez les personnes homosexuelles, à un plus haut niveau de bien-être (Anderson et Koc, 2020 ; Collict et al., 2021 ; Riggle et al., 2014 ; Rodriguez et al., 2017).
Sur les affiches élaborées pour l’étude, le critère de recrutement indiqué était « avoir grandi dans une famille ayant été impliquée dans LMPT ». Mais, dans les faits, tous les participant·es ont également participé elleux-mêmes aux manifestations. Encourager les familles à venir défiler avec leurs enfants fait partie intégrante de la stratégie communicationnelle du mouvement, qui veut se présenter comme garant de la défense de la famille traditionnelle (Fracchiolla, 2015). Les résultats de cette étude sont particulièrement précieux car il n’existe, à ce jour, aucune autre recherche scientifique s’étant intéressée aux personnes ayant participé à une mobilisation s’opposant à leurs propres droits. Nos entretiens nous ont montré qu’il s’agissait d’une population particulièrement à risque. Le fait d’avoir participé à LMPT est associé chez elleux à une détresse importante, marquée notamment par un sentiment de culpabilité massif. La littérature scientifique soulignant déjà que les personnes homosexuelles sont plus susceptibles que les personnes hétérosexuelles de présenter des troubles psychopathologiques (Bostwick et al., 2010 ; Pakula et al., 2016 ; Pakula et Shoveller, 2013 ; Williams et al., 2021), nous pouvons faire l’hypothèse que cette participation à LMPT constitue un facteur de risque supplémentaire pour leur santé mentale.
Cette étude comporte plusieurs limites. Tout d’abord, nous avons choisi, dans cette étude, de nous intéresser uniquement à l’homosexualité, et pas aux autres identités non hétérosexuelles. Toutefois, avoir accès à l’expérience des personnes bisexuelles dont les familles ont été impliquées dans LMPT aurait également était intéressant. Que ce soit au sein de LMPT ou au sein du milieu catholique traditionnaliste, l’identité bisexuelle n’est absolument pas reconnue, considérée comme fictive voire inexistante, ce qui constitue un facteur de stress spécifique à cette population (Bostwick et al., 2014 ; Clarke et Peel, 2007). Les études empiriques soulignent que les personnes bisexuelles ont une santé mentale significativement plus dégradée que les personnes homosexuelles (Bostwick et al., 2014 ; Ross et al., 2010), ce qui marque la nécessité de se pencher sur leur vécu. Il serait donc pertinent que de futures recherches puissent explorer ces questions auprès des personnes bisexuelles et pansexuelles.
La population cible de notre étude étant assez difficile d’accès, nous avons procédé à un recrutement par effet boule de neige. Le risque est d’obtenir un échantillon trop homogène, qui manquerait donc de représentativité (Groves et al., 2009 ; Guittar, 2013). Les participant·es rencontré·es habitent tou·tes dans des grandes villes et font ou ont fait des études supérieures. Or, il aurait été pertinent de pouvoir également recueillir les récits de personnes vivant en zone rurale et ayant un niveau d’étude plus faible. En effet, ces deux facteurs ont été identifiés comme susceptibles de représenter un risque supplémentaire pour le bien-être et la construction identitaire des personnes homosexuelles (Campbell et Horowitz, 2016 ; Marlin et al., 2023 ; Wang et al., 2021 ; la Roi et Mandemakers, 2018). De plus, notre stratégie de recrutement ciblait les personnes fréquentant des associations ou inscrits sur des groupes en ligne, ce qui ne correspond qu’à une partie assez circonscrite des personnes homosexuelles ayant grandi au sein de familles impliquées dans la LMPT, susceptibles d’avoir un grand nombre de caractéristiques. La plupart des appels à participation conduits pour cette étude sont restés sans réponse, il convient donc de s’interroger sur les motivations des quelques personnes ayant accepté de rejoindre l’étude. Iels faisaient état d’une volonté de faire avancer la recherche en faisant connaître leur vécu et se montraient tout particulièrement investis dans le processus de l’entretien. Plusieurs participant·es nous ont confié avoir déjà participé à des interviews, à des podcasts portant sur leur participation à LMPT. Ils ont donc presque tou·tes déjà partager leur expérience de LMPT avant d’être rencontré·es en entretien. Ces témoignages ne sont ainsi pas entièrement représentatifs de l’ensemble de la population cible.
De plus, la méthode de recrutement présente un important biais de sélection. L’étude a été présentée comme s’adressant à des personnes homosexuelles. De ce fait, seules les personnes qui acceptaient de se définir comme telles étaient susceptibles de répondre à l’annonce. Ce choix de recrutement a pu contribuer à nous empêcher de recueillir les témoignages de personnes dont le coming in serait moins avancé, qui ne seraient pas encore parvenu·es à accepter et à intégrer leur identité homosexuelle. Or, il s’agit justement des personnes susceptibles de présenter les difficultés psychiques les plus importantes (Jaspal et al., 2022 ; Waterman et al., 2013).
Enfin, LK, qui menait les entretiens et effectuait le codage, s’identifiait elle-même comme homosexuelle, information qu’elle a pu partager avec les participant·es. Ce point commun permettait notamment de construire un lien de confiance, marqué par l’empathie et la compréhension mutuelle (Gair, 2011 ; Taylor, 2011 ; Wilkinson et Kitzinger, 2013 ; Rosenberg, 2018). Cela a pu contribuer à ce que les participant·es se sentent plus à l’aise pour aborder la question de leur identité sexuelle, sans redouter d’être confronté·es à un regard homophobe. Des précautions méthodologiques ont par ailleurs été prises de manière à contrôler l’influence des projections personnelles pouvant potentiellement résulter de cette proximité identitaire (Hewitt-Taylor, 2005). Choisir une méthode d’entretien à très faible directivité était un moyen de canaliser l’inférence de ces mouvements projectifs dans la conduite de l’entretien. Des discussions régulières entre les autrices de cet article ont permis l’adoption d’une posture réflexive sur les éventuelles projections qui pouvaient colorer tant la passation des entretiens que leur analyse.
De plus, les entretiens ont révélé que certain·es participant·es avaient pu connaître du rejet de la part de membres de la communauté LGBT+. La connaissance de l’homosexualité de la chercheuse a donc pu potentiellement déclencher chez les participant·es la crainte d’être stigmatisé·es en raison de leur identité catholique traditionnaliste, et avoir ainsi un effet plutôt inhibiteur. Il n’est pas impossible non plus qu’iels aient minimisé leur adhésion au discours de LMPT ou leur homophobie intériorisée dans le souci de ne pas heurter la chercheuse.
Malgré ces limites, notre étude a permis d’obtenir un aperçu approfondi du vécu de coming in des personnes homosexuelles ayant participé à LMPT durant leur enfance.
Conclusion
Au regard de nos résultats, nous pouvons formuler des recommandations d’accompagnement destinées à soutenir ces jeunes adultes dans leur processus de développement identitaire. Il serait judicieux de proposer des groupes thérapeutiques aux personnes homosexuelles ayant grandi au sein de famille impliquées dans LMPT. Les participant·es affirment souffrir de rejet, d’isolement et expriment le besoin de pouvoir rattacher leur vécu à une expérience collective. La possibilité d’échanger avec des personnes ayant connu des expériences de vie similaires permettra sans doute de rompre avec ce sentiment de solitude (Chard et al., 2015 ; Godard, 2014b). Un dispositif groupal serait aussi le moyen de favoriser le déploiement d’identifications positives, ce qui ne manquerait pas de faciliter la construction identitaire (Meyer, 2003 ; Rabain, 2022). De plus, chacun aurait la possibilité de partager son expérience pour en faire une ressource pour les autres membres du groupe, ce qui renforcerait leur estime d’eux-mêmes ainsi que leur sentiment d’efficacité personnelle (Breakwell, 2015 ; Brown, 2019 ; Jaspal et Breakwell, 2014).
Afin de prendre ne charge la souffrance psychique de cette population, un accompagnement psychothérapeutique centré sur la narrativité serait également pertinent. Au travers du discours des participant·es, il est clair que la confrontation au rejet et à l’homophobie tout comme la participation à LMPT constituent des expériences restées en souffrance. Elles paraissent parfois être conservées à l’intérieur de la vie psychique comme des corps étrangers ne pouvant être assimilés (Roussillon, 2012). Encourager, en psychothérapie, le déploiement de la narrativité de ces sujets permettrait de soutenir leur processus de construction subjective (Desveaux, 2021 ; Roussillon, 2012). Une narration de soi s’opérant dans un dispositif clinique symboligène leur offrirait la possibilité de s’approprier les différents éléments de leur vécu, de les intégrer à leur identité subjective (Aulagnier, 2015). Cela serait l’occasion d’élaborer la complexité de ces deux identités en apparence contradictoires. Ce travail narratif de mise en histoire du vécu pourrait favoriser pour ces sujets l’unification de la représentation de soi ainsi que l’intégration des différentes composantes identitaires. Ricœur (1992) effectue un lien entre une narrativité entravée et « L’impuissance à s’estimer soi-même » : l’échec de la narrativité est susceptible d’entraîner un effondrement de l’estime de soi. La thérapie narrative, telle qu’elle a été conceptualisée par White (2009) propose un modèle d’intervention susceptible d’être adaptée aux besoins de ces sujets. De cette manière, il serait envisageable d’œuvrer à réparer cette narrativité afin d’aider à consolider les bases narcissiques des sujets rencontrés. La méthode proposée par White (2009) cherche à encourager le sujet à se distancer de certains récits dominants, sources de souffrance, pour favoriser la construction de récits alternatifs (Mori et Rouan, 2011 ; White, 2009). La première étape, l’externalisation, consiste à permettre au sujet d’identifier et d’observer le problème (Mori et Rouan, 2011 ; White, 2009). Dans le cas présent, il s’agirait d’aider la personne à prendre conscience des effets négatifs de la stigmatisation sur son sentiment d’identité et son expérience subjective. La deuxième étape viserait ensuite à déconstruire les significations négatives attribuées aux différentes identités du sujet (Mori et Rouan, 2011 ; White, 2009) à savoir ici l’identité homosexuelles et l’identité catholique traditionnaliste. Le sujet serait amené à prendre conscience que les représentations péjoratives associées à ces identités ne sont pas évidentes et universelles mais s’inscrivent dans un contexte particulier. Cette dévalorisation est portée et renforcée par certains groupes sociaux mais restent toutefois relatives à ces groupes donnés. Cela permet d’aboutir à l’étape finale, celle de la reconstruction (Mori et Rouan, 2011 ; White, 2009). Le remaniement des significations associées à chaque identité autorise l’émergence d’un récit alternatif, d’une nouvelle identité narrative. Ce nouveau récit de soi devrait soutenir la construction d’une identité positive, satisfaisante, en accord avec les valeurs chères au sujet (Mori et Rouan, 2011 ; White, 2009). L’objectif serait notamment que le récit alternatif rende possible la synthèse entre l’identité homosexuelle et l’identité catholique traditionnaliste.
Notre recherche a permis d’identifier chez les personnes homosexuelles dont les familles ont participé à LMPT une vulnérabilité psychique considérable. Il faudrait que de futures recherches puissent décrire, à l’aide de données récoltées sur l’ensemble du territoire français, l’ajustement psychologique des personnes confrontées directement à ce discours homophobe. Il s’agirait d’explorer les facteurs de vulnérabilité risquant de mener au développement de troubles psychopathologiques ainsi que les processus adaptatifs déployés par les individus pour faire face à cette vulnérabilité.
Conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêt déclaré.