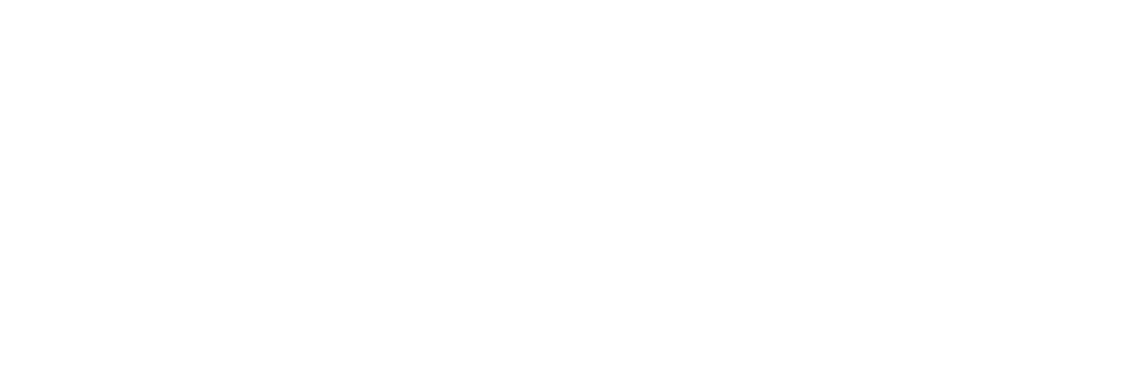Introduction
Depuis la fin du xxe siècle, la société française semble évoluer vers une plus grande acceptation de l’homosexualité. Cette évolution des mentalités suit celle des droits, progressivement acquis en France depuis la « dépénalisation » de l’homosexualité en 19821. Toutefois, ce processus ne se fait pas sans heurts. Les polémiques violentes autour de la création du PaCS entre 1997 et 1999, puis de l’ouverture du mariage civil et de l’adoption pour les couples de même sexe entre 2012 et 2013 et encore plus récemment de l’ouverture de l’Aide Médicale à la Procréation aux couples de lesbiennes entre 2019 et 2021, en sont l’illustration. De même, les chiffres de SOS Homophobie (Tableau 1) indiquent, au fil des années, un nombre encore élevé et relativement stable de témoignages2 gayphobes et lesbophobes, donnant une autre image des résistances sociétales.
Tableau 1. Évolution du pourcentage de cas de gayphobie et de lesbophobie à partir des rapports de l’association SOS Homophobie couvrant la période de 2016 à 2023
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
Gayphobie |
59 % |
66 % |
67 % |
59 % |
59 % |
55 % |
52 % |
52 % |
|
|
Lesbophobie |
22 % |
17 % |
22 % |
16 % |
16 % |
12 % |
13 % |
13 % |
Ces chiffres qui montrent un nombre systématiquement plus élevé de témoignages gayphobes que lesbophobes, ne révèlent pas une meilleure acceptation des lesbiennes par rapport aux gays. Ils signalent au contraire l’invisibilisation sociétale des lesbiennes (Chetcuti-Osorovitz, 2013 ; Chetcuti-Osorovitz et Jean-Jacques, 2018 ; Jean-Jacques et Pointurier, 2024 ; Revillard, 2002). En effet, si on interroge ces dernières à propos des situations de discriminations ou de violences qu’elles rencontrent, leur nombre s’accroit nettement. Dans ce sens, SOS Homophobie a réalisé deux enquêtes sur la lesbophobie à 10 ans d’intervalle. Dans la première (2003-2004)3, 63 % des 1793 répondantes, déclaraient des faits lesbophobes au moins une fois dans leur vie, et dans la seconde (2013)4 sur les 7126 répondantes, 59 % disaient avoir vécu de la lesbophobie au cours des deux dernières années. Plus récemment, dans une enquête de l’IFOP (2019)5, 44 % des lesbiennes interrogées déclarent avoir été agressées durant les 10 dernières années contre 39 % des gays. De même au cours des douze derniers mois, les lesbiennes sont 8 % à déclarer des menaces d’agressions sexuelles ou de viols contre 2 % de gays. Elles sont également 8 % à déclarer des violences physiques contre 4 % des gays ; violences qui sont pourtant en général plus dirigées vers les hommes (Lebugle et al., 2020). Dans ce contexte sociétal français, les comportements des lesbiennes sont toujours contraints comme le démontre l’enquête VIRAGE menée entre 2015 et 2016. En effet, 42 % des répondantes lesbiennes déclarent éviter de se tenir par la main ou de s’embrasser dans certains lieux et 23 % éviter de le faire partout (Trachman et Lejbowicz, 2020). Ces comportements d’évitement participent donc à l’invisibilisation dans les espaces publics des lesbiennes qui se font disparaître pour se protéger car, comme l’écrivent Chetcuti-Osorovitz et Jean-Jacques (2018, p. 164), c’est « par anticipation de réactions hostiles et de violences qu’elles pourraient susciter, que les lesbiennes se rendent “invisibles” ». Toutefois, cette invisibilisation n’est pas un phénomène uniquement lié à leur propre volonté, ni à un seul espace social, l’espace public. Il consiste en un phénomène plus général inhérent à la société française.
C’est la raison pour laquelle, nous avons exploré cette problématique de l’(in)visibilité lesbienne en France dans un dispositif de recherche-création6 croisant les regards du théâtre contemporain et de la psychologie sociale. Des entretiens de recherche ont ainsi été menés auprès de lesbiennes de différents âges et situations socio-économiques, au sujet de leur jeunesse lesbienne et de leur vécu actuel. Ce matériau a constitué d’une part, la matière pour l’écriture d’une pièce (un concert-spectacle) sur l’expérience lesbienne de ces 80 dernières années en France et d’autre part, celle d’une recherche psychosociale sur les processus d’invisibilisation et de représentations lesbiennes. Dans ce texte, nous nous centrons sur les mécanismes de régulation normative liés à l’hétéronormativité dans la façon dont les personnes interviewées se disent ou ne se disent pas lesbiennes à autrui (Amari, 2012 ; Chetcuti-Osorovitz, 2013). Pour ce faire, après avoir exposé les éléments théoriques mobilisés dans cette analyse, nous présentons la méthode mise en œuvre dans la recherche-création, tout en explicitant notre positionnement spécifique dans ce dispositif hybride, en s’appuyant sur les épistémologies du positionnement situé (Fonte et Lelaurain, 2024 ; Harding, 1992 ; Puig de la Bellacasa, 2014). Nous finissons par la présentation des principaux résultats concernant les modes d’(in)visibilisation mis en œuvre par les personnes interviewées en interrogeant l’idée commune que la société française serait maintenant non homophobe.
La norme d’hétérosexualité
L’hétérosexualité comme régime politique
Nos sociétés occidentales, depuis le xviiie siècle, promeuvent une vision de l’humain s’appuyant sur une conception bicatégorielle des sexes (Laqueur, 1992). Selon le travail de Laqueur (1992), les sexes ne sont pas une simple donnée de nature mais bien un produit de la société et les diverses affirmations sur les corps et leurs différences en termes de sexe, sont des moyens de valider et illustrer la hiérarchie pré-existante entre les femmes et les hommes. Ainsi selon Delphy (2013), le sexe ne serait pas une donnée naturelle invariable qui pré-existerait au genre conçu alors comme une donnée sociale variable. Le sexe est, selon elle, le « marqueur de la division sociale », c’est-à-dire de la hiérarchie, car il « sert à reconnaître et identifier les dominants des dominés, il est un signe » (Delphy, 2013, p. 229). Il est le signe du genre.
Wittig (2001) qui considère également que le sexe n’est pas une catégorie naturelle mais une catégorie politique, s’attaque dans les années 1980 à un impensé de l’analyse féministe, la pensée straight. Celle-ci comprend tous les concepts relevant de l’hétérosexualité, non pas comme pratique sexuelle mais comme institution, et constitue une pensée de la domination. Elle fait apparaître le lien indéfectible entre l’hétérosexualité comme régime politique et la catégorie de sexe qui « est une catégorie politique qui fonde la société en tant qu’hétérosexuelle » (Wittig, 2001, p. 46). Les catégories « femme » et « homme » sont présentées comme différentes, voire « opposées » selon l’expression commune en français, et complémentaires ; conception synthétisée dans l’expression de sens commun la « différence des sexes ». Les sociétés occidentales transforment des êtres femelles en femmes et des êtres mâles en hommes, sur la base du sexe en tant que signe, à travers un processus culturel de socialisation (Rubin, 1998). Cela s’accompagne d’une production systématique et obligatoire de relations érotiques entre elleux, l’hétérosexualité obligatoire (Rubin, 1998), le régime politique de l’hétérosexualité (Wittig, 2001) ou ce que Rich (1981) a décrit comme la contrainte à l’hétérosexualité. A l’instar de Wittig, Rich questionne un a priori que l’analyse féministe n’interroge jamais, celui de l’hétérosexualité comme « préférence sexuelle de la plupart des femmes » (1981, p. 17). Selon elle, l’hétérosexualité n’est pas une donnée naturelle de la sexualité mais une institution imposée aux femmes par une série de contraintes.
Ainsi, l’institution hétérosexuelle s’appuie sur la « différence des sexes » pour advenir et, dans le même temps, elle produit et valide cette « différence des sexes ». L’hétérosexualité peut donc être considérée à la fois comme un régime politique impliquant une hiérarchie dans les sexualités7 et comme un régime de connaissance normatif.
Le régime de connaissance normatif de l’hétérosexualité : l’hétéronormativité
L’hétéronormativité ou la norme d’hétérosexualité signifie que toute personne est examinée et évaluée à partir d’un point de vue hétérosexuel (Chambers, 2003). En tant que norme sociale, l’hétéronormativité comporte deux aspects, la prescription de conduites et la production de valeur (Dubois, 1994). Le présupposé d’hétérosexualité qui pose que toute personne est présumée, jusqu’à preuve du contraire, avoir un désir orienté vers « l’autre sexe », constitue l’aspect prescripteur de la norme. Autrement dit, les conduites qui sont attendues et bienvenues, sont celles démontrant l’hétérosexualité des personnes. En parallèle, celles qui sont réprouvées et malvenues, sont celles rendant compte de la sexualité minoritaire des personnes, dans le cas qui nous intéresse ici, le lesbianisme. Ces sexualités minoritaires sont alors placées dans les marges et rendues invisibles par le présupposé d’hétérosexualité. Ensuite, la norme hétérosexuelle attribue de la valeur à ce qui est attendu et légitime, soit l’hétérosexualité, tout en dévalorisant et stigmatisant ce qui est malvenu et prohibé, notamment l’homosexualité. L’hétérosexualité est alors constituée comme la forme normale et naturelle et, en parallèle, l’homosexualité, dont le lesbianisme, comme une forme anormale et non naturelle.
L’hétéronormativité conduit à l’invisibilisation des lesbiennes qui sont enfermées dans ce qui est communément nommé le placard (Sedgwick, 2008), puis à leur dévalorisation et stigmatisation lorsqu’elles sont ou se rendent visibles. Alors « sortir du placard » (ou faire son coming out), c’est s’élever contre l’injonction à maintenir sa vie privée dans cet espace contraint et aveugle de la société, c’est-à-dire contrevenir au régime politique de l’hétérosexualité (Wittig, 2001) et faire apparaître d’autres options que l’hétérosexualité.
Cette sortie du placard n’est pas sans danger. En effet, l’hétéronormativité s’accompagne de diverses sanctions dont l’objectif est de maintenir les lesbiennes à leur place, c’est-à-dire dans les marges et l’invisibilité pour préserver la légitimité du régime hétérosexuel. Ces sanctions peuvent être distinguées entre les plus visibles et évidentes, correspondant aux agressions tant verbales que physiques et sexuelles, ou la mise à l’écart et le harcèlement, et les moins visibles du fait de leur insertion dans les interactions sociales quotidiennes.
Ce deuxième registre de sanctions correspond à des pratiques de régulation (Butler, 2006 ; Chambers, 2007) de l’apparence et des conduites, qui se déploient au sein des espaces sociaux, quotidiens, culturels, médiatiques ou politiques. Cette régulation de l’apparence et des conduites par la mise en conformité aux attendus, est réalisée par un travail sur le corps (musculature, coiffage, maquillage, tatouage, démarche, voix…), par l’usage de divers accessoires à disposition (vêtements, bijoux, sac…) et par la façon de mettre en mots les expériences vécues, en fonction des contextes. En effet, « sortir du placard » dépasse la simple distinction binaire entre dire ou ne pas dire son lesbianisme (Amari, 2012 ; Chetcuti-Osorovitz, 2013 ; Jean-Jacques et Pointurier, 2024) et se joue de multiples façons dans les mots utilisés, le type de silences mis en œuvre ou la gestion des espaces sociaux, selon les contextes. Ces actions peuvent concerner le soi (auto-régulation) et les autres (hétéro-régulation) avec lesquel·les on entre en interaction, que celles-ci soient ponctuelles, même fugaces (lorsque l’on croise une personne dans l’espace public, dans la rue), ou qu’elles soient régulières, quotidiennes et même intimes.
Objectifs
Dans ce texte, nous axons notre réflexion sur les pratiques de régulation par les mots, ce que l’on dit et ce que l’on ne dit pas selon les contextes sociaux. Au travers de la mise en récit de leur jeunesse et de leur vie actuelle, nous explorons les manières de faire avec l’hétéronormativité des personnes interviewées. Autrement dit, nous interrogeons les formes de visibilité et invisibilité lesbiennes à partir de l’analyse des pratiques de régulation des façons de se dire ou ne pas se dire lesbienne à autrui. Il s’agit d’examiner d’une part, les points communs dans les mises en mot et les silences, quel que soit l’âge des personnes interviewées, montrant un fonctionnement toujours prégnant de l’hétéronormativité dans une France qui a changé ses lois vers une plus grande intégration des minorités sexuelles. D’autre part, nous recherchons les différences dans ces mises en mot donnant à voir les évolutions de la société française. Ainsi, nous supposons un effet de l’âge du fait de cette évolution législative au cours des cinquante dernières années. Dans ce sens, nous opposons les deux sous-groupes d’âge extrême de notre corpus d’interviewé·es : les plus jeunes, entre 20 et 35 ans (né·es entre 1990 et 20008) et les plus âgé·es, entre 51 et 75 ans (né·es entre 1950 et 1970). Pour cet aspect, nous ne traitons pas le sous-corpus des âges intermédiaires (entre 36 et 50 ans) car il ne nous permet pas de faire apparaître clairement ces différences.
Méthode
Les éléments présentés dans ce texte sont issus d’un projet de recherche-création (cf. note 6) qui s’intéresse aux représentations du lesbianisme en explorant la question du vécu ou non d’une jeunesse lesbienne par des personnes de différentes générations. Son objectif est double. D’une part, recueillir une diversité de témoignages autour de l’expérience de la jeunesse en tant que lesbienne, en vue de l’écriture d’un texte et de la mise en scène d’un spectacle hybride, un concert théâtral9. D’autre part, il s’agit de mettre en évidence l’impact de l’hétérosexisme10 et de l’hétéronormativité sur les constructions de soi de lesbiennes françaises, à partir d’une approche psychosociale. Dans cette recherche-création, nous avons fait se rencontrer et se croiser un art, le théâtre contemporain, avec une science humaine et sociale, la psychologie sociale, les deux incorporés dans une autrice et comédienne et une chercheuse en psychologie sociale (l’autrice de cet article).
Les dispositifs de recherche-création sont divers dans la façon dont scientifiques et artistes collaborent, articulent leurs pratiques respectives, les mélangent et en créent de nouvelles tout autant que sur la répartition des statuts des un·es et des autres (voir Chetcuti-Osorovitz et al., 2024 ; Duchêne et al., 2023). Dans notre dispositif, nous n’avons pas scindé les tâches en fonction des « compétences » préalables, par exemple procéder à un recueil des données de recherche par la chercheuse, suivi de leur utilisation par l’artiste pour sa création. Nous avons pensé, élaboré et mis en œuvre conjointement l’ensemble de la méthodologie de recherche sur la base d’un intérêt partagé et d’une interconnaissance antérieure au projet. Par la suite, le travail d’écriture et de création s’est déroulé sous le regard critique de la chercheuse, tout comme celui d’analyse sous le regard critique de l’autrice/comédienne. Dans ce sens, les 22 entretiens semi-directifs réalisés auprès de lesbiennes âgées de 20 ans à 75 ans ont été co-dirigés par la chercheuse et l’autrice/comédienne après qu’elles aient élaboré ensemble le guide d’entretien. Les interviewé·es habitent toustes dans la même région de France mais quelques-un·es sont originaires d’autres régions françaises et pays européens. Ielles sont de niveaux socio-économiques différents et travaillent dans le secteur public et privé (Tableau 2). Si la plupart s’identifient comme des femmes cisgenres11, quelques-un·es étaient en questionnement de genre au moment de l’entretien12 et se sont engagé·es, par la suite, dans un parcours de transition. C’est la raison pour laquelle le genre est précisé dans le tableau 2.
Tableau 2. Liste des personnes interviewées et leurs caractéristiques principales
|
Prénom |
|
Âge |
|
Genre |
|
Activité |
|
Lou |
20 |
F |
Étudiante |
|||
|
Mika |
22 |
M |
Étudiant |
|||
|
Léa |
24 |
F |
Etudiante |
|||
|
Morgane |
25 |
F |
Costumière |
|||
|
Anaïs |
29 |
F |
Comédienne |
|||
|
Marion |
32 |
F |
Fonctionnaire (structure culturelle) |
|||
|
Steph |
33 |
F à M |
Rédacteurice en chef·e pour maison d’édition |
|||
|
Cécile |
35 |
F à NB |
Metteureuse en scène et comédien·ne |
|||
|
Sacha |
38 |
F |
Ouvrière en usine |
|||
|
Jo |
38 |
F |
Comédienne |
|||
|
Sabrina |
40 |
F |
Psychologue |
|||
|
Elodie |
40 |
F |
Conseillère en assurance |
|||
|
Jule |
43 |
NB |
Auteurice |
|||
|
Sophie |
44 |
F |
Cheffe de cuisine |
|||
|
Pascale |
50 |
F |
Auxiliaire de vie scolaire |
|||
|
Ingrid |
51 |
F |
Ouvrière en usine |
|||
|
Charlotte |
52 |
F |
Enseignante chercheuse |
|||
|
Laurence |
64 |
F |
Retraitée (restauration) |
|||
|
Joëlle |
65 |
F |
Retraitée (éducation nationale) |
|||
|
Odile |
67 |
F |
Retraitée (éducation nationale) |
|||
|
Annie |
72 |
F |
Retraitée (agricultrice) |
|||
|
Sylviane |
75 |
F |
Retraitée (administration) |
Note. F = Féminin ; M = Masculin ; NB = Non Binaire. Les prénoms des personnes enquêtées ont été modifiés en vue de préserver leur anonymat.
Le guide d’entretien a été conçu à partir des besoins pour la création et de la question de recherche sur la construction de soi en tant que lesbienne. Après avoir demandé à la personne comment elle s’identifie (lesbienne, homosexuelle ou autrement), elle était conviée à raconter son parcours de découverte de son désir lesbien et d’acceptation de ce désir par elle-même et les autres. Dans ce cadre, nous interrogions les thèmes de sa visibilité en tant que lesbienne dans ses différentes sphères de vie, de son identification en tant que femme ou non et de la présence ou absence de modèles pour se construire comme lesbienne.
Pour l’ensemble de la recherche, nous avons créé une grille d’analyse de contenu thématique en nous appuyant sur le modèle du stigmate sexuel structurel de Herek (2007) conceptualisant l’hétérosexisme, ainsi que sur l’hétéronormativité et les pratiques de régulation sanctionnant les écarts à la norme. La grille totale comporte 11 thèmes chacun subdivisés en sous-thèmes. Pour cet article, nous n’en utilisons qu’une petite partie. D’abord, nous avons puisé dans le thème « self-stigma », concept utilisé par Herek (2007) pour rendre compte de l’intériorisation des caractéristiques négatives attachées à l’homosexualité du côté des minorités sexuelles, scindé en deux sous-thèmes distinguant entre les identifications auto-attribuées par les personnes, « formes d’identification », de celles proposées par la société « self-stigma en général ». Puis, nous avons utilisé le thème « les mots utilisés » divisé en deux parties « les mots que l’on dit » et « les mots que l’on ne dit pas ».
Un positionnement spécifique
La chercheuse et l’autrice/comédienne sont lesbiennes et le vivent ouvertement chacune depuis de nombreuses années. Le choix du thème de recherche-création est donc en partie lié à ce vécu personnel tout en étant inscrit dans la continuité des activités professionnelles de chacune. Dans ce sens et parce que ce projet a débuté avant tout financement, les huit premiers entretiens ont été réalisés avec des personnes principalement de notre entourage personnel et, à la marge, de notre entourage professionnel. Au fil de l’avancée du projet, nous avons ouvert notre appel sur les réseaux sociaux et en prenant contact avec des associations LGBT+ de deux villes de la région concernée. Sur 22 entretiens, sept ont été menés avec des personnes qui nous étaient entièrement inconnues. Enfin, étant nous-mêmes directement concernées, l’idée est apparue assez rapidement d’intégrer dans les contenus nos deux vécus de façon explicite et formalisée, plutôt que de les laisser flotter et sans statut spécifique dans ce projet. Pour ce faire, plutôt que d’effectuer chacune un entretien de recherche avec l’autre comme interviewée, nous avons pris l’option de réaliser un seul entretien en alternant nos positions d’intervieweuse et d’interviewée.
Je suis donc, en tant qu’autrice de cet article, à la fois en position de chercheuse et de sujet de la recherche. Ce double positionnement qui est a priori peu compatible avec la pratique scientifique positiviste, peut sembler de prime abord risqué. En effet, il rend compte d’une forme d’engagement dans le lien au sujet de recherche, « être comme ses sujets », qui viendrait brouiller la ligne claire de démarcation entre chercheureuses et sujets.
Pour répondre à cette problématique, et au fil du projet, j’ai progressivement construit un positionnement en tant que chercheuse en psychologie sociale, lesbienne et féministe, en prenant appui sur les épistémologies du positionnement situé (Fonte et Lelaurain, 2024 ; Harding, 1992 ; Puig de la Bellacasa, 2014). Ce positionnement permet tout d’abord de rendre compte de l’origine de ce projet. En effet, ces épistémologies posent que toute pensée ou recherche est issue du point de vue d’un·e ou plusieurs chercheureuses, c’est-à-dire à pour origine des « vies socialement déterminées » (Harding, 1992, p. 445). Toutefois dans les pratiques scientifiques positivistes, au contraire des points de vue issus de groupes marginalisés et « marqués » qui sont considérés comme partiaux et partiels, ce point de vue est invisible parce qu’il provient de groupe dominant. C’est ce que Haraway (1988) nomme le god trick ou « truc divin » correspondant à un point de vue qui n’est nulle part et qui entretient l’idée d’un point de vue unique et universel. Ainsi selon les épistémologies du positionnement situé, toutes les connaissances produites par la recherche « portent l’empreinte des communautés qui les ont produites » (Harding, 1992, p. 445) et des conditions matérielles dans lesquelles se trouvent les producteurices. En ce sens comme l’écrit Puig de la Bellacasa (2014, p. 179), il est essentiel « de tenter de nommer où nous sommes autant que là où nous ne sommes pas ». Ces conditions de production doivent alors être considérées comme des ressources plus que des freins ou des biais qu’il faudrait éliminer.
Le point de départ de la recherche-création autour de la possibilité ou non de qualifier sa jeunesse de lesbienne, est donc situé dans les conditions sociales et les expériences de lesbiennes des initiatrices du projet, au sein d’une société vécue par les deux comme homophobe et lesbophobe. Ensuite, ce positionnement explique le souci, dans l’analyse et la création, non seulement de montrer le maintien de différentes formes de discriminations et violences malgré l’apparente évolution sociétale, mais aussi de rendre compte des pratiques de résistance mises en œuvre par les personnes interviewées pour faire face à cette homophobie et lesbophobie. C’est aussi la volonté de donner la parole et de proposer des représentations (notamment par la création) à une catégorie toujours nettement invisible (Chetcuti-Osorovitz, 2013 ; Jean-Jacques et Pointurier, 2024 ; Revillard 2002 ; Verron, 2024) ainsi que montrer la puissance et la joie que peut revêtir cette identification pour les personnes interviewées.
Dans ces soucis, sont lisibles la solidarité avec ces dernières, une grande partie appartenant à notre réseau d’interconnaissance, et une forme d’horizontalité au cours de l’entretien puisque nous nous reconnaissions comme partageant la même identification, malgré le rapport de pouvoir inhérent à la situation d’entretien (Clair, 2016). Là encore, expliciter au préalable ces aspects m’a permis de les prendre en compte comme des ressources plutôt que de les laisser s’immiscer dans l’analyse sans possibilité de retour réflexif sur leurs effets.
Résultats – Des pratiques de régulation au service de l’invisibilité lesbienne
Dans notre corpus, la mise en mot de son lesbianisme apparaît comme toujours progressive, quelle qu’en soit la rapidité. Elle rend compte de la difficulté à reconnaître et accepter le désir lesbien, quel que soit l’âge des interviewé·es et l’âge de l’expression de leur désir qui varie plus selon les personnes que selon la génération. Il peut avoir lieu assez jeune entre 7, 11, 15, 18 et 20 ans, ou plus tard passé 26 ans, ou encore plus tard entre 38 et 45 ans. Sur les 22 personnes, deux ne décrivent aucune question autour de ce désir. Elles ont 22 et 40 ans et ont reconnu leur désir très jeunes à 11 et 7 ans.
C’est donc un point commun des interviewé·es que de décrire leurs difficultés à s’identifier comme homosexuelle et/ou comme lesbienne, et ce même si elles vivent leurs désirs jeunes.
Lorsqu’à 15 ans elle sort avec sa première copine, Léa (24 ans) s’identifie d’abord à partir du prénom de cette personne, elle se dit « Agatho-sexuelle ». De la même façon Annie (72 ans) qui vit sa première relation lesbienne à 45 ans, déclare « Pour moi j’étais d’abord amoureuse de Nadine. J’étais amoureuse de quelqu’un ». Jule (43 ans) qui vit sa première relation avec une femme à 38 ans, explique qu’avant de pouvoir se dire lesbienne, iel disait « j’aimais une femme », ou encore Jo (38 ans) qui disait, de façon plus générique pendant plusieurs années après avoir vécu à 19 ans son premier amour lesbien, « j’aime les femmes ». De même, Laurence (64 ans) qui a vécu ses désirs dès ses 18 ans, ne disait pas non plus qu’elle était lesbienne : « moi je disais que j’étais avec une femme ». En réponse à un ami au collège qui s’affirme comme gay et lui demande si elle n’est pas lesbienne, Cécile (35 ans) déclare qu’elle est asexuelle. Cette réponse montre l’impossibilité dans laquelle elle se trouve, à cette période, de s’assumer comme lesbienne « Quand je dis que je suis asexuelle, je dis juste que je ne suis pas lesbienne ». Ce processus est bien résumé par Sophie (44 ans) « Toutes ces années-là, toutes ces petites choses, premier amour, les gars, les voyages, le club de foot féminin. Tout ce temps-là fait que justement tu en arrives à te dire "Je suis lesbienne" » ; ce qu’elle fait à 22 ans.
Les difficultés évoquées par toustes les interviewé·es rendent compte de pratiques d’auto-régulation, par les mots, de l’identification en tant que lesbienne, relative à la fois au terme en lui-même et à ce que cela implique comme vie pratiquement impensable. Cette identification n’étant a priori pas positive, est retardée par les personnes, au bénéfice d’une identification plus normative, passer pendant un temps par l’hétérosexualité (Chetcuti-Osorovitz, 2013) ou l’absence de relations amoureuses, ou d’un refus d’être identifié·e visible dans l’argument « j’ai pas besoin de mettre d’étiquette » (Léa, 24 ans). Le contournement du terme « lesbienne » et l’usage d’expressions centrées sur les personnes dont on est amoureuse « j’aime telle personne » ou de périphrases « je sors pas avec des garçons » (Jo, 38 ans) montrent qu’une représentation négative et disqualifiante du lesbianisme est toujours opérante actuellement, comme elle l’était déjà au moment de la recherche de Chetcuti-Osorovitz (2013) au début des années 2010.
L’analyse des entretiens montre que les pratiques de régulation par les mots varient selon les générations et les contextes sociaux des interviewé·es. Âgé·es et jeunes semblent ne pas avoir le même rapport aux mots, les plus jeunes évoquant un vocabulaire diversifié pour s’identifier, quand les plus âgé·es racontent le silence des mots dans lequel ielles ont évolué.
Toutefois, toustes les interviewé·es ont été confronté·es à différents moments de leur trajectoire et de façon plus ou moins brève, à ce silence des mots à des fins de protection de soi et des autres. Ainsi, après avoir examiné les divergences entre les plus jeunes et les plus âgé·es, nous finirons par ce point de convergence des parcours révélant diverses formes de silences.
Une diversité de mots à disposition pour les plus jeunes
La comparaison des récits indique que les plus jeunes interviewé·es (8 entre 20 et 35 ans) ont accès à un éventail plus large de mots que les plus âgé·es (8 entre 50 et 75 ans). Léa (24 ans) explique les différentes formes d’identification qu’elle s’est attribuée et comment elle a commencé par plutôt utiliser le qualificatif de « pan ». Maintenant elle accepte le fait de se mettre une étiquette et précise « mon étiquette actuelle je pense que c’est lesbienne mais peut-être en changement ». Elle relate également les tentatives de nomination de la part des autres, même si pour elle, c’est plutôt « fluide » et, on le voit, sujet à de possibles évolutions : « quand j’ai commencé à présenter des copines, les gens étaient “mais du coup tu es hétéro curieuse ?”, “tu es bi ?” ».
L’accès à internet se révèle être un espace de liberté et de découverte de soi crucial, par la richesse des informations et le champ des identifications rendues possibles qu’il offre (Chetcuti-Osorovitz, 2016). Ielles recherchent, dès le lycée, des fictions à partir des mots clefs « films lesbiens/lesbiennes » (Anaïs, 29 ans ; Cécile, 35 ans) ainsi que de l’information et des communautés virtuelles. Lou (20 ans) qui se questionne sur ses désirs au lycée, rejoint les groupes « LGBT France et LGBT international », au sein desquels elle découvre « des rubriques avec toutes les définitions de la communauté LGBT ». Cette découverte revêt une importance particulière pour elle, comme elle l’explique :
même si je sais pas qui je suis, je peux mettre des mots sur ce que je ressens et ces mots-là qui viennent s’attacher à moi, c’est comme un cocon dans lequel je me sens bien.
Cet accès à tout un univers est positif parce qu’il l’aide à se définir « je me dis, tiens, si je me mets le mot “lesbienne” sur moi, ça veut dire que c’est qui je suis ». Pouvoir essayer des mots, comme on essaie des vêtements, est une première étape dans son auto-définition qui facilite le cheminement dans la construction et la découverte de soi.
S’inscrivant dans leur présent (celui du moment des entretiens entre 2021 et 2022) les plus âgé·es des interviewé·es relatent l’absence ou le peu de termes pour rendre compte de leur désir lesbien, durant leur jeunesse, en comparaison à la diversité actuelle, et l’impact que celle-ci aurait pu avoir sur leur parcours. Odile (67 ans) qui a vécu ses désirs lesbiens dès 19 ans, raconte comment son parcours de lesbienne aurait été plus rapide si elle avait eu accès à toutes les informations et les modèles médiatiques actuels : « ça se serait raccourci énormément je pense. Moi je trouve que c’est extraordinaire maintenant, c’est une époque extraordinaire ». Pour Annie (72 ans), il n’y avait pas de mots jusqu’à sa première rencontre amoureuse avec une femme à 45 ans. Parlant de sa famille, elle explique que les enfants de son frère, soit une génération après, « ont mis des mots et ont vachement travaillé au corps leurs parents. Ils les ont poussés à la parole (…) les choses se sont vraiment nommées ». Elle déplore également cette absence et le fait d’y être restée si longtemps « Moi ce qui me fascine dans mon parcours, c’est cette espèce d’invisibilité de ce que j’étais ».
C’est ce silence des mots dans lequel les plus âgé·es ont baigné que nous allons maintenant explorer.
Le silence des mots
Cette pratique d’auto et d’hétéro-régulation par le silence des mots ou processus social de non-dit réduit a priori les personnes au silence. Dans leurs relations aux autres, aucun mot n’est utilisé pour s’identifier ou parler de soi. Ce processus peut être rapproché du « sujet tacite » décrit par Amari (2012, 2013) comme « un sujet qui ne se présente pas ouvertement comme une personne homosexuelle » (2012, p. 66) et qui permet aux femmes que la chercheuse a interrogées d’éviter la rupture familiale.
Les situations rencontrées par les personnes que nous avons interviewées, concernent là aussi la famille, comme Annie (72 ans) l’exprime à propos de ses parents : « ça s’est su et ça s’est tu ». Et lorsque sa mère s’invite chez elle et sa compagne, Annie raconte :
Je lui fais visiter l’appartement puis je lui dis « Ben voilà, ça c’est notre chambre ». « Ah, vous n’avez qu’un lit ? ». « Oui, on n’a qu’un lit ». Là je crois qu’elle a compris. Mais on n’a pas mis de mots non plus.
Le constat est factuel « J’avais très bien compris qu’elle avait très bien compris et on en est restées là ». Joëlle (65 ans) explique aussi qu’avec ses « parents en fait, alors là, on n’en a jamais vraiment parlé… comme ça, mis des mots sur les choses », de même que Sylviane (75 ans) comme on le verra plus loin, ou encore Pascale (51 ans) pour laquelle, au moment de l’entretien parmi tout son entourage, seuls ses parents ne savent pas : « on n’en a jamais parlé (…) j’ai pas envie de leur en parler ». Si les parents des trois premières interviewé·es ont connu leurs compagnes, illustrant un silence des mots sous la forme d’un « sujet tacite », ce n’est pas le cas de la quatrième qui a toujours évité ces rencontres entre parents et amoureuses. Cette dernière met plutôt en œuvre un silence par la séparation des espaces ou territoires sociaux.
Ce processus social de non-dit concerne aussi le travail. Si les mots sont posés dans la famille d’Odile (67 ans), ce n’est pas le cas concernant le travail où elle précise « Je disais pas je vis avec une femme, je disais rien », tout comme Laurence (64 ans) qui a longtemps été dans l’impossibilité d’en parler au travail en rappelant que « c’était dans les années 80 (…) l’homosexualité était encore considérée comme une maladie psychiatrique ». Ce silence n’est jamais loin. Ainsi, Joëlle (65 ans) qui, depuis son départ de chez ses parents après son BAC en 1976, était visible au travail, se contraint, dans les années 90, à ne plus mettre de mots et à contourner les questions liées à sa vie privée pour pouvoir assurer en toute tranquillité ses activités professionnelles.
Au travers du discours de ces interviewé·es, nous voyons poindre la problématique de ne pas cacher mais de ne pas exposer comme le dit Odile (67 ans) « J’ai jamais rien caché mais j’ai jamais exposé ». Derrière ce principe, se trouve l’idée de vivre comme tout le monde en référence à la normalité « ce qui m’intéresse c’est de vivre ma vie normale comme tout un chacun » explique Sylviane (75 ans). La normalité dont il est question ici, vient dire le rapport de domination lié à l’hétérosexualité qui pèse sur la vie des interviewé·es. Cette référence à la normalité est associée à une revendication à l’indifférence, comme pour Laurence (64 ans) « j’avais envie qu’on me foute la paix quoi. J’avais pas envie d’être définie par ma sexualité », ou Annie (72 ans) « pour moi ça devrait être juste normal. Ça devrait être une indifférence par rapport à ça » ou encore Ingrid (51 ans) qui voudrait que « dans la tête des gens, ça [l’homosexualité] soit une banalité, ça soit normal ».
Ces revendications à l’indifférence et à la normalité renvoient à des positions de résistance à la disqualification liée à la représentation du lesbianisme et à l’hétéronormativité d’une part, et d’autre part à l’hétérosexualité comme régime politique (Wittig, 2001). D’abord, les interviewé·es contestent ce régime politique qui induit une hiérarchie dans les sexualités (Herek, 1990), en mettant en regard l’action de se dire lesbienne, comme obligation, et celle de ne pas avoir à se dire hétérosexuelle, c’est-à-dire en dénonçant l’invisibilité privilège des hétérosexuel·les (Chauvin, 2003). Par exemple, Pascale (51 ans) :
Il faudrait se présenter : « Salut, je suis Pascale, je suis lesbienne ». Et quand t’as Pierre ou Paul, ou Fanny qui se présente, elle dit pas « Ben tiens, salut je suis hétéro » Donc, pourquoi nous on aurait cette obligation ?
Ensuite, insister sur la normalité de la vie quotidienne lesbienne revient à redonner de la valeur au lesbianisme et à montrer que toutes ces vies sont valables (Butler, 2006, 2018). De la sorte, les interviewé·es luttent contre la dévalorisation et l’invisibilité-stigmate (Chauvin, 2003) du lesbianisme liées à l’hétéronormativité et à la représentation délégitimante de l’homosexualité (Cano Plantec et Fraïssé, 2019). En effet, ne pas dire renvoie à la question de ce que les mots engendrent auprès des personnes, c’est-à-dire aux effets du recours à cette représentation. Annie (72 ans), parlant du village dans lequel elle habitait au moment de son premier amour lesbien, explique que « ça aurait été dangereux de mettre des mots (…) c’est extrêmement bien passé parce que j’ai pas mis de mots. Je les ai pas forcé·es à… ». Cette idée de contraindre les personnes par les mots, se retrouve dans les propos d’Odile (67 ans) qui parle du poids social lié à sa génération « qui fait que tu essayes de pas déborder trop », ou encore par Sylviane (75 ans) pour qui poser des mots oblige les personnes à prendre position car comme le précise Annie (72 ans) « les mots se manipulent pas à la légère ».
Ainsi, mettre en mots, c’est mettre en lien le vécu immédiat avec la représentation de l’homosexualité, c’est-à-dire avec les savoirs de sens commun sur l’homosexualité (masculine et féminine) qui articulent pathologie, déviance et, spécifiquement pour les lesbiennes, une fantasmatique et une érotisation de la sexualité liée à la pornographie hétérosexuelle (Chetcuti-Osorovitz, 2014, 2016 ; Jean-Jacques et Pointurier, 2024). Les représentations sociales orientant les conduites (Abric, 1994), ces savoirs sur l’homosexualité pourraient déclencher rejets et mises à l’écart. Par exemple, Sylviane (75 ans) relate que dans sa famille, un de ses cousins « a été écarté » dès lors que son homosexualité a été nommée. Parlant des relations entre ses parents et sa première compagne, elle raconte :
mes parents l’adoraient mais jamais un mot de travers n’a été prononcé parce que mon père ne l’aurait pas supporté, parce que ça l’aurait obligé à prendre des positions qu’il ne voulait pas prendre.
En effet, son père avait antérieurement exposé ses vues négatives sur l’homosexualité masculine à travers son expérience dans le travail, laissant entendre qu’identifier l’homosexualité d’une personne reviendrait à cesser toute relation avec elle. L’usage de l’expression « de travers » dans le récit de Sylviane révèle l’hétéronormativité sous-jacente dans les mots adressés à ses parents ; les mots doivent suivre le chemin de la norme. Pour Sylviane, il est alors très clair que du côté de son père, « il voulait bien vivre quelque chose mais pas le dire », et de son côté à elle,
j’aurais été aussi beaucoup moins fréquemment dans ma famille, si j’avais été obligée d’y aller toute seule et ça m’aurait obligé à ostraciser ma copine, ce que j’aurais peut-être refusé.
Ne pas mettre de mots identifiant le lesbianisme permet d’éviter les conséquences négatives liées à sa représentation sociale ; c’est donc éviter la rupture. Ainsi, des moments familiaux avec la conjointe sont possibles mais sont régulés par ce processus social du non-dit. Le lesbianisme est alors vécu et non-dit dans le même temps.
Si cette pratique de régulation est plus visible chez les interviewé·es les plus âgé·es de notre corpus, on la retrouve ponctuellement chez toustes.
Se protéger et protéger les autres : une dynamique commune
Dire ou ne pas dire relève d’une dynamique commune ; une question toujours présente à l’esprit des interviewé·es (Chetcuti-Osorovitz, 2013). En effet, même si tout leur entourage sait au moment de l’entretien qu’ielles sont lesbiennes, les interviewé·es sont toustes passé·es par éviter de le dire à certaines personnes, pour un temps parfois assez court et dans d’autres cas, bien plus long, et continuent parfois de s’interroger ponctuellement selon les contextes sociaux. Les arguments pour se taire sont liés à la nécessité de protéger son intégrité et son intimité, de l’homophobie réelle ou supposée des personnes auxquelles ielles s’exposeraient que ce soit dans la famille ou au travail.
Dans la famille, certaines personnes ne sauront pas, comme pour Anaïs (29 ans) qui n’a toujours pas dit à son grand-frère qu’elle est lesbienne pour se préserver de sa violence ou Mika (22 ans) qui l’a dit à sa mère mais redoute la réaction de son père. Le travail constitue aussi un espace où les interviewé·es cherchent à se protéger comme Morgane (25 ans) qui se contente, parfois, de dire qu’elle est célibataire quand elle sent que ce n’est pas le bon moment, ni le bon endroit, ou encore Odile (67 ans) qui explique qu’au travail, elle n’a jamais rien dit.
Qu’il s’agisse d’auto-régulation, ne pas se dire aux autres, ou d’hétéro-régulation, un·e proche demande de ne pas se dire lesbienne à un·e autre proche, ce processus de régulation des conduites semble s’appuyer sur un présupposé issu de la représentation sociale de l’homosexualité, pointant l’homophobie des personnes âgées. Fondé sur l’idée de sens commun que les plus vieilles générations seraient les plus conservatrices, les personnes considérées comme âgées par les interviewé·es, sont présupposées ne pas accepter l’homosexualité en général et le lesbianisme en ce qui les concerne. Ce sont donc souvent les grands-parents qui sont identifié·es comme homophobes et auprès desquel·les il semble le plus difficile de s’assumer.
Certain·es interviewé·es font le choix de se taire. Pour le moment, se demandant comment elle réagirait « vu que c’était la génération d’avant », Lou (20 ans) n’a pas dit à sa grand-mère qu’elle est lesbienne, même si elle pense qu’elle devrait bien réagir. Le doute ancré dans ce présupposé maintient Lou dans le silence. Sacha (38 ans) dont tout son entourage connaît son lesbianisme, ne l’a pas dit à ses deux grands-pères13, s’appuyant sur ce même présupposé pour justifier son silence « Pépé, j’avais un peu peur, parce que… je savais pas trop. Donc j’ai préféré pas le dire ». La peur est une fréquente motivation pour se taire, en particulier la peur d’être rejeté·e par ses proches, 15 interviewé·es sur les 22 y font référence.
Marion (32 ans) qui est au clair avec tout son entourage, a cependant fait le choix de ne pas le dire à sa grand-mère, s’appuyant sur plusieurs arguments, tous liés à cet effet de génération. Elle explique :
que ça n’aurait pas été la peine (…) que ça aurait été assez choquant. Et puis le qu’en-dira-t-on, c’est une génération et puis le poids de la religion aussi (...) Et puis, elle était déjà hyper âgée.
Marion pense que sa grand-mère avait compris et qu’elle était d’accord de ne pas en parler, et selon elle, c’est ce qui a permis à sa compagne d’avoir « toujours été hyper bien accueillie. En fait, elle [sa grand-mère] était contente qu’on n’en parle pas, et voilà ça se passait bien comme ça ».
Ce processus social du non-dit permet donc bien aux protagonistes non seulement de faire face à la peur mais aussi de vivre leurs relations en évitant tout risque de rupture lié à l’idée que poser le mot, lesbianisme, serait compliqué du fait de sa représentation disqualifiante et négative. C’est la raison pour laquelle Morgane (25 ans) décide de ne pas le dire à son grand-père. Sa mère va finalement le faire, de façon progressive, en parlant d’abord de « Morgane et son amie » pour finir par un « jeune couple ». Morgane raconte qu’elle a revu son grand-père depuis mais qu’elle ne sait pas ce qu’il pense, il ne lui pose aucune question. Les interactions entre le grand-père et Morgane ou sa mère, sont régulées par le processus social de non-dit, qui offre la possibilité au grand-père de tenter de rétablir le silence des mots qui a été rompu. Cette hétéro-régulation se retrouve dans d’autres relations où après que des mots aient été posés, ils sont suivis du silence, comme l’évoque Anaïs (29 ans) ou Jo (38 ans) dont les parents ne les interrogent pas sur leurs relations amoureuses.
D’autres interviewé·es ne disent rien à la demande d’un·e proche. La mère de Charlotte (52 ans) qui la rejette lorsqu’elle annonce qu’elle est homosexuelle à 25 ans, lui demande de ne rien dire dans la famille. Durant plusieurs années, elle ment à une partie de sa famille. Elle raconte le temps nécessaire pour finalement rompre ce silence et prendre le risque de la rupture familiale « j’ai mis quelques années, pour le coup, à dire à… J’ai une grand-mère qui est morte avant qu’elle puisse savoir. L’autre, j’ai mis un peu de temps avant de lui dire (…) parce que j’en avais marre, en fait, de mentir ». Si la mère de Charlotte demande ce silence, c’est pour se protéger elle-même de la stigmatisation attachée au lesbianisme de sa fille et de la honte qu’elle vit par ricochet. Toutefois, la réaction positive d’acceptation de la part de la grand-mère (et des autres membres de la famille élargie) participe à alléger cette honte. La mère de Cécile (35 ans) lui demande de ne pas en parler à sa grand-mère, alors que tout son entourage familial sait qu’elle est lesbienne. Si sa mère ne souhaite pas que Cécile parle, c’est parce qu’elle a peur de la réaction de la grand-mère, sa propre mère, qui selon les termes de Cécile, « était raciste, ben elle était homophobe. Elle était hyper de sa génération ». Là encore, l’homophobie est ancrée dans la génération mais cette idée est démentie car après l’avoir finalement dit, la mère de Cécile est étonnée par la bonne réaction de la grand-mère qui a toujours, selon Cécile, accepté ses copines.
Il s’agit aussi de protéger la personne à laquelle on cache l’information ; la protéger de la violence du savoir fondé sur le contenu délégitimant et stigmatisant de la représentation sociale du lesbianisme. On va alors « l’épargner » comme l’expriment trois interviewées. La mère d’Anaïs (29 ans) lui demande de ne pas le dire à sa grand-mère maternelle de 91 ans comme cette dernière le relate : « je crois que les termes précis c’était “On va peut-être lui épargner ça avant sa mort” ». Sophie (43 ans) explique que « le grand-père, on l’a un peu épargné, quand même », ce qui n’empêche pas sa compagne d’être présente aux repas de famille, et Ingrid (51 ans) déclare « Mon père je l’ai épargné. Il savait rien ».
Finalement, la problématique de dire ou ne pas dire que l’on est lesbienne est sous-tendue par la volonté de protéger les personnes contre la présupposée violence des mots liée à l’homosexualité et en particulier, ici, au lesbianisme. On voit que les raisons de la protection sont de deux ordres. Il s’agit d’abord de se protéger des réactions négatives et de rejet des personnes à qui on dirait son lesbianisme ou, par exemple, celui de son enfant. Dans ce dernier cas, ne pas dire le lesbianisme de son enfant, c’est aussi se protéger de la honte attachée au lesbianisme et que, par extension, on doit ressentir et vivre (Masson et Fraïssé, 2011). Ensuite, il s’agit de protéger les personnes de leur propre réaction et de ses conséquences. Comme on l’a vu, les réactions de l’entourage décrites par les interviewé·es lorsque finalement le lesbianisme est nommé, sont variées et ne concordent pas nécessairement avec le présupposé d’homophobie des personnes « âgées » et le contenu disqualifiant de la représentation du lesbianisme. L’important n’est donc pas la réaction réelle des personnes. Que celle-ci soit violente, silencieuse ou au contraire bienveillante et positive, elle n’a pas un effet direct sur le fait de dire ou de ne pas dire. La régulation normative des conduites par les mots liée à la norme d’hétérosexualité s’appuie sur les connaissances de sens commun au sujet du lesbianisme, c’est-à-dire sur la représentation sociale du lesbianisme. Et ce qui apparaît ici, c’est la prégnance et l’efficacité toujours actuelles de cette représentation sociale délégétimante du lesbianisme. Parce qu’elle prédit des conséquences négatives au fait de poser le mot, cette représentation incite les personnes au silence et contribue ainsi à maintenir les lesbiennes dans l’invisibilité, permettant en cela le fonctionnement de la norme d’hétérosexualité.
Conclusion
Des différences de générations apparaissent concernant la mise en mot du vécu des interviewé·es. La principale différence se trouve dans la diversité accrue des mots et des possibilités de se nommer, que ce soit en lien avec les sexualités ou les identités de genre, ainsi que la quantité des ressources liées à internet (Chetcuti-Osorovitz, 2014) et aux représentations médiatiques, principalement dans les fictions audio-visuelles, pour les plus jeunes. Les plus âgé·es de nos interviewé·es racontent plutôt l’absence de mots dans laquelle ielles ont évolué et se sont construit·es et évoquent la contrainte au silence qui semble être partagée et intériorisée par toustes les protagonistes des situations relatées (familiales ou de travail). Le silence est requis dans les interactions sociales : l’identité lesbienne n’est pas plus nommée par la personne concernée que par son entourage, validant en cela l’invisibilité lesbienne. Au-delà de cet effet de génération, toutes les personnes interviewées relatent des expériences ponctuelles ou à plus long terme, de cette mise au silence signalant qu’auto et hétéro-régulations normatives par les mots sont toujours effectives et efficaces au xxie siècle. Celles-ci, construites sur le silence des mots, c’est-à-dire ne pas poser de mots ou de questions, et non sur l’absence des mots (on a vu qu’ils existent et sont connus des personnes), permettent de centrer l’attention sur le vécu immédiat. En ne nommant pas le lesbianisme, les protagonistes mettent de côté les connaissances de sens commun négatives liées la représentation sociale du lesbianisme, pour en produire d’autres s’appuyant sur le vécu du moment présent. Une autre grille de lecture de la réalité peut alors être utilisée offrant la possibilité de sauvegarder les liens sociaux et d’éviter diverses formes de ruptures, tout en conservant sa vie de lesbienne (Amari, 2012). Si ce processus constitue une protection individuelle pour les interviewé·es, il demeure collectivement contraignant par le fait qu’en contribuant à l’invisibilité du lesbianisme, il maintient sa disqualification et sa position subordonnée dans l’ordre des sexualités. Il maintient donc l’hétérosexualité comme régime politique.
L’effervescence récente dans les modes de dénominations, liée à internet et à ses ressources variées, ainsi qu’à l’augmentation de la visibilité dans les fictions, constitue le signe d’une avancée dont on peut penser qu’elle contribuera à l’émergence d’une représentation du lesbianisme qui s’émancipe d’une conception négative et délégitimante ; et qui permettra ainsi de sortir de l’hétérosexualité comme régime de connaissance normatif (hétéronormativité) et régime politique (hétérosexisme).
Conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêt déclaré.