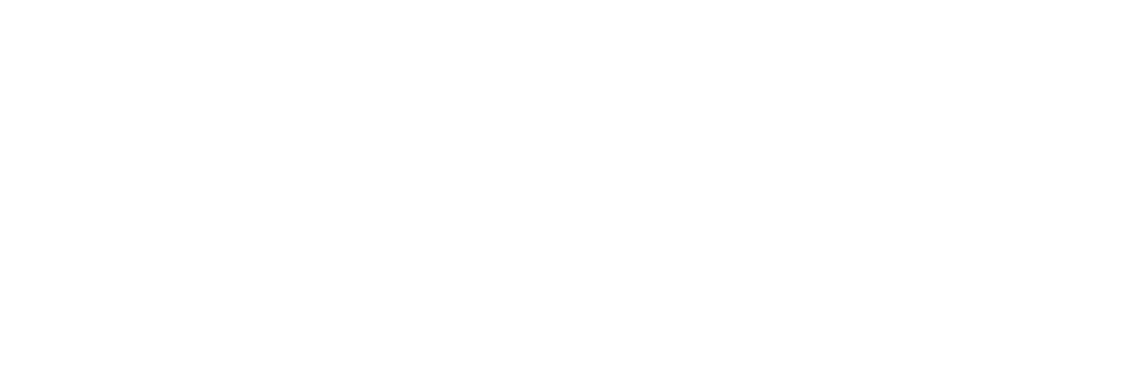Introduction
La Fanm poto-mitan est une figure emblématique de la communauté et du foyer familial (N’Zengou-Tayo, 1998) dans les territoires créolophones à base lexicale française de la zone américano-caraïbe (Hazaël-Massieux, 2002), c’est-à-dire, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et Haïti. Malgré le peu d’intérêt que ce phénomène a suscité en psychologie et dans les sciences humaines en général, à l’exception notable de l’anthropologie féministe (Dubuisson et Schuller, 2022) et de la sociologie (Lamour, 2018 ; Lefaucheur, 2017 ; Mulot, 2021), de nombreux ouvrages de la littérature caribéenne et créole (Ducalion, 2014 citée dans Roch, 2019 ; Pierre, 2008) soulignent l’ancrage et l’importance de la figure du poto-mitan au sein de ces communautés. Plus précisément, ces œuvres précisent les répercussions normatives des caractéristiques associées à la figure de poto-mitan, telle que la force sur le comportement et les relations interpersonnelles des Afro-descendantes (voir Ducalion, 2014 citée dans Roch, 2019 ; Pierre, 2008). Bien qu’aucune étude en psychologie ne se soit spécifiquement penchée sur la figure de la fanm poto-mitan, certaines recherches en psychologie sociale font état d’un stéréotype de force particulièrement ancré chez les Afro-descendantes (Okeke, 2013), qui se manifeste aussi bien au sein de la communauté, notamment dans les luttes politiques et sociales (Mulot, 2021) qu’au sein de la famille (Anyiwo et al., 2022 ; Woods-Giscombé, 2010). De plus, des études sur l’internalisation du stéréotype de la femme noire forte (Abrams et al., 2014 ; Anyiwo et al., 2022 ; Okeke, 2013 ; Woods-Giscombé, 2010) révèlent que cette pression à incarner la force a des répercussions durables sur les comportements et les relations interpersonnelles des femmes Afro-descendantes, et peut engendrer des effets négatifs sur leur santé mentale, tels que l’anxiété, les symptômes dépressifs ou l’épuisement émotionnel (Abrams et al., 2019 ; Anyiwo et al., 2022 ; Beauboeuf-Lafontant, 2007 ; Jones et al., 2022 ; Watson et Hunter, 2016).
Tout comme le stéréotype de la force ancré chez les Afro-descendantes américaines, la figure de fanm poto-mitan, symbolisant force, résilience et respectabilité (Dubuisson et Schuller, 2022 ; N’Zengou-Tayo, 1998) repose sur des attentes normatives lourdes, susceptibles de nuire au bien-être psychologique des femmes. La valorisation de la force et de la pugnacité peut engendrer une pression constante à assumer des responsabilités émotionnelles et physiques, tant au sein du foyer que dans la communauté, souvent sans reconnaissance (N’Zengou-Tayo, 1998) ni soutien adéquats (Dubuisson et Schuller, 2022). En ce sens, l’analyse intersectionnelle de la figure de fanm poto-mitan repose sur l’idée que les femmes caribéennes et créoles, en occupant ce rôle central, sont confrontées à des formes croisées d’oppression : racisme, sexisme et colonialisme. Cette convergence d’oppressions est au cœur de la notion d’intersectionnalité, telle que formulée par Crenshaw (1991), qui met en lumière la manière dont ces différentes formes de marginalisation se superposent et agissent simultanément pour façonner l’expérience des individus, en particulier des femmes noires.
Notre analyse vise à démontrer que, bien que la fanm poto-mitan bénéficie d’une certaine reconnaissance sociale (Mulot, 2019, p. 2) pour son courage et sa force, cette figure s’inscrit historiquement dans un héritage intersectionnel, porteur de normes sociales qui, lorsqu’elles sont internalisées, peuvent entraîner des répercussions psychologiques pour la santé mentale. En s’appuyant sur la psychologie sociale, la psychologie communautaire critique (Adams et al., 2017) et les études féministes critiques (Curiel, 2007 ; Hill et Ballou, 1998), cette démarche s’inscrit dans une lutte contre les injustices épistémiques et la marginalisation des Afro-descendantes dans les recherches en psychologie (Bell, 2018 ; Durrheim, 2024 ; Fricker, 2007), et entend mettre en évidence la nécessité d’adopter une perspective intersectionnelle pour mieux appréhender les enjeux associés à cette figure.
Nos objectifs seront (1) de démontrer la place centrale de la figure de fanm poto-mitan dans les territoires créolophones à base lexicale française de la zone américano-caraïbe, (2) de mettre en évidence ses racines intersectionnelles, et (3) d’explorer ses répercussions sur la santé mentale des femmes, en particulier à travers l’internalisation et les répercussions des stéréotypes de force et de résilience.
Un symbole de force dans la communauté et la sphère familiale
La force des fanm poto-mitan
La force de travail des femmes Afro-descendantes est une composante essentielle de l’archétype du poto-mitan. Historiquement, le terme poto-mitan désigne la pièce de bois au centre du temple, il s’agit du mur porteur ou encore de la pièce maîtresse de la case créole (voir Chamoiseau, 1997), ce n’est donc pas un hasard qu’il soit utilisé comme adjectif pour désigner les Afro-descendantes caribéennes et créoles. En ce sens, le premier travail académique sur les fanm poto-mitan souligne la place centrale des femmes dans la vie économique, sociale et familiale de la société haïtienne (N’Zengou-Tayo, 1998). Par exemple, une attention particulière est portée sur la vigueur de la force de travail des fanm poto-mitan qui s’illustre par leur prise en charge de nombreuses responsabilités d’ordre économique (Darlis, 2015 ; Lefaucheur, 2017 ; Mulot, 2021). Ainsi, il est courant que les femmes cumulent des emplois, englobant à la fois des tâches domestiques et des activités commerciales, tels que le travail ménager, les travaux agricoles et la gestion d’un commerce de vente (Darlis, 2015 ; Lefaucheur, 2017). Cependant, malgré leur implication dans le travail économique, ces femmes ne sont pas exemptes des responsabilités du foyer familial, et notamment de l’éducation des enfants et des tâches ménagères. Pour illustrer ces tâches cumulatives, N’Zengou-Tayo (1998) précise la nature normative de la perception androcentrique du travail des femmes haïtiennes, soulignant qu’elle est à la fois exigeante et dépourvue de reconnaissance. Cette perception androcentrique du travail des femmes reposerait sur des valeurs spécifiques, tels que le courage et le sacrifice (voir Darlis, 2015) que les femmes seraient incitées, voire contraintes, à adopter. En ce sens, Dubuisson et Schuller (2022) précisent que l’archétype de poto-mitan incarne à la fois l’autonomie et la force, stéréotypiquement associées aux femmes Afro-descendantes (Baker et al., 2015). Véritable figure de proue du modèle d’économie local (i.e., vente dans les marchés locaux, gestion de commerce de proximité dit de quartier, N’Zengou-Tayo, 1998), la figure du poto-mitan est un symbole de fortitude qui s’incarne à l’échelle de la communauté à travers le niveau économique, mais pas uniquement. En effet, simultanément, cette force se manifeste à l’intérieur du foyer familial. Dans les territoires historiques d’Outre-Mer1 créolophones à base lexicale française de la zone américano-caraïbe (voir Hazaël-Massieu, 2002 pour un portrait complet des créoles à base française), à savoir, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, les fanm poto-mitan qualifient les femmes qui doivent être à la fois, le père et la mère (voir Mulot, 2000) et symbolisent à ce titre, la fortitude des femmes Afro-descendantes dans le cadre du foyer familial. Cette influence structurante des femmes dans le cadre familial est présente dans les territoires antillo-guyanais où subsistent différentes variantes et appellations de la figure de la fanm poto-mitan. En Guyane, on parle de fanm poto-mitan kaz (Hidair, 2008) tandis qu’en Martinique et en Guadeloupe, on évoque la fanm doubout (Lefaucheur, 2017 ; Mulot, 2021). Toutes ces figures sont liées à la monoparentalité et à une organisation familiale centrée autour de la mère (Lefaucheur, 2017). Le poto-mitan représente la force qui tient et organise la maison, dans cette perspective, ces femmes sont considérées comme la tête de la maison (N’Zengou-Tayo, 1998 ; Spillers, 1987). De manière similaire à la figure du poto-mitan haïtienne, la fanm poto-mitan des territoires antillo-guyanais symbolise les responsabilités familiales (Lefaucheur, 2017 ; Mulot, 2019 ; N’Zengou-Tayo, 1998). Les premières représentations littéraires de la fanm poto-mitan haïtienne ont été écrites par des auteurs masculins. Ces récits dépeignent la femme haïtienne comme un symbole politique de force et de courage, tout en occultant les restrictions et violences qu’elle subit (i.e., interdiction de pratiquer des arts, Poujol-Oriol, 1996 citée dans N’Zengou-Tayo, 1998). À l’inverse, les autrices antillaises (Ducalion, 2014 citée dans Roch, 2019 ; Pierre, 2008) soulignent plutôt, à travers leurs personnages féminins, le poids des normes sociales et la multiplicité des responsabilités que les femmes doivent assumer avec courage et détermination.
Endurer et souffrir en silence
La force, le « kenbé » (tenir en créole) constitue la pierre angulaire de l’archétype du poto-mitan (Dubuisson et Schuller, 2022 ; Lamour, 2019 ; Lefaucheur, 2018 ; Mulot, 2019 ; Mulot, 2021). La force de ces femmes s’exprime simultanément à différents niveaux. À l’extérieur de la communauté, elle se manifeste à travers l’engagement des femmes dans l’économie locale (voir N’Zengou-Tayo, 1998) et les luttes et mouvements sociaux des territoires (Lamour, 2020 ; Mulot, 2021). Simultanément, cette influence se manifeste à l’intérieur du foyer familial, où elles jouent le rôle de pivots centraux de la famille (Lamour, 2018 ; Lefaucheur, 2017 ; Mulot, 2021). Les premières études sur ce sujet (N’Zengou-Tayo, 1998) mettent en lumière les nombreuses violences quotidiennes (i.e., viols, polygamie forcée, pression sociale) qui participent à instaurer et maintenir une culture du silence, préjudiciable aux femmes haïtiennes. Les déterminants de cette culture du silence sont multiples. Dans un premier temps, la culture du silence a été consolidée par des restrictions spécifiques, à la fois institutionnelles et sociales, imposées aux femmes, telles que l’interdiction de pratiquer des arts (voir, Poujol-Oriol, 1996 citée dans N’Zengou-Tayo, 1998). Ces restrictions ont contribué à la fois à l’établissement d’une culture du silence et à l’idéalisation de la figure de fanm poto-mitan comme « idéal sacrificiel » (Dubuisson et Schuller, 2022 ; Lamour, 2019) qui valorise et glorifie celles « prête à tout, quel qu’en soit le sacrifice » (Darlis, 2015, p. 96). Or, plusieurs études en psychologie ont montré qu’internaliser la force comme une qualité vertueuse peut s’avérer coûteux. Par exemple, cela implique la tendance à réduire, voire à taire ses propres besoins et émotions pour satisfaire les attentes de sa famille et de la communauté (Abrams et al., 2014 ; Beauboeuf-Lafontant, 2007 ; Watson et Hunter, 2016).
En clair, la figure du poto-mitan se distingue par des caractéristiques et des traits particuliers, incarnant à la fois la femme aux multiples responsabilités (Lefaucheur, 2017 ; Mulot, 2019 ; N’Zengou-Tayo, 1998), dans la communauté (Mulot, 2021 ; N’Zengou-Tayo, 1998) et à l’intérieur du foyer familial (Lamour, 2018 ; Lefaucheur, 2017 ; Mulot, 2021). La respectabilité de la figure du poto-mitan se définit à travers une forme spécifique de fortitude qui s’incarne par le sacrifice pour autrui et la négation altruiste de la souffrance (Dubuisson et Schuller, 2022 ; Lamour, 2019). La section suivante s’attachera à identifier les origines intersectionnelles des composantes de la figure de fanm poto-mitan.
Une figure intersectionnelle
Une figure héritée de la traite négrière et étayée dans le racisme
Plusieurs auteur·rices situent la genèse de la figure de la fanm poto-mitan dans l’histoire de la traite négrière (Chamoiseau, 1997 ; Dorlin et Paris, 2006 ; Guillemaut, 2013 ; Mulot, 2000 ; Mulot, 2021). Par exemple, selon Chamoiseau (1997), l’origine de la fanm poto-mitan est enracinée dans la case créole, la pièce maîtresse (la maison) des personnes mises en situation d’esclavage pendant la traite négrière. En sciences humaines, les études ont démontré que la représentation de la femme noire s’ancre dans des discours racistes qui déshumanisent (Lamour, 2019) et animalisent (Anderson et al., 2018) les Afro-descendantes. Par exemple, le stéréotype de la force chez les femmes Afro-descendantes serait un legs du colonialisme où l’on croyait en une supériorité présumée des capacités physiques des femmes noires par rapport à celles des femmes blanches (Harris-Lacewell, 2001). Les similarités entre la représentation de la figure de la fanm poto-mitan et le schéma de la femme noire forte, largement explorés en psychologie (voir, Thomas et al., 2022 pour une revue), particulièrement en ce qui concerne l’importance accordée à la force dans la socialisation des femmes Afro-descendantes (Davis et Jones, 2021), suggèrent que les caractéristiques de la fanm poto-mitan peuvent être considérées comme une variante spécifique du schéma de la femme noire forte dans les contextes créolophones de la zone américano-caraïbe (ici, spécifiquement la Guadeloupe, Guyane, Martinique et Haïti). Plus récemment, la littérature en psychologie précise spécifiquement, les implications du racisme dans la perception occidentale des Afro-descendantes (Anyiwo et al., 2018b ; Anyiwo et al., 2022). L’endossement du schéma de la femme forte serait autant une réponse, qu’une stratégie adoptée par les femmes Afro-descendantes pour faire face aux discriminations raciales (Anyiwo et al., 2018b ; Ford, 2008 ; Watson et Hunter, 2016 ; Wyatt, 2008). Les recherches en histoire et en sociologie soulignent, pour leur part, que le Code noir et le code napoléonien, ouvrages de référence profondément racistes en matière d’administration des personnes réduites en situation d’esclavage, ont imposé un modèle familial ancré dans le racisme et centré sur les femmes (Dorlin et Paris, 2006 ; Guillemaut, 2013 ; Mulot, 2000 ; Mulot, 2021). Ce modèle a attribué entièrement aux femmes la responsabilité du foyer familial, notamment, en interdisant la reconnaissance des enfants par le père (Mulot, 2000 ; Mulot, 2021).
Par conséquent, la force inhérente à la figure de la fanm poto-mitan peut être considérée comme un héritage de l’histoire raciste de la colonisation. Dans un même temps, des travaux pluridisciplinaires avancent que la place prépondérante de la femme noire dans le contexte familial serait également un schéma culturel de genre spécifique (Baker et al., 2015 ; Lamour, 2019 ; Mulot, 2021) qu’il s’agira d’explorer dans la section suivante.
Une figure enracinée dans un schéma de genre ?
Représentant à la fois la force et les responsabilités familiales, ainsi que le devoir de respectabilité des femmes, la figure de la fanm poto-mitan prend racine dans des relations de genre qualifiées de traditionalistes, caractérisées par le patriarcat (Lamour, 2018). Ces relations se distinguent par un rapport de pouvoir conflictuel et asymétrique entre les hommes et les femmes (voir, Lefaucheur, 2017 ; Mulot, 2021) ; et un impératif de la famille genré marqué par une irresponsabilité familiale des hommes (Lefaucheur, 2017 ; Mulot, 2021 ; N’Zengou-Tayo, 1998). Par exemple, pour Lefaucheur (2018), le fait social massif de la monoparentalité des femmes serait une manifestation du patriarcat qui s’exprimerait à travers une structure familiale spécifique autour de la mère. Dans un même temps, le prestige social associé au rôle de "sur mère", c’est-à-dire de « mère respectable » (Pierre, 2008) illustre l’influence du patriarcat (Breton, 2011) sur les traits valorisés associés à la figure de la fanm poto-mitan, notamment, en ce qui concerne l’exigence de respectabilité sexuelle qui serait une tentative de contrôle du corps des femmes (Lefaucheur, 2018) par une sexualité restrictive. La répartition genrée et inéquitable des responsabilités familiales fait de la figure de fanm poto-mitan, une « assignation sociale » (Lefaucheur, 2018) et un « piège » (Lefaucheur, 2017 ; Mulot, 2021) pour les femmes. Des travaux plus récents spécifient que l’archétype de fanm poto-mitan peut entrer en conflit avec le féminisme et participer activement à sa délégitimation, notamment chez les femmes guadeloupéennes (Mulot, 2021). Lamour décrit la fanm poto-mitan comme jouissant d’une "autonomie sous contrôle" (Lamour, 2019, p. 20), une forme d’agentivité illusoire façonnée par le patriarcat, où le pouvoir agentiel (Fricker, 2007), c’est-à-dire l’agentivité des femmes, demeure étroitement lié (aliéné) à la maternité. Roch (2019), quant à elle, évoque un « enfermement du sujet féminin dans le rôle de la maternité » (Roch, 2019, p. 106) ou encore « un carcan de souffrance » (Roch, 2019, p. 109).
Cette perspective contraste avec l’image de prestige généralement associée aux fanm poto-mitan. En effet, ces dernières bénéficient d’une certaine « glorification » (Darlis, 2015) et d’une reconnaissance sociale (Mulot, 2019). Toutefois, la figure de la fanm poto-mitan demeure contradictoire et sujette à la contestation (Lefaucheur, 2017). De plus, cette figure est perçue de manière ambivalente : parfois vue comme un symbole de courage, fièrement arboré par les Afro-descendantes (Mulot, 2021), parfois considérée comme un modèle difficile à incarner (Lefaucheur, 2017 ; Mulot, 2021). Cette dualité de perception pourrait s’expliquer par la nature intersectionnelle (Crenshaw, 1991) de cette figure, marquée par les héritages de divers systèmes d’oppression, tels que le racisme et le sexisme. À l’instar de l’appropriation du modèle de la femme noire forte par les Afro-descendantes (Baker et al., 2015), l’endossement de la figure de fanm poto-mitan pourrait influencer tant les perceptions et les comportements des Afro-descendantes que ceux des Occidentaux·ales.
Quelles perceptions des Afro-descendantes et des Occidentaux·ales ?
Tout comme Lamour (2021), nous soutenons que l’archétype de fanm poto-mitan s’inscrit dans un enchevêtrement d’inégalités et d’injustices de nature raciste, sexiste et coloniale. Tout au long de notre argumentaire, nous avons souligné l’ancrage contextuel simultané du racisme, du sexisme et du colonialisme dans les composantes de la figure de fanm poto-mitan. En ce sens, les travaux menés en psychologie sur le schéma de la femme noire forte démontrent que son internalisation est renforcée par les expériences socioculturelles de discrimination raciale et sexiste (Anyiwo et al., 2022). Ce schéma sert ainsi de mécanisme d’adaptation face aux injustices systémiques et intersectionnelles (liées à la race et au genre) qui marginalisent les femmes noires (Anyiwo et al., 2018b ; Ford, 2008 ; Watson et Hunter, 2016 ; Wyatt, 2008). Nous soutenons que l’archétype de la fanm poto-mitan pourrait fonctionner de manière similaire. Woods-Giscombé (2010) démontre, par exemple, que les Afro-descendantes identifient clairement des facteurs écosystémiques, macrosystémiques et situationnels, comme des précurseurs du schéma de la femme noire forte et de son internalisation, tels que les oppressions systémiques et intersectionnelles de genre et de race ; ainsi que l’éducation par les pairs et les expériences personnelles de maltraitance et d’abus. D’autres études illustrent les implications négatives de l’endossement du schéma de la femme noire forte sur la santé mentale des Afro-descendantes, telle qu’une faible estime de soi (Stanton et al., 2017). À notre connaissance, aucune étude en psychologie ne s’est spécifiquement penchée sur l’archétype du poto-mitan et ses implications sur la santé mentale des populations dans les territoires créolophones à base lexicale française. Cette contribution se veut ainsi un appel à approfondir cette exploration.
Toutefois, plusieurs auteur·ices en sciences humaines (Dubuisson et Schuller, 2022 ; James, 2010 ; Lamour, 2021) mettent en évidence les répercussions du schéma spécifique de la femme noire forte sur la perception des Occidentaux·ales envers les Afro-descendantes (Dubuisson et Schuller, 2022 ; Lamour, 2021), notamment dans la pratique de la recherche en Haïti où l’ancrage de la figure de fanm poto-mitan est important (N’Zengou-Tayo, 1998). Par exemple, Dubuisson et Schuller (2022) notent qu’après le tremblement de terre en Haïti, les initiatives de recherche en sciences humaines (notamment en ethnographie) ont insisté et mis en avant la (sur)résilience des Afro-descendantes, ce qui contribue à renforcer le statu quo autour de l’impératif de résilience chez ces dernières. En ce sens, James (2010) souligne également un traitement médiatique spécifique autour des femmes haïtiennes qui insistent sur leur résilience pour diminuer le stéréotype de victime. Pour diminuer le regard biaisé des chercheur·euses Occidentaux·ales (Dubuisson et Schuller, 2022 ; Lamour, 2021), nous soutenons que les méthodes d’analyses et de recherches autour de la figure intersectionnelle de fanm poto-mitan doivent impérativement s’appuyer sur une approche critique et un positionnement réflexif qui reconnaissent les biais comme les injustices épistémiques et herméneutiques (voir Fricker, 2007) autour des travaux sur les communautés minorées dans le monde de la recherche (Buchanan et al., 2021). Adopter un positionnement critique quant aux méthodes dites classiques de la recherche et envers les modèles d’intervention mainstream (Adams et al., 2017) est indispensable pour repenser la production de connaissances et la conceptualisation d’interventions dans des contextes singuliers tels que ceux des mondes créolophones et caribéens. Ainsi, l’étude de la figure du poto-mitan doit s’inscrire d’une part, dans une logique transformationnelle et, d’autre part, s’ancrer dans des valeurs qui incarnent la justice sociale (i.e., la justice testimoniale et herméneutique, Fricker, 2007) et favorisent le réenpouvoirement des populations.
Repenser les méthodes de production du savoir et d’interventions
Conscientiser la colonialité du savoir
Dès la première étude universitaire consacrée à la figure de fanm poto-mitan (N’Zengou-Tayo, 1998), l’autrice souligne le peu d’attention accordé aux expériences personnelles et aux vécus singuliers des femmes. En ce sens, plusieurs auteur·ices en psychologie communautaire critique soulignent que la production de connaissances n’est pas neutre, mais plutôt qu’elle perpétue et génère des inégalités qui ont une influence préjudiciable sur les personnes racisées (Buchanan et Wiklund, 2020 ; Settles et al., 2020 ; Settles et al., 2021). De plus, les chercheur·euses en psychologie communautaire et en études féministes soulignent que le manque d’intérêt dans la littérature envers certaines populations, notamment les Afro-descendant.es, peut refléter une forme de colonialité du savoir (Adams et al., 2017 ; Lander, 2000 ; Tuck et Yang, 2012). Cette dynamique particulière de production du savoir perpétue le statu quo en minorant les expériences et les injustices subies par les populations minorisées (Durrheim, 2024). Plus spécifiquement, Curiel (2007) pointe les nombreux biais androcentrique, euro et nordocentrique opérant dans les logiques discursives (i.e., les arguments) et analytiques (i.e., les analyses émises) des études menées auprès de populations non blanches. Le manque d’études en psychologie explorant cette figure n’est pas un phénomène isolé. En effet, les populations non blanches (Bell, 2018 ; Durrheim, 2024 ; Murray et Durrheim, 2019) et racisées (Buchanan et Wiklund, 2020 ; Durrheim, 2024 ; Settles et al., 2020 ; Settles et al., 2021) sont fréquemment exclues de la production de connaissances. Durrheim (2024) souligne que cette exclusion se manifeste tout au long du processus de recherche par une répression dialogique, un phénomène collaboratif du silence qui justifie et normalise les inégalités systémiques envers les minorités, tout en éludant toute remise en question du statu quo dans la production de connaissances (Billig, 1999 cité dans Durrheim, 2024).
Pour pallier cela, plusieurs auteur·ices invitent à repenser les modes de production de savoir : les théories, les modèles et les types d’interventions communément menées auprès des communautés minorisées (Kurtiş et Adam, 2015 ; Mohanty, 2003). Dans le même ordre d’idée que ces auteur·ices, il est primordial de remettre en question les approches d’intervention auprès des communautés où la figure de fanm poto-mitan est prévalente. Ces interventions tendent à encourager et à promouvoir des mécanismes d’adaptation individuelle, telle que la résilience, pour challenger le stéréotype de victime (i.e., femmes en Haïti, James, 2010) mais sans pour autant, proposer d’espace où les fanm poto-mitan peuvent remettre en question le statu quo en exprimant, par exemple, leur vulnérabilité (Dubuisson et Schuller, 2022 ; Ulysse, 2011).
En somme, remettre en question les interventions classiques mettant l’accent sur la résilience des Afro-descendantes constitue une première étape indispensable pour permettre une production de connaissances et d’interventions équitables autour de la figure du poto-mitan. Dans un même temps, ce positionnement se traduit nécessairement par un effort de conscientisation des legs du colonialisme dans les logiques discursives et analytiques envers les communautés minorisées en sciences (voir Kurtiş et Adam, 2015 en psychologie ; Mohanty, 2003 pour des propositions en ce sens dans les recherches féministes) et par l’adoption de méthodes de recherche issues d’un positionnement critique de décolonisation (Adams et al., 2017). Dans la prochaine section, nous proposons trois pistes de recherches inspirées des approches libératrices (Kessi et al., 2022), critiques et décoloniales (Adams et al., 2017 ; Tuck et Yang, 2012) de la psychologie communautaire autour de la figure de fanm poto-mitan.
La recherche avec et pour les fanm poto-mitan
Placer les fanm poto-mitan comme expertes de leurs propres expériences représente la pierre angulaire de mes recommandations concernant l’élaboration de futures études sur cette figure singulière. Plus précisément, nous considérons qu’il est essentiel de développer des interventions et des recherches scientifiques ancrées dans une perspective critique de résistance face aux risques de machinations colonialistes (Tuck et Yang, 2012) de la résilience. Cette approche s’oppose aux méthodes classiques qui se concentrent davantage sur la promotion de mécanisme d’adaptation à l’échelle individuelle, telle que la résilience des Afro-descendantes (DeVerteuil et Golubchikov, 2016 ; Dubuisson et Schuller, 2022), tout en évitant l’enjeu d’exclusion épistémique des populations non-blanches et racisées dans le processus de recherche (Adams et al., 2017 ; Lander, 2000 ; Tuck et Yang, 2012). Bien au contraire, une telle approche invite à réaliser de la recherche avec, par et pour les populations minorisées, ici, il s’agira donc de placer les fanm poto-mitan en point de mire de la recherche.
Une première initiative pourrait consister à mener des recherches en partenariat avec les communautés créoles et caribéennes, notamment, en utilisant des approches collaboratives qui valorisent le savoir et le vécu des fanm poto-mitan (i.e., recherche-action collaborative, recherche participative communautaire, voir Johansson et Lindhult, 2008) et s’ancrent dans des méthodologies enracinées dans une perspective transformationnelle des connaissances et des réalités sociales. Guidées par des valeurs axées sur la justice sociale et la justice testimoniale, il pourrait s’agir, par exemple, de conduire une recherche participative communautaire à visée émancipatrice autour de la réappropriation de la figure du poto-mitan par les communautés créoles et caribéennes. Dans cette perspective, la question de recherche, ainsi que le choix des méthodes, des analyses et des résultats, seraient élaborées conjointement avec la communauté et leur restitution serait également codéfinie avec celle-ci. Cette démarche serait menée en partenariat avec la communauté à travers la mise en place d’un comité de projet comprenant des pair·es chercheur·euses. Ce processus de recherche, fondé sur la justice testimoniale et la construction d’une relation de confiance entre les participant·es, permettrait de produire des connaissances situées (Jagosh et al., 2015) qui replaceraient les enjeux liés à la figure de la fanm poto-mitan dans leurs contextes collectifs et institutionnels, en les détachant de leur dimension individuelle et en les analysant à travers les prismes des systèmes d’oppressions intersectionnelles (c’est-à-dire, racisme, sexisme, colonialisme). En raison de ces spécificités, les études féministes critiques qualifient ce type d’études comme situées dans une politique de localisation (Hill et Ballou, 1998) qui prend en compte les spécificités du contexte.
Une seconde initiative de recherche pourrait être la création d’un fonds de recherche critique pluridisciplinaire à travers la Caraïbe et les territoires créolophones. Dans un premier temps, portés par des objectifs de lutte contre les injustices épistémiques et la minorisation des territoires de la zone américano-caraïbe dans la recherche, plusieurs projets pourraient émerger afin d’étudier spécifiquement les enjeux contemporains (i.e., les identités de genre, l’hétéronormativité, le sexisme, les formes contemporaines de violences de genre) autour de la place des femmes dans les sociétés créoles et caribéennes. Établir des antennes dans les différents territoires (i.e., Guyane, Guadeloupe, Martinique et Haïti) permettrait d’analyser les caractéristiques communes et spécifiques de la figure de la fanm poto-mitan de chaque territoire et leurs effets différenciés autant à l’échelle collective qu’individuelle. En employant des méthodes de recherche participative, comme la recherche participante, la recherche-action critique (Johansson et Lindhult, 2008) et les programmes collaboratifs interdisciplinaires (voir Kessi et al., 2022), l’objectif serait de créer des espaces novateurs de réflexion critique où recherche et terrain se rencontrent et se parlent. Ces espaces aborderaient des questions essentielles, telles que : depuis sa définition initiale, quelles redéfinitions de la fanm poto-mitan ont été proposées ? Comment les héritages sociaux, économiques, historiques et politiques associés à ces redéfinitions ont-ils été réinterprétés, ou non ? Quel rôle peuvent jouer les hommes dans la réflexion autour des fanm poto-mitan ? Quels liens peuvent être établis entre la figure de la fanm poto-mitan et la santé mentale selon les perspectives des premièr.es concerné.es ? Autant de questions qui permettraient aux Afro-descendant.es impliqué.es d’interroger la prévalence, les significations de la figure de fanm poto-mitan et ses points de tension (i.e., les aspects contradictoires autant que les formes de réappropriation de cette figure). Ces forums de discussion critiques devraient être accessibles au grand public et permettre à chacun(e) d’avoir la possibilité de s’exprimer sur ce sujet, sans distinction de genre, d’âge ou de catégorie socioprofessionnelle. Pour garantir cette inclusivité, l’utilisation de médium artistique telle que le théâtre (par exemple, le théâtre forum), les expositions photographiques ou le cinéma seraient appropriés.
Enfin, une troisième initiative complémentaire aux précédentes présentées pourrait s’intéresser à développer des espaces de vulnérabilité (i.e., groupe de discussion, groupe d’entraide) qui permettraient de faire émerger des échanges et des réflexions autour des défis que ces femmes rencontrent quotidiennement. Comme indiqué par Dubuisson et Schuller (2022), il est essentiel de créer et proposer des espaces aux femmes qui vont à l’encontre des normes de force et de silence imposées à la fanm poto-mitan. En effet, de telles initiatives pourraient renforcer le pouvoir d’agir des femmes en leur permettant d’exprimer leurs difficultés et vulnérabilités. Les objectifs et les modalités de ces rencontres doivent être développés en collaboration avec les membres des communautés impliqués. Cette approche vise à établir un lien de confiance qui favoriserait l’expression libre des femmes concernant leurs besoins en matière de santé, d’infrastructures ou encore, les déterminants de leur santé et les défis qu’elles rencontrent et qui affectent leur santé physique et mentale. Dans un même temps, ces initiatives pourraient contribuer à développer des recherches sur la santé mentale de ces communautés qui sont, encore aujourd’hui, en trop petit nombre. Dans le même ordre d’idée, nous considérons qu’il est crucial de développer une lecture psychologique autour des processus internes et des facteurs externes de la figure fanm poto-mitan afin de mieux saisir les implications de cette figure sur la santé mentale. Par exemple, en combinant les approches de la psychologie sociale pour analyser les facteurs influençant l’internalisation de la figure de la fanm poto-mitan, et de la psychologie communautaire pour étudier ses répercussions à un niveau plus large, nous pourrions concevoir des interventions scientifiques collectives et individuelles visant à améliorer le bien-être des populations. Ces recherches pourraient également servir de base pour des actions de lobbying auprès des responsables politiques, encourageant ainsi la mise en place d’initiatives novatrices centrées sur la santé mentale des populations.
Conclusion
La fanm poto-mitan est un pilier central : celle qui porte sa maison et les siens, même lorsque tout vacille autour d’elle. En dépit de tout, sans relâche, elle soutient sa famille et sa communauté (N’Zengou-Tayo, 1998 ; Pierre, 2008 ; Roch, 2019). En nous appuyant sur des recherches pluridisciplinaires, nous avons examiné l’aspect intersectionnel de la figure de la fanm poto-mitan (Lamour, 2021 ; Lefaucheur, 2018) par l’analyse croisée des influences du racisme, du sexisme et du colonialisme, dans les éléments constitutifs et l’ancrage de l’idéal sacrificiel autour de la fanm poto-mitan (Lamour, 2019 ; Lefaucheur, 2018 ; Mulot, 2019). Si être un poto-mitan peut apporter un certain prestige social (Darlis, 2015 ; Mulot, 2019 ; Pierre, 2008), cette honorabilité a un prix (West et al., 2016), elle s’établit par des sacrifices qui peuvent affecter négativement la santé des femmes (Dubuisson et Schuller, 2022). En outre, la grandeur des fanm poto-mitan est conditionnelle à une autonomie importante, qui se manifeste par la prise en charge complète, sans aide, ni assistance extérieure de nombreuses responsabilités familiales, économiques et sociales (Darlis, 2015 ; Lefaucheur, 2017 ; Mulot, 2021 ; N’Zengou-Tayo, 1998 ; Pierre, 2008 ; Roch, 2019). Bien qu’il existe peu de travaux sur la figure de la fanm poto-mitan, nous postulons que celle-ci pourrait s’apparenter à une variante des territoires créolophones à base lexicale française du schéma culturel spécifique de « la femme noire forte », longuement documentée en psychologie (Anyiwo et al., 2018b ; Ford, 2008 ; Watson et Hunter, 2016 ; West et al., 2016 ; Wyatt, 2008).
Pour diminuer les conséquences négatives de ce schéma sur la santé mentale, les interventions ont tendance à mettre l’emphase sur la « résilience » des Afro-descendantes (James, 2010 ; Ulysse, 2011). Or, nous soutenons que ce type d’interventions présentent des risques iatrogènes majeurs, notamment celui de reproduire des schémas coloniaux dans les modalités d’intervention et la production du savoir (i.e., colonialité du savoir, Adams et al., 2017 ; Lander, 2000 ; Tuck et Yang, 2012) qui contribuent à biaiser le regard des chercheur·euses Occidentaux·ales sur les Afro-descendantes et à renforcer le stéréotype de fortitude associée aux femmes créoles et caribéennes (Dubuisson et Schuller, 2022 ; Lamour, 2021). À la place, nous invitons à repenser le mode d’intervention classique et la production de connaissances scientifiques envers les Afro-descendantes (Buchanan et al., 2021 ; Durrheim, 2024 ; Settles et al., 2020 ; Settles et al., 2021). En ce sens, nous proposons trois pistes de recherches critiques, ancrées dans des méthodologies inspirées des études féministes et de la psychologie communautaire critique (Adams et al., 2017 ; Lander, 2000 ; Tuck et Yang, 2012). Ces propositions visent à mettre en place des initiatives de recherche et d’intervention développées par et pour les fanm poto-mitan. Elles reposent sur l’utilisation de méthodes féministes participatives et collaboratives, profondément enracinées dans leur réalité spécifique (Hill et Ballou, 1998) et orientées vers une transformation significative des réalités sociales. En somme, ces initiatives ont pour objectif de renforcer le pouvoir d’agir des personnes concernées, de promouvoir la justice sociale, et de favoriser un changement social porté par et pour les premièr.es concerné.es.
Remerciements
Je tiens à remercier les relectrices de cet article pour leurs conseils éclairés et leurs remarques constructives, qui ont grandement contribué à l’enrichissement de ce travail.
Conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêt déclaré.