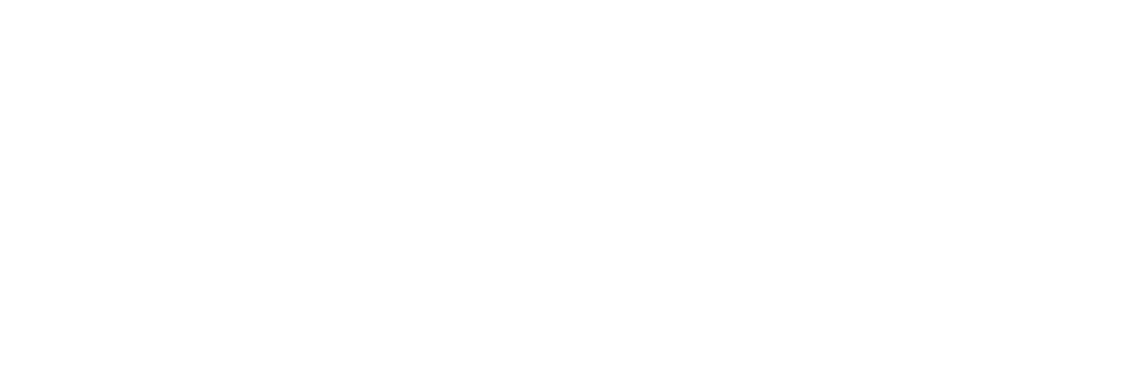D’un point de vue historique, les usages de drogues se confondent avec l’évolution des hommes, de leurs croyances, de leurs besoins, de leurs connaissances et de leurs conflits (Morel et al., 2015, p. 1). Leur développement, au cours de ces deux derniers siècles, s’est fait au gré des avancées scientifiques propres à chaque époque, en lien avec le regard du religieux et de la morale ; il accompagne également et participe sans conteste à la mutation des rôles sociaux, notamment en ce qui concerne la question du genre (Coppel, 2004, p. 40). Classiquement, le terrain dit des « drogues » — incluant l’alcool et son usage — est perçu comme un espace de pratiques masculines (Duprez et Kokoreff, 2000, p. 34). En effet, depuis le xixe siècle et jusqu’aux années 1970, « le boire excessif [est] d’abord un phénomène masculin » (Pentecouteau et Zanna, 2015, p. 64), connoté positivement comme facteur de sociabilité et d’affirmation d’une identité virile, permettant aux hommes de répondre à l’injonction sociale de masculinité qui leur est faite, là où la sobriété était « une expression de la féminité, de la pureté et de la sécurité » (Beck et al., 2006, p. 143).
Cependant, si globalement, la plus forte prévalence d’usages de drogues reste d’actualité chez les hommes, notamment en termes de fréquence, d’intensité et de consommation problématique (OFDT, 2022 ; Obradovic et Beck, 2013), leur diffusion se produit dans tout le corps social, y compris chez les femmes (Germes et al., 2022). Jusqu’ici faussement perçu comme « neutre et sans sexe » (Salle, 2015, p. 34), l’alcoolisme s’adjective et devient « féminin » lorsqu’il concerne les femmes. Des représentations spécifiques de ces dernières émergèrent alors dans le champ médical au prisme d’une comparaison sexuée hommes-femmes, et prirent la forme de stéréotypes négatifs portant sur leur statut de consommatrices.
Notre réflexion portera sur le concept d’ « alcoolisme féminin » ainsi érigé, les représentations collectives qu’il véhicule et sa résonance sur le plan intrapsychique pour les femmes usagères. Après quelques rappels sur l’alcool et ses conséquences somatiques chez les femmes, nous aborderons les stéréotypes spécifiques dont elles sont l’objet au sein des représentations collectives. Nous verrons ensuite leur retentissement sur le fonctionnement intrapsychique et la manière dont ils vont influencer la prise en soins, tant chez les protagonistes elles-mêmes que chez les professionnel·les des centres spécialisés. Notre postulat, consistant à dire que l’alcoolisme féminin n’existe pas, fait directement référence à la formulation lacanienne « la femme n’existe pas », spécifiant la singularité de l’être humain au-delà de sa dimension anatomiquement et sexuellement déterminée. Nous verrons ainsi en quoi le concept d’alcoolisme féminin relève plutôt d’une construction sociale visant à pérenniser l’ordre sexué et l’établissement d’une hiérarchie de genre qui profite aux hommes. Notre travail considèrera donc les femmes usagères d’alcool au cœur même du concept d’intersectionnalité (Crenshaw, 2021), victimes d’une double discrimination les visant à la fois en tant que femmes et consommatrices de drogues.
Notre champ d’études et notre travail seront nourris par notre pratique de psychologue clinicienne, d’obédience psychanalytique, exerçant en CSAPA1 depuis six ans. Notre approche prend sa source au plus près de la clinique de terrain, auprès de femmes consommatrices d’alcool venant consulter dans un centre spécialisé francilien (anciennement CCAA2) et dont la majorité présente une maladie addictive. De par la moyenne d’âge de la population observée (entre quarante et cinquante ans), nous exclurons de fait les femmes plus jeunes, dont les pratiques de consommation se manifestent plutôt sous la forme de binge drinking (Obradovic et Beck, 2013), défini comme la consommation d’au moins cinq unités d’alcool dans un laps de temps de deux heures ou moins (OFDT, 2000). Cependant, notre point de vue concernera bien toutes les femmes consommatrices, par-delà le critère d’âge. Il sera inévitablement situé en tant que femme blanche de culture française, cisgenre, ayant effectué des études supérieures et issue d’un contexte social plutôt aisé. Il sera également marqué par notre culture hospitalière publique, qui constitue le terreau de notre pratique professionnelle depuis une vingtaine d’années, et sera donc fortement imprégnée du modèle biomédical, idéologiquement masculin et dominant dans ce type d’institution, ainsi que par une approche soignante, qui tend à obérer la dimension sociale du sujet étudié — ce qui représentera les limites de cette réflexion.
L’alcool et ses conséquences somatiques chez les femmes
L’alcool éthylique, ou éthanol, est une substance psychotrope, couramment dénommée « drogue » dans le langage populaire, définie comme un
produit psychoactif naturel ou synthétique, utilisé par une personne en vue de modifier son état de conscience ou d’améliorer ses performances, ayant un potentiel d’usage nocif, d’abus ou de dépendance et dont l’usage peut être légal ou non (OFDT, 2000).
L’alcool modifie le fonctionnement cérébral et entraîne des modifications psychiques et comportementales. La classification pharmaco-clinique en vigueur classe les substances psychoactives en trois catégories, en fonction de leurs effets ; du fait de son action sédative sur le système nerveux central, l’alcool appartient à la catégorie des dépresseurs, aux côtés des stimulants et des perturbateurs (Delay et Deniker, 1961). D’un point de vue médical, l’usage de l’alcool peut entraîner sur le long terme de nombreuses pathologies somatiques, des troubles psychologiques, neurologiques et comportementaux, pouvant grever de manière significative la santé du sujet et son espérance de vie (Naassila, 2017). Cependant, cette substance présente une toxicité plus importante pour les femmes que pour les hommes, notamment en raison de phénomènes hormonaux spécifiques et d’une distribution de la masse graisseuse différente modifiant le métabolisme : à consommation égale, les femmes sont beaucoup plus affectées d’atteintes cognitives et somatiques que les hommes (Naassila, 2017).
Par ailleurs, de nombreux travaux mettent l’accent sur le risque tératogène que présente la consommation d’alcool pendant la grossesse et qui constitue la première cause de handicap mental d’origine non génétique chez l’enfant en France : l’ETCAF (ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale) regroupe l’ensemble des conséquences physiques, somatiques, cognitives et comportementales pouvant être liées à la consommation d’alcool par la mère au cours de la grossesse (Brahic et al., 2015). Ces troubles incluent notamment le syndrome d’alcoolisation fœtale (désigné le plus souvent sous son acronyme « SAF ») qui entraîne des anomalies de la face et du système nerveux central, des malformations, un retard de croissance et des troubles nerveux chez l’enfant à naître, puis, à long terme, un retard mental, un déficit attentionnel, ainsi que l’altération de capacités d’apprentissage et de mémorisation. L’apparition de ces risques fœtaux est fonction de la quantité d’alcool consommée, de la durée d’exposition, de la façon de boire, du stade de la grossesse et des capacités métaboliques de la mère et du bébé (Brahic et al., 2015).
Cependant, malgré ces conséquences spécifiques sur la santé des femmes, « l’alcoolisme n’a eu de sexe qu’à partir du moment où l’alcoolisme féminin a été porté sur le devant de la scène » (Clément et Membrado, 2001, p. 51), reliant ainsi ce dernier à la question du genre. Longtemps invisibilisé, il est exposé au grand jour à travers ses particularités, traduisant « une constante de la description sexuée des faits sociaux » (Simmat-Durand, 2007, p. 305).
De l’invisibilisation à la particularisation
Le phénomène d’invisibilisation, entendu comme « une situation et un ensemble de processus qui conduisent à un sentiment de non-reconnaissance et de mépris social » (Beaud et al., 2008, p. 27), n’est pas nouveau dans le champ de la santé des femmes d’une manière générale, et des drogues en particulier. En effet, les femmes sont « exclues de la construction des grands problèmes de santé publique comme le VIH, l’alcoolisme, les toxicomanies ou les maladies cardiovasculaires, voire même les cancers, puisqu’elles auraient leurs “cancers spécifiques” » (Membrado, 2006, p. 16). Elles s’avèrent donc également exclues du champ des addictions, ce dernier s’étant largement médicalisé depuis la loi du 31 décembre 19703, puis par la mise en place du Plan Addictions en 2007, faisant de l’usage de drogues une affaire médicale et plus seulement une pratique sociale.
Neff (2018), doctorante en sociologie sur le thème genre et addictions, fait le même constat au sujet des différents travaux académiques qui portent sur les usages de drogues, leurs modalités et leurs caractéristiques : ils n’incluent que très peu les femmes « à la fois en tant qu’échantillon représentatif que du point de vue de l’analyse » (p. 570), amenant à une forte mobilisation de la recherche sur les enjeux de la consommation des hommes, au détriment de celle des femmes. Elle constate que les travaux traitant de leurs consommations sont rapides et peu développés, évoquant ainsi la « politique de la donnée absente » (Morgan, 1984, p. 87) plaçant les femmes au rang de « populations historiquement négligées » (Anderson et al., 2008, cité par Neff, 2018, p. 573) au sein des différentes recherches effectuées sur ce thème. La comparaison genrée prévaut, comme le montre par exemple la revue Tendances de l’OFDT (2017) : la consommation féminine est systématiquement étudiée, évaluée et traitée en comparaison avec la consommation des hommes, dont elle serait le pendant, l’autre face en tous points opposée. Cependant, cet oubli se double paradoxalement d’une « particularisation » (Membrado, 2006) des femmes consommatrices de drogues, qui va structurer les représentations collectives et la prise en soins qui leur est proposée. Elle apparaît dans différents travaux scientifiques sur la santé des femmes, sous la forme de plusieurs thématiques qui toutes renvoient à la nature féminine et à son déterminisme biologique, participant ainsi à la construction d’un portrait spécifique de la femme usagère d’alcool.
Stéréotypes de la femme consommatrice d’alcool
Si l’image de la femme consommatrice de substances a pu émerger au cours de l’histoire en apparaissant comme un sujet émancipé et déviant (Coppel, 2004), il n’en demeure pas moins que d’une manière générale, une consommation excessive d’alcool est toujours évaluée plus négativement lorsque la personne qui consomme est une femme que lorsqu’elle est un homme (Karoll, 2002 ; Nolen-Hoeksema, 2004, cités par Taschini et al., 2015). Considérées comme intrinsèquement constitutives de l’essence féminine, la maternité, la sexualité et la fragilité vont constituer les trois pierres d’achoppement au fondement de ce regard négatif. En effet, en premier lieu, la femme qui boit ne serait pas « une bonne mère », telle qu’elle est envisagée au siècle des Lumières, définie comme « [investissant] fortement la maternité, pour la placer au service de l’enfant, avenir du monde » (Knibiehler, 2012, p. 69). Sa consommation la place dans une « désaffection de [son] rôle » maternel (Membrado, 2010, p. 96) ; elle porte préjudice à l’enfant à venir, ainsi qu’à sa propre famille, en la rendant incapable de s’occuper de son foyer et de ses enfants, et donc « a priori coupable de négligence, voire de maltraitance » (Coppel, 2022, p. 39) en la dotant « d’un comportement irresponsable [l’excluant] des rôles et identités socialement acceptables » (Murphy et Rosenbaum, 1999, cités par Neff, 2018, p. 577).
En deuxième lieu, la femme consommatrice est un sujet vulnérable sur le plan de sa sexualité (Hoareau, 2012). Elle prend des risques, comme l’oubli de contraception, pouvant provoquer une grossesse accidentelle et une interruption volontaire de grossesse potentielle, et la contamination par une infection sexuellement transmissible, l’alcoolisation leur donnant une image de femmes « forcément libérées, décadentes et portées sur le sexe » (Thomas, 2013, p. 63), faciles à séduire. Sous alcool, elle apparaît disponible sexuellement (Simmat-Durand et Toutain, 2018), ce qui diminue sa capacité à se protéger en cas d’agression sexuelle, ce que confirment plusieurs études (Testa et al., 2003 ; Vasseur, 2015, cités par Simmat-Durand et Toutain, 2018). Le stéréotype sous-jacent de cette vulnérabilité tend ainsi « à générer une image de la femme usagère comme étant moins sujet autonome que son pair masculin et moins en capacité de faire des choix lucides dans sa vie » (Hoareau, 2012, p. 25). Nous voyons ainsi que l’attention est moins portée sur la femme en tant que sujet singulier, que sur son « corps reproductif ou sexuel » (Germes et al., 2022, p. 21), qui met en péril, par sa consommation de substances, une nation tout entière et sa descendance. Coppel (2022) rappelle justement à ce titre que les mesures de réduction des risques à l’époque de l’émergence du VIH n’auraient pas vu le jour si les « usagères de drogues n’avaient représenté une menace pour la population générale » (p. 47) — masculine, ajouterons-nous — en étant des agentes actives de transmission du virus.
Enfin, la consommation d’alcool par les femmes est souvent interprétée comme la conséquence d’un mal-être psychique (Membrado, 2006), a contrario de celle des hommes pour lesquels le phénomène d’entraînement, d’intégration et le socius sont le plus souvent évoqués (Pecqueur et al., 2016). Cette origine psychologique supposée les positionne comme victimes et leurs pratiques d’alcoolisation dénonceraient « l’expression d’un malaise et d’une souffrance psychique » (Neff, 2018, p. 582) pouvant être corrélées à des violences subies pendant l’enfance et à des problèmes familiaux (Simmat-Durand et Toutain, 2018). L’alcoolisme féminin serait donc névrotique, en cela qu’il témoignerait de « failles, [d’]événements traumatiques dans leur enchaînement alcooligène, l’angoisse, le sentiment d’échec, la dépression » (Descombey, 2003, p. 55).
Nous voyons ainsi que, sous couvert d’une préoccupation centrée sur les femmes, la maternité (associée au statut de gardienne des valeurs familiales), la fragilité, et les origines psychopathologiques sont trois assignations stigmatisantes — toutes interdépendantes — emprisonnant les femmes dans une image réductrice et négative. De cette manière,
la fonction reproductrice des femmes, sans doute la plus prégnante, explique en partie que l’attention pour les femmes alcooliques comme pour les femmes toxicomanes ou encore pour les femmes séropositives aujourd’hui se manifeste avec le risque que leur comportement fait courir à la santé des autres (Membrado, 2010, p. 96)
Un risque qui concerne notamment l’enfant potentiel et la population masculine. Il faut noter ici que certains travaux d’obédience psychanalytique portant sur l’alcoolisation des femmes et son sens symbolique font état de ces mêmes références à la question du maternel et de la féminité. Posant la question de savoir s’il existe une fonction propre au genre féminin quand on parle d’addiction, Favennec et al. (2020) évoquent divers travaux (deux en l’occurrence) qui « admettent cette corrélation entre la conduite addictive alcoolique et l’accès à la maternité » (p. 88). Pour eux, l’alcool serait, chez la femme, « une solution à une impasse dans l’accès à la fonction symbolique de la maternité » (ibid., p. 90), du fait du refus de leur partenaire à répondre à leur demande fondamentale, celle de la maternité dans son acception symbolique (Haddad, 2009). D’autres travaux parlent de l’alcoolisme féminin comme une réponse au « ravage du maternel » (Cloës, 2015, p. 204), c’est-à-dire la persistance chez la femme du lien de dépendance premier non dépassé et qui témoignerait de la persistance chez cette dernière du lien originaire à la mère préœdipienne dont elle ne pourrait se dégager (Faoro-Kreit, 2001) : la femme alcoolique resterait fixée à une identification conflictuelle à sa propre mère, écartelée entre des sentiments extrêmes de dépendance et de rejet. Le recours compulsif à l’alcool permettrait la régression à cette période d’attachement en maintenant une illusion de complétude d’un lien nostalgique (Tamian, 2019). L’alcoolodépendante aurait grandi sous le joug d’une emprise maternelle violente dès ses premiers mois d’infans et s’alcooliserait massivement pour réintégrer son corps propre, séparé de l’objet, parfois jusqu’à la mort (Faoro-Kreit, 2001). La féminité, non héritée de la mère et en souffrance, serait subséquemment grevée dès l’origine, ce que Tamian (2021) résume ainsi : « La femme alcoolique vient troubler la face du paraître de la féminité, en extirpant d’elle-même, grâce à l’alcool une dimension cachée d’elle-même […], une dépossession de soi, une forme de désubjectivation de l’être » (p. 46).
Historiquement, cette vision de la femme n’est ni nouvelle ni spécifique au champ des drogues et de la psychanalyse. Elle puise ses fondements tout d’abord dans la pensée médicale, avec les travaux d’Hippocrate (entre 460 et 377 avant notre ère) et de Galien (entre 129 et 201 après notre ère), pour qui l’être féminin était perçu comme inachevé — en comparaison avec celui de l’homme, face à l’être masculin — entièrement soumis à la « matrice » (l’utérus) et moins capable de se développer intellectuellement. Elle se renforce ensuite au siècle des Lumières et trouve un relais auprès des philosophes, pour qui les devoirs de la femme consistent à enfanter, être une bonne épouse, et préserver l’ordre familial : « C’est la vocation physiologique qui dicte les lois morales de la condition féminine » (Knibiehler et Fouquet, 1983, p. 93), la femme n’existant pas pour elle-même, mais pour « réaliser les vœux de la nature » (p. 93). Déjà à cette époque, la production d’une naturalisation de la femme venait faire de la maternité un point de référence, à partir duquel se sont ordonnées les conceptualisations et compréhensions actuelles de l’alcoolisme féminin.
Ces interprétations, quelle que soit la discipline où elles s’enracinent, renvoient donc de manière uniforme aux assignations de genre, obèrent la singularité du sujet et relativisent in fine la souffrance exprimée. Elles négligent la trajectoire relationnelle et historique proprement subjective, en plaquant de manière aveugle une théorie sur une population donnée, confortant ainsi l’ordre sexué en défaveur des femmes. Cela nous renvoie également aux violences théoriques que dénoncent Ayouch et Salomão (2013) au sujet des violences conjugales dont sont victimes les femmes, et qui excluent la dimension sociale et politique du phénomène (la violence masculine qui est ici occultée) au profit d’une compréhension figée et biologiquement déterminée.
Espace et drogues
Une autre caractéristique, concernant l’alcoolisation des femmes et dont plusieurs auteur·ices font état, apparaît suffisamment fréquemment dans la littérature pour que nous nous y arrêtions. De manière dogmatique, il semble convenu que les femmes boivent seules et de manière clandestine : elles tromperaient leur entourage (Memmi, 1998) et auraient plus souvent une consommation solitaire en cachette, nocturne et à leur domicile (Coscas, 2017). Cela n’est pas sans faire écho au fantasme masculin selon lequel les femmes ont foncièrement une personnalité dissimulatrice (Clément et Membrado, 2001 ; Taschini et al., 2015). Plusieurs réponses peuvent être apportées à ce constat faussement descriptif. Nous rejoignons l’idée que si la consommation peut être cachée aux yeux de l’entourage, c’est tout d’abord parce que la crainte d’être jugée négativement est prévalente (Beck et al., 2006) et que cela leur permet d’échapper aux regards malveillants de manière rationnelle et volontaire (Coppel, 2022). Membrado (2006), quant à elle, exprime l’idée que « les femmes boivent là où elles sont » (p. 19), en particulier à l’endroit où la division sexuée du travail et l’assignation aux tâches domestiques les cantonnent, c’est-à-dire chez elles. Cette question nous renvoie ici aux liens que le genre entretient avec la question spatiale, où d’une manière générale, la dichotomie espace privé/public vient incarner « la matérialisation du patriarcat » (Hancock, 2018, p. 11) : les hommes consomment dans les lieux extérieurs, entre amis et de manière conviviale, alors que les femmes consommeraient à l’abri des regards, seules et chez elles.
Or, si cette répartition spatiale des pratiques d’usages était assez figée il y a encore une trentaine d’années — pour les raisons que nous venons d’évoquer — elle a évolué avec le développement des pratiques festives des femmes. Ces dernières connaissent aujourd’hui de nouvelles opportunités de socialisation, en investissant les lieux publics tels que les bars, les cafés, etc. (Neff, 2018). Elles revendiquent l’accès à l’espace public festif comme moyen d’autonomisation de soi, tout en devant répondre à l’injonction, comme le montrent les travaux féministes depuis plusieurs décennies, de maîtriser leur corps sur le plan vestimentaire, comportemental ou encore leurs consommations. Contraintes d’évoluer entre les frontières du plaisir et du risque (Hutton, 2006), elles forgent des modalités d’usage qui prennent en compte ces différentes variables. Ainsi, les femmes doivent développer des compétences propres et mettre en place un « système gestionnaire [reposant] sur la connaissance renouvelée du danger potentiel, sanitaire et légal, que fait encourir la consommation », afin de se préserver en créant un cadre de « sécurisation de la pratique » (Soulet, 2003, p. 344). Cette gestion suppose une connaissance fine du produit en lui-même (concernant ses effets, leur durée, la quantité, les conséquences négatives potentielles entre autres) ; elle nécessite un travail sur soi permanent et une réflexivité, tirant profit des expériences et des erreurs. Elle articule, de notre point de vue, de manière intrinsèque la question du genre à celle de la spatialisation de l’usage, en vue d’une constante adaptation. Ainsi, la géographie du lieu choisi pour consommer (chez elles) serait moins l’apanage d’une personnalité agissant en secret que fonction de la « présence de proches, de la proximité d’un lieu de repli, de leur perception d’un endroit comme sûr » (Scavo et Germes, 2022, p. 182).
Souffrance intrapsychique et prise en soins
Comme l’écrit Freud (1920/2010), la violence sociale est la plus dévastatrice sur le plan psychique. En faisant peser sur les femmes des contrôles sociaux stricts (Germes et al., 2022), les normes sociétales concernant l’alcool et son usage, marquées par une forte réprobation morale et sociale, participent à la construction d’une image de « femme déchue » (Hoareau, 2012, p. 23) qui n’est pas sans conséquence sur le vécu psychique des femmes usagères et leur positionnement subjectif. Dans notre clinique, nous constatons en effet qu’une importante souffrance intrapsychique est fréquemment exprimée en termes de honte, de solitude et de culpabilité, ce dont témoignent également divers auteur·ices (Bouvet de la Maisonneuve et al., 2017 ; Gaussot et Palierne, 2010). Le vécu de honte peut entraîner un sentiment d’infériorité et d’impuissance et résulte d’une tension entre le moi et l’idéal du moi, mais également du fait d’être en échec ou de croire qu’il y a en soi quelque chose de fondamentalement mauvais ou problématique (Roche, 2017, p. 50).
Cependant, au regard de notre travail sur les stéréotypes de genre, nous pouvons également considérer la honte intrapsychique, particulièrement prégnante dans la clinique addictive, comme le fruit d’une production sociale, « une honte de genre » (Coppel, 2004, p. 45) nourrie intrinsèquement par les injonctions normatives qui leur sont faites. Dans le cadre du soin, d’une manière générale, les femmes usagères expriment clairement ressentir le jugement négatif, le mépris et l’indifférence de la part des professionnel·les à leur égard, ainsi que les stigmatisations dont elles sont l’objet (Hoareau, 2012), par exemple celles de se voir parer d’une image de mère irresponsable et négligente, voire abusive (Simmat-Durand, 2007), leur faisant courir le risque de se voir retirer leurs enfants (OEDT, 2000). Nous supputons que cet éprouvé a inévitablement des répercussions sur leurs fréquentations des dispositifs de soins spécialisés : les femmes sont en effet sous-représentées dans les services dédiés, alors même que l’accès aux services de santé est davantage de leur fait (Obradovic et Beck, 2013 ; Germes et al., 2022). D’autres raisons peuvent aussi concourir à cette situation, comme le fait que les espaces de soins, par leur mixité, participent au maintien de la présence du groupe dominant masculin qui exerce une surveillance discriminante de leurs pratiques (Schmitt, 2022) ou encore le fait que les équipes elles-mêmes éprouvent des contre-attitudes négatives à leur endroit, notamment par la réactivation d’une thématique mortifère en opposition avec la capacité féminine à donner la vie (Fedi, 1994). Enfin, les injonctions fréquentes d’abstinence qui sont plus souvent faites aux femmes qu’aux hommes, comme traitement de leurs consommations problématiques (Geirsson et al., 2009, cités par Taschini et al., 2015), pourraient également participer à leur éloignement des services de soins, en les plaçant dans une alternative binaire (consommer/ne pas consommer) qui leur ôte la possibilité de développer une gestion maîtrisée de leurs consommations.
L’alcool, au-delà du genre
Le savoir et les pratiques androcentriques, dont témoignent plusieurs travaux que nous avons évoqués, ne doivent pas, à notre sens, occulter les trajectoires singulières de ces femmes en tant que sujet, et obérer les ressources leur permettant un travail thérapeutique. En effet, nous considérons qu’aller « au-delà du genre » et de ses assignations permet de resituer leurs conduites de consommations dans des phénomènes structuraux plus larges dépassant la catégorisation homme-femme (Parent, 1998) et d’interroger la dynamique psychique propre à chacune. Sur le plan intrapsychique, s’intéresser au discours formulé par les femmes elles-mêmes, au sens qu’elles donnent à leurs pratiques de consommation, permet au clinicien ou à la clinicienne d’interroger la singularité des fonctions de l’alcoolisation pour chacune au sein de son histoire individuelle : l’anesthésie des affects et des pensées, la détente, la gestion de l’anxiété et des angoisses, ou encore la désinhibition, permettant de comprendre la « logique de résolution » (Pedinielli, 2017, p. 80) dans lesquels ces conduites s’inscrivent. Entendre les mouvements psychiques tels qu’ils se jouent sur le plan subjectif, dégagés de toute projection stigmatisante, ne peut que favoriser une meilleure appréhension de leur problématique intrapsychique, notamment en termes d’individuation, de capacité de représentation et d’organisation de l’image du corps, « défauts fondamentaux » (Monjauze, 2011, p. 42) caractéristiques de la personnalité des sujets alcoolodépendants.
Comme le nuance Descombey (2003, p. 56), « le style, les caractères formels et fonctionnels du discours reflètent probablement un fonctionnement psychique assez identique [chez l’homme et la femme] », mettant au jour un fantasme d’idéal hermaphrodite et une problématique narcissique archaïque fondamentalement défaillante, « unissant les alcooliques hommes et femmes » (ibid., p. 56) en deçà de la différence des sexes. Pour l’auteur, la psychopathologie alcoolique n’est pas foncièrement différente chez l’homme et chez la femme, la faille psychique étant tellement archaïque qu’elle se situe en deçà de l’acquisition de la différence des sexes. C’est également ce que suggère Levaque (2010), en proposant l’idée qu’une faille narcissique primordiale, créant des « ratages dans l’articulation des registres imaginaire-symbolique » (p. 68), a altéré le processus identificatoire au moment du stade du miroir et dont une des premières conséquences est le désinvestissement très prononcé du corps propre. Ce ne serait donc pas tant la féminité qui serait désinvestie chez les femmes usagères que leur propre corps qui « ne semble pas prendre consistance dans sa dimension sexuée » (Boulze-Launay et Rigaud, 2018, p. 144). Pour ces auteur·ices, l’élément commun à l’addict de sexe masculin comme à l’addict de sexe féminin serait le ratage de « la construction d’une position subjective d’homme ou de femme à partir de l’énigme du réel du corps et la différence anatomique des sexes » (p. 148). Sur le plan psychosocial, Coppel (2022) rappelle également qu’à plusieurs périodes de l’histoire, les femmes ont investi les drogues pour changer la perception qu’elles avaient d’elles-mêmes, de leur corps, de leurs relations aux autres, pour devenir plus fortes, plus autonomes et plus sûres d’elles-mêmes. La fonction émancipatrice, la recherche de convivialité et de plaisir seraient ainsi à inclure dans la compréhension de leurs pratiques d’usages et de leurs trajectoires sociales particulières. Il ne s’agirait donc pas tant pour les femmes d’adopter par imitation les comportements masculins en termes d’alcoolisation, que « d’expérimenter de nouvelles formes de subjectivités » (Coppel, 2022, p. 62) leur permettant de conquérir « une individualité que refuse la division sexuelle des rôles » (ibid., p. 39) et de procéder « à des formes de renégociations d’injonctions normatives » (Neff, 2018, p. 586).
Conclusion
De nombreuses conceptions morales, scientifiques, médicales et sociales influencent le rapport de l’être humain aux drogues, faisant de l’alcool un « objet complexe et polymorphe […] infiltré de significations, plus qu’un breuvage, il est une fonction » (Dany et al., 2015, p. 299) largement imprégné des normes de genre. Structurellement construit au sein et pour servir un système misogyne, qui fonctionne, comme le rappellent Gargam et Lançon (2013), par stéréotypes, le concept d’alcoolisme féminin a ainsi pour fonction de perpétuer « le modèle traditionnel de la différence des genres [en créant] un rapport social inégalitaire » (Pecqueur, 2016, p. 49) bénéficiant structurellement aux hommes. Pour Tavani et al. (2015), la stigmatisation repose sur la perception d’une menace pour le fonctionnement social ; il nous reste à comprendre pourquoi la consommation d’alcool par les femmes fait tant peur aux hommes. Serait-ce parce que ces dernières viennent justement transgresser l’ordre social, profondément soumis à l’ordre sexué, et mettre en cause le « contrat social entre les sexes » (Fougeyrollas-Schwebel, 1999, p. 137) ? Ou encore parce qu’elles vivent, sur le plan psychique et grâce aux drogues, « une érotique particulière » où l’homme ne leur est plus nécessaire (Bader Melenotte, 2018) ? La question reste ouverte.
Conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêt déclaré.